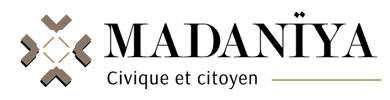Dernière mise à jour le 27 octobre 2019
Paris 26.02.15 – La Cour d’appel a rejeté une nouvelle fois, jeudi 26 février 2015, la requête introduite par Georges Ibrahim Abdallah en vue de sa libération, dans un invraisemblable déni de droit, rarissime dans les annales judiciaires françaises, en ce que militant pro palestinien d’origine libanaise, emprisonné en France depuis 30 ans, a déja purgé sa peine. Incarcéré depuis 1984, il a battu le record détenu jusque-là par Nelson Mandela (24 ans), le chef du combat nationaliste sud-africain, et revendique désormais le titre de « Doyen des prisonniers politiques dans le Monde », au même titre que Mumia Abu Jamal.
Le témoignage du dernier acteur de la séquence par Yves Bonnet, ancien directeur de la Direction de la Surveillance du territoire (DST)
 Pour juger équitablement de l’incroyable affaire « Georges Ibrahim Abdallah », qui amène la France à détenir en prison un des deux plus vieux prisonniers politiques du monde, il est indispensable de restituer le contexte de son commencement.
Pour juger équitablement de l’incroyable affaire « Georges Ibrahim Abdallah », qui amène la France à détenir en prison un des deux plus vieux prisonniers politiques du monde, il est indispensable de restituer le contexte de son commencement.
Nous sommes au début de la décennie 1980. La guerre entre l’état d’Israël et les diverses organisations palestiniennes fait rage, à coup d’assassinats, ceux des représentants de l’OLP, pourtant reconnue au point d’avoir à Paris un quasi-ambassadeur, faisant écho à ceux de représentants et d’officiels israéliens.
La tragique comptabilité de cet affrontement sans issue fait plutôt pencher la balance du côté israélien, tant l’efficacité du service action du Mossad est avérée, et dans la mesure où il est de bon ton de dénoncer le « terrorisme aveugle » d’un côté et, de l’autre, le « droit légitime de se défendre ».
Cette terminologie est celle des services de sécurité européens qui collaborent ouvertement avec les antennes du Mossad, recevant comme « du bon pain » les renseignements qu’elles lui distribuent généreusement et s’impliquant pour leur part dans un vaste réseau de collecte unilatéralement orienté.
Dans cet esprit, quand le Kidon élimine les deux représentants officieux de l’OLP en France, Mahmoud Hamchari en janvier 1973, Ezzedine Kalaq en août 1978, la DST, que la procédure ni la qualité des cibles ne peuvent abuser, ne déploie pas un grand zèle pour retrouver les auteurs de ces actes, objectivement « terroristes ».
En revanche quand l’attaché militaire israélien à Paris, Yacov Barsimentov, est tué à Paris par une femme, attentat doublé de celui de l’attaché américain Charles Ray d’une balle dans la tête, la division antiterroriste se met en chasse. Deux poids, deux mesures, la balance n’est pas tenue égale dans une lutte qui ne nous concerne pas et qui sonne comme un prolongement incongru de la guerre d’Algérie.
Les choses changent avec mon arrivée rue des Saussaies, quand je décide d’ouvrir nos relations, purement professionnelles, en direction des services dits « arabes », palestiniens, algériens, puis syriens. Pour ce qui concerne la Palestine, une vraie collaboration s’ébauche avec le représentant de l’OLP à Paris, Ibrahim Souss, beau-frère de Yasser Arafat, homme d’une vaste culture et d’un commerce agréable.
Par son entremise, Abou Iyad, chef des services de sécurité de l’OLP, vient à Paris rencontrer Pierre Joxe, ministre de l’Intérieur, qui le reçoit, très tard le soir, en ma seule présence et s’en débarrasse en me le confiant. Sans le vouloir, il me fait un beau cadeau, car Abou Iyad et moi faisons rapidement fructifier cette relation qui va nous amener à de fréquentes rencontres, sous des formes diverses, à Paris, dans la zone internationale d’Orly, à Tunis au siège de l’OLP.
Une amitié naît que je conserve secrète, ne souhaitant en rien en tenir informés nos partenaires occidentaux, européens, et, moins encore, américains. Pour ma gouverne personnelle, j’approfondis ma connaissance du dossier palestinien, loin d’être aussi manichéen que la tradition le présente, et je réalise que l’embrigadement dans un camp ne peut nous tenir lieu de ligne directrice, même si je continue d’éprouver de la sympathie pour un État d’Israël dont le gouvernement est dirigé par Shimon Peres que je rencontre à Paris.
Dans les dossiers en attente à la division antiterroriste, figure celui des assassinats de Charles Ray et Yacov Barsimentov, tous deux « attachés militaires », c’est à dire espions officiels. Les investigations conduites par les trois services intéressés à l’élucidation des meurtres conduisent sur la piste d’un groupuscule libanais d’inspiration marxiste et issu de la communauté chrétienne, les « Fractions armées révolutionnaires libanaises », en abrégé les FARL.
Recrutés au sein d’un petit groupe de quelques familles d’un village au nord de Tripoli, Koubeiyat, ses membres ne sont pas « infiltrables » puisqu’ils se connaissent tous. Ils agissent à partir du Liban et la CIA comme le Mossad leur attribuent, outre les actions que nous venons d’évoquer, une tentative avortée sur le consul américain à Strasbourg Robert Homme.
Les origines marxistes des FARL les situent dans la filiation du Front populaire de libération de la Palestine de Georges Habache et d’Ahmed Djibril-qui s’en séparera bientôt- et leur fondateur, Georges Ibrahim Abdallah, instituteur de formation, n’est pas un professionnel de l’action, mais plutôt un doctrinaire balançant entre marxisme et nationalisme. Il n’est pas identifié physiquement par les services, non plus que ses compagnons de lutte, les Esber, les Abdallah, les Abdo, les Khoury, les Sarkis, ce qui rend leur traque difficile.
Tel est le contexte, celui d’une recherche banale des membres d’une organisation de moins de vingt membres, autant dire d’une aiguille dans une botte de foin, quand une série d’événements, que j’ai déjà relatés et que je conserve dans un compte-rendu de l’époque, replace le dossier des FARL en pleine actualité.
Le point d’orgue de ces rebondissements est atteint quand Georges Ibrahim Abdallah vient se présenter dans un commissariat de police de Lyon pour « échapper à une traque imaginaire ». Étant donné qu’il est en situation irrégulière, au regard de ses papiers, il est retenu par la police et déféré devant un juge. Il commet alors une série d’erreurs incroyables, comme celle de menacer de représailles ses gardiens, ce qui m’amène à prendre le dossier en mains et à vérifier par moi-même la véracité de ses dires.
Bien entendu, nous ignorons alors son identité. Mais les gens de l’antiterrorisme au sein de la direction ont flairé la bonne prise, ce qui me conduit à mettre en œuvre tout le réseau de mes relations pour déterminer à qui nous avons à faire. Qu’il suffise de dire qu’Algériens et Palestiniens collaborent à cette reconnaissance qui ne sert en rien leurs intérêts et dont seuls Américains et Israéliens peuvent tirer bénéfice.
Ce point est important et doit être souligné avec force alors qu’aujourd’hui ce sont ces mêmes pays qui s’opposent à une mesure, non de clémence, mais de justice dont ils n’auraient pas pu être partie si la DST et -qu’on me pardonne cette remarque- moi même, n’avions utilisé des concours qui leur étaient interdits pour identifier enfin Georges Ibrahim Abdallah.
La loyauté dont nous avons administré la preuve envers deux alliés est jetée à la rivière, de leur fait et de celui d’un pouvoir politique français qui aura, tout au long de la procédure, fait preuve d’indécision et d’irresponsabilité, comme la suite des événements va le confirmer.
Quand Georges Ibrahim Abdallah est, en effet, reconnu, les soupçons qui pèsent sur lui quant à son implication dans les trois actions violentes perpétrées sur le sol français aiguisent l’appétit des Américains et des Israéliens qui tiennent leur vengeance.
De leur côté, les membres des FARL pour qui l’arrestation de Georges Ibrahim Abdallah constitue un coup terrible, mettent au point une stratégie primaire pour le faire libérer: ils menacent puis, très vite, passent à l’acte en enlevant un fonctionnaire français, le directeur du centre culturel de Tripoli, et en exigeant son échange contre leur chef.
L’histoire ne se réécrit pas : mais il est certain que si Abdallah lui-même n’avait pas rendu sa position difficile en cachant son identité puis en jouant de l’intimidation et de la menace, y compris à l’égard des envoyés de la SMA et de l’OLP, nous aurions pu envisager un accord discret et le laisser filer.
Mais une telle issue n’eût été possible qu’en l’absence de toute intervention judiciaire et par l’entremise d’Abou Iyad. À compter du moment où un juge d’instruction fut saisi du dossier, le cadre légal s’imposa à nous.
Sur ces entrefaites, Gilles Sidney Peyroles est enlevé le 23 mars 1985
Le directeur du centre culturel français de Tripoli (Nord Liban) n’est pas n’importe qui : il est le fils de Gilles Perrault, écrivain connu et reconnu, que j’ai eu l’occasion de découvrir quelques années plus tôt dans mon poste de sous-préfet de Cherbourg. J’ai toutes les raisons de travailler à sa libération et n’en suis pas démenti quand je reçois la visite à mon bureau de Régis Debray et Gilles Perrault, venus m’exprimer leur inquiétude.
L’entreprise s’avère délicate car je n’ai, ni de près ni de loin, de relation avec les FARL ou le FPLP, mes seuls recours étant la SMA algérienne et le service de sécurité d’Abou Iyad. Ces contacts ne s’activant pas d’un claquement de doigts, je ne change rien à mon programme immédiat qui prévoit un déplacement à Washington au siège de la CIA puis au Canada. Je précise qu’au moment de mon départ, aucune menace précise n’a encore été formulée par les FARL.
C’est donc à Langley, siège de la CIA, que j’apprends, de la bouche de Pierre Verbrugghe, directeur général de la police nationale, que les choses se gâtent et qu’il convient que je regagne Paris.
Étant donné que je n’ai encore rien dit à mes interlocuteurs américains de l’arrestation de Georges Ibrahim Abdallah, je n’ai pas à leur expliquer les raisons de mon départ. Ils me laissent d’ailleurs me débrouiller seul, à partir de Washington, sachant que je ne parle pas anglais, et que je dois acheter mon passage à New York, bref, ils me laissent tomber « comme une vieille chaussette », aucun de leurs officiers ne m’attendant à Kennedy Airport.
A peine rentré à Paris, je m’attelle à l’inévitable négociation. Du ministre Joxe qui vient de trouver l’occasion de me reprocher d’avoir donné une interview à un journaliste du « Monde » alors que je n’ai fait que déférer à une injonction de son cabinet, nulle assistance. Il ne me reçoit même pas avant mon départ pour Alger ; puisque c’est de cette ville que mon ami Lakhal Ayat me propose d’engager le dialogue avec le Liban. Je suis donc livré à moi-même, sachant que je n’ai pas le droit à l’erreur.
La négociation dure une longue journée, entre Alger, Beyrouth et Tripoli. La pression des FARL est lourde et leurs menaces précises: ils exigent une réponse avant le soir, le principe étant celui d’un échange pur et simple. Je discute pour ma part avec Paris, mon directeur de cabinet Jacky Debain, s’échinant à obtenir un feu vert de Pierre Joxe qui ne répond pas et de Roland Dumas qui est à Bruxelles. Finalement, faute d’un accord des politiques qui pratiquent l’esquive, le colonel Ayat donne sa parole aux ravisseurs qui veulent bien s’en contenter et je donne pour ma part ma parole à mon ami et homologue algérien.
C’est donc de l’engagement de deux hommes, Lakhal Ayat et Yves Bonnet, que ressort un accord qui vaut « bon de libération » pour Gilles Sydney Peyroles. Un consentement du bout des lèvres me parviendra alors que je repars pour Paris. Mission remplie .
A mon arrivée à Paris, je me précipite dans le bureau de Joxe que l’heureuse issue laisse indifférent puis dans celui de Roland Dumas qui me réserve un accueil aimable alors que mon propre ministre m’avait promis de sa part de sévères remontrances pour l’affaire évoquée plus haut.
Les Libanais tiennent leur parole et Georges Habache intervient pour qu’il en aille ainsi
Du côté français, il en va différemment : étant donné que je ne maîtrise en rien la procédure judiciaire – n’étant pas moi-même officier de police judiciaire.
Un télescopage d’interventions fait qu’alors que Peyroles vient d’arriver à Paris, une perquisition conduite sur commission rogatoire et échappant de ce fait à toute intervention de ma part, amène à la découverte d’une cache des FARL et de l’arme rapidement identifiée comme étant celle des trois attentats et dont le ou les tireurs avaient simplement oublié d’effacer les empreintes digitales.
C’est la catastrophe, imprévisible et inexplicable à des personnes peu au fait des règles judiciaires françaises. Encore une fois, je vais devoir gérer, seul, les conséquences de la « parole non tenue ». Le ministre Joxe m’abandonne totalement, oublieux des devoirs les plus élémentaires du chef comme de ses propres instructions. Plus tard, il aura le front de me dénigrer, en mon absence, et l’Elysée aura l’incroyable audace de prétendre que j’ai agi « à titre personnel » pour la libération de Gilles Sydney Peyroles…. qui ne m’a jamais adressé le plus petit remerciement.
Mon sort n’est guère comparable à celui du chef des FARL : j’y ai perdu de ma crédibilité, lui y a laissé sa liberté. Mais, étant de nature obstinée, je n’ai pas voulu me résoudre à attendre que la Justice, l’immanente, pas celle des hommes, vienne revisiter le dossier et j’ai témoigné autant que j’ai pu, en ressassant la seule version d’une affaire qui aurait mérité une issue moins scandaleuse et inique.
Aucun des autres acteurs français qui auraient pu témoigner de l’accord réellement passé avec les FARL n’a daigné faire preuve de courage ni d’honnêteté. Plus lamentable encore : un de mes successeurs à la tête de la DST a signé une lettre attestant de ce que Georges Ibrahim Abdallah s’était converti à l’islam – ce qui est son droit – et était devenu un propagandiste du djihad – ce qui est plus problématique. Or les deux assertions sont fausses.
C’est une telle forfaiture qui a justifié un rejet de la demande de libération du prisonnier. Quant aux Algériens, ils ont tous disparus.
Yves Bonnet 18 février 2015
Le récit COMPLET de cette affaire est à trouver dans « Contre-espionnage, mémoires d’un patron de la DST » paru chez Calmann-Lévy.