Dernière mise à jour le 10 avril 2015
Il y a un an Alain Finkielkraut était élu à l’Académie française. Retour sur ce personnage dans un portrait signé de l’universitaire Jacques Le Bohech.
Combien coûte une élection à l’Académie Française
Avec l’aimable autorisation de la revue Golias et de l’auteur http://golias-editions.fr/
…« Cette islamophobie n’est sans doute pas sans lien avec la mentalité d’assiégé que l’on rencontre souvent chez les juifs en affinité avec l’état d’Israël, que l’on retrouve aussi chez le philosophe Pierre-André Taguieff »….
Le 10 avril 2014, Alain Finkielkraut a été « élu » à l’Académie française. Le processus s’est déroulé en catimini, sans que le grand public en ait eu vent. Sans doute pour éviter une levée de boucliers à l’encontre de ce candidat qui s’est fait connaître ces dernières années par ses idées rances et erronées. Pourtant, cette institution coûte cher au contribuable une somme qu’on ne veut pas nous communiquer. Les économies budgétaires sont à géométrie variable : on fige le point d’indice des fonctionnaires mais on ne supprime pas une Académie française obsolète dont l’utilité est évanescente.
Quel intérêt en effet y a-t-il à passer plusieurs années à fabriquer des versions successives (huit à ce jour) d’un dictionnaire dont les premières lettres sont rapidement dépassées et à tenter de dire quel est le bon usage quand le Larousse et le Robert s’en chargent avec beaucoup plus de réactivité ? Ainsi, commencé en 1992, les Académiciens en sont actuellement à la lettre R… Cette élection d’A. Finkielkraut n’est cependant pas étonnante.
D’abord, c’est un vieux bonhomme qui va rejoindre d’encore plus vieux que lui qui s’ennuient, certains carrément has been et cacochymes, moqués naguère par Gaston Leroux (Le fauteuil hanté, 1909) racontant l’élection d’un riche commerçant analphabète.
De surcroît, il y a une coïncidence entre l’hybris de cet intellectuel dominant, invité sur tous les plateaux de télévision, consécration suprême…, et un organisme chargé initialement d’unifier et d’imposer la langue française, décrétée immortelle.
C’était en 1635, sous Louis XIII, à l’initiative du cardinal de Richelieu, l’alors premier ministre, un siècle après l’ordonnance de Villers-Cotterêts (1539, sous François 1er), qui obligeait l’administration à employer le français, très minoritaire à l’époque, plutôt que le latin, langue de l’église.
On se situe alors à la fin du processus de sociogenèse de l’état au sens moderne d’organisation hiérarchisée revendiquant deux monopoles, celui de la ponction fiscale et celui de l’usage de la violence physique. La relative paix à l’intérieur du territoire contrôlé par la capitale Paris contre les grands nobles autorise une gestion centralisée et la volonté de la pérenniser en imposant une langue officielle unique.
Si Louis XIV peut dire « L’état, c’est moi » (1655), c’est moins en raison du caractère autocratique du régime que du fait que l’état en tant qu’appareil administratif efficace n’existe pas avant le XVIIe siècle, comme l’ont montré les socio-historiens, notamment Norbert Elias (La dynamique de l’Occident). Dès lors, il n’est guère surprenant qu’un philosophe agrégé de lettres et défenseur acharné de la langue française (au point de tourner à la paranoïa) fasse sont entrée à l’Académie française.
Ironie de l’histoire, le nouveau maire de Villers-Cotterêts (Aisne) est adhérent au Front national (Franck Briffaut) alors qu’A. Finkielkraut a récemment cité cette petite ville comme symbole de l’invasion des immigrés en se trompant ou en exagérant certains faits (il n’y a pas de boucherie halal), sur la base d’un article du Monde de 2012 repris par un site de la fachosphère.
Il n’est pas, en effet, juste un philosophe médiatique, qui officie chaque samedi matin sur les ondes de France-Culture pour dispenser la bonne parole en défense d’une culture qu’il estime menacée de mort, la sienne, érigée en parangon indépassable (ah l’admirable Charles Péguy!).
C’est un propagandiste d’idées souvent qualifiées de nauséabondes, inspirées d’Oriana Fallaci et de Renaud Camus, par exemple dans son dernier livre (L’identité malheureuse), mais qui sont surtout mal fondées et fallacieuses.
Ses propos racistes sur l’équipe de France de football dans le quotidien israélien Haaretz (2005) en font partie : « Les gens disent que l’équipe nationale française est admirée par tous parce qu’elle est black-blanc-beur. En fait, l’équipe de France est aujourd’hui black-black-black, ce qui provoque des ricanements dans toute l’Europe. »
Il est clair que cet homme souffre et qu’il extériorise son malaise par des outrances et des divagations, sans base concrète sérieuse, isolé dans son monde livresque et germanopratin, prisonnier de ses structures mentales intériorisées. Lui-même, fils d’un maroquinier juif polonais émigré puis naturalisé, né à Paris en 1949, n’est pas un « Français de souche » (présent depuis plusieurs générations), mais on connaît cette tendance à magnifier son pays d’accueil à qui l’on doit tout quand on a réussi, à souscrire à une posture jacobine quand on a été éduqué à Paris.
Il doit s’en faire une idée mythifiée et mystique pour se construire existentiellement. La France et l’âge d’or d’A. Finkielkraut n’ont jamais existé, mais il a un besoin socio-psychologique vital de le croire et de l’exprimer de façon colérique et outrancière. Ce n’est que vers la moitié du xxe siècle que le français a été parlé dans toutes les régions métropolitaines.
Le grand-père de l’auteur de ce texte, Louis Le Bohec (1898-1976), blessé de guerre dans les tranchées, ne parlait que le breton vannetais et ne savait ni lire ni écrire, ayant passé son enfance à garder les vaches (malgré la loi Jules Ferry de 1884 sur l’école gratuite, laïque et obligatoire en français). Les sous-officiers français se méfiaient des paysans bretons, ne comprenaient pas ce qu’ils disaient et les plaçaient en première ligne, comme les Corses et les soldats venus des colonies. En 1914-1918, les Antillais étaient abasourdis que les Bretons, pourtant métropolitains, parlaient très peu le français.
Les Bretons, issus de tribus celtes qui ont traversé la Manche au Ve siècle et qui pour certains manifestent pour le rattachement de Nantes à la Bretagne ce samedi 19 avril, sont-ils des « Français de souche » pour A. Finkielkraut ?
On dirait qu’A. Finkielkraut se sent menacé par les immigrés d’obédience musulmane en se focalisant sur quelques faits triés, détournés voire inventés, sans aller voir comment cela se passe véritablement, les stratégies des beurettes, par exemple. Il attribue à des facteurs culturels les maux de la société (émeutes de Villers-le-Bel) tout en fustigeant le déterminisme par ailleurs ; tout est bon quand il s’agit de purger son malaise.
Cette islamophobie n’est sans doute pas sans lien avec la mentalité d’assiégé que l’on rencontre souvent chez les juifs en affinité avec l’état d’Israël, que l’on retrouve aussi chez le philosophe Pierre-André Taguieff. De plus, tout se passe comme si le fait d’être resté en France devait être justifié par une adhésion à une image idéalisée de ce pays, une déclaration d’amour appuyée pour sa culture et une conception unifiée et jacobine de celle-ci (d’où l’obsession de la pureté de la seule langue officielle).
Le fait qu’A. Finkielkraut soit juif semble l’immuniser contre l’accusation de proximité ou de similarité avec les idées d’extrême droite et lui-même s’est bien gardé d’appeler à voter en faveur du Front national canal historique. Mais ses propos ne laissent guère de doutes sur ses accointances avec elles, à l’exception de l’antisémitisme. Surtout, ses obsessions identitaires l’empêchent, non seulement de (sa)voir ce qui se passe réellement, mais de comprendre les véritables causes et raisons des phénomènes dont il se lamente. Le terroriste norvégien, Anders Behring Breivik, dans ses délires paranoïaques, s’est beaucoup inspiré de ses livres.
Sa grille de lecture ressemble à une passoire à thé. Il préfère s’en tenir à des impressions partielles et fugaces, sans faire d’enquête. Michel Wieworka lui rétorque : « Ses propos sont devenus de plus en plus incantatoires et éloignés des réalités. Ils ont été démentis par le fonctionnement même des institutions françaises. » Mais ses lectures et ses impressions semblent lui suffire, surtout en faisant dire à ses ennemis des choses qu’ils ne disent pas.
Ses dénonciations de l’école décadente entravent la mise au jour de solutions efficientes pour que l’école réussisse auprès des classes moyennes et populaires ; mais est-ce vraiment ce qu’il souhaite compte tenu de l’aristocratisme culturel qu’il affiche ?
Il construit autour de lui un mur intellectuel qui l’empêche de s’ouvrir à une compréhension et une explication plus pertinentes. En cela, il fonctionne de façon mécanique, sous l’emprise de contraintes subies et incorporées durant son cursus scolaire, devenues des automatismes de pensée dont il ne peut se défaire.
C’est pourquoi il refoule les savoirs des sciences sociales, qu’il se définit « anti-moderne ». Il est tellement enfermé dans une logique autistique que les critiques dont il est l’objet ne peuvent que justifier ses convictions. Il est d’ailleurs sans arrêt en train de se définir, d’afficher une posture, d’affirmer des principes.
Ce psittacisme trahit un malaise profond qui vient du décalage intervenu depuis son cursus scolasticum honorum, autrement dit l’absence des classes moyennes et populaires dans les filières élitistes qu’il a fréquentées et sa réussite de bon élève dans ce qui était prestigieux dans les années 1950 (Henri IV, EN Saint-Cloud, agrégation lettres modernes) : les anciennes matières rangées dans les humanités classiques. Mais patatras ! Deux changements majeurs sont intervenus : la « démocratisation » de l’enseignement supérieur et l’obsolescence des anciennes matières consécutive à l’arrivée des sciences sociales (sociologie, sciences de l’éducation, science politique, etc.).
Il a donc subi un désajustement progressif entre ses structures mentales personnelles et les structures sociales du champ où il est conduit à évoluer professionnellement. Il n’a pas su ni voulu prendre le train en marche ou tenter de s’adapter, comme l’ont fait Roland Barthes, Jean-Paul Sartre, Raymond Aron, Michel Foucault, Louis Althusser, Umberto Eco, Pierre Bourdieu ou Gilles Deleuze.
Il est beaucoup plus proche de la génération suivante de philosophes désappointés par la pression intellectuelle des sciences sociales et de la psychanalyse sur la philosophie, qui sonne comme une dépossession et une marginalisation : Bernard-Henri Lévy, André Glucksmann, Luc Ferry, Élisabeth de Fontenay, Michel Onfray, etc. Nul doute qu’il aurait pu signer le livre La pensée 68. Essai sur l’anti-humanisme contemporain, de Luc Ferry et Alain Renaut (Seuil, 1986) ; il emploie d’ailleurs l’expression.
Par « anti-humanisme », il faut entendre le dépassement des humanités classiques. Ce livre opérait une analyse de mauvaise foi de quatre penseurs qui les perturbaient : M. Foucault, Pierre Bourdieu, Gilles Deleuze et Félix Guattari. En revanche, le philosophe Emmanuel Lévinas, demeuré dans un monde intellectuel fait de théologie et de spéculation philosophique, lui est bien plus sympathique ; il a même créé, avec Benny Lévy et Bernard-Henri Lévy, un Institut d’études lévinasiennes à Jérusalem.
A. Finkielkraut est clairement déstabilisé par tous ces changements, tellement qu’il s’évertue à diminuer le décalage de toutes les façons, en revalorisant ce qui est devenu obsolète. Il dispose de ressources pour cela. Son élection à l’Académie française, symbole de cette France soi-disant éternelle dont il a besoin, se comprend ainsi. Son affectation à la très militaire et élitiste école polytechnique aussi.
Idem pour ses invitations d’auteurs dans son émission de radio qui ne risquent pas de déstabiliser son confort intellectuel étriqué et renfermé, surtout qu’il ne laisse pas beaucoup les autres parler. Ses plaidoyers et ses prédications anti-multiculturalistes ont la même fonction de diminution du décalage insupportable (alors qu’il est paradoxalement intégré dans la communauté juive). Il écarte tout ce qui ne rentre pas dans la grille de lecture en phase avec ses obsessions. Il se contente de brasser des notions abstraites et polysémiques (république, laïcité, nation, etc.) et des mots en « isme » en les accompagnant d’une gestuelle et d’un ton grandiloquents et autocentrés (il s’écoute parler).
Ses automatismes de pensée l’enferment dans des raisonnements déductifs et abstraits où il peut déblatérer à loisir sur le mode de la conversation de bistrot. Tout son parcours scolaire prestigieux le persuade qu’il ne peut qu’avoir raison par définition. Quand on est passé par un tel cursus, on est prédisposé à se croire compétent en tout, surtout qu’il s’arrange pour refouler et négliger les démentis à ses assertions à l’emporte-pièce. Ces stratagèmes lui conviennent faute de mieux. Mais il n’est pas certain que ce sectarisme crispé, ces approximations ignorantes et cette malhonnêteté intellectuelle soient la meilleure manière de promouvoir les lettres, le français et la philosophie auxquelles il semble tant tenir.
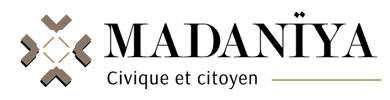


L’une des raisons et non des moindres selon moi du silence médiatique qui a accompagné la cérémonie d’intronisation de ce Sieur à l’Académie Française, est l’identité de son prédécesseur, celui dont il prend la relève, celui dans le fauteuil duquel il s’assoit : j’ai nommé un autre triste Sire : Félicien Marceau. Ecrivain collaborationniste s’il en fût. Ce qui, avouez-le, fait un peu désordre ! Dommage, car j’aurais aimé entendre l’hommage que tout nouvel élu doit faire de son prédécesseur.