Dernière mise à jour le 12 juillet 2016
Après la stupeur provoquée par la fronde populacière du 23 juin, les dirigeants de l’Union Européenne s’emploient à faire comme si de rien n’était, l’essentiel étant de perpétuer l’ordre des choses tout en tentant de limiter les dommages collatéraux.
Faisant de nécessité vertu, ils appliquent alors un raisonnement qui est celui de la branche pourrie. Pour conjurer le risque de contagion qui menace l’édifice branlant échafaudé depuis trente ans, ils ne veulent voir dans l’amputation du membre félon qu’un inconvénient passager.
L’important, c’est que les affaires reprennent et que rien ne change, à 27 comme à 28.
Tentation du statu quo
Pour la Commission, solder les comptes du Brexit permettra bientôt de le réduire au statut inoffensif de mauvais souvenir.
Au prix d’une mutilation dont le préjudice est jugé surmontable, on entend bien perpétuer ad libitum l’espace mirifique du grand marché et en maintenir les règles, comme si rien de substantiel ne devait l’affecter.
À ceux qui ne l’auraient pas compris, Jean-Claude Juncker a d’ailleurs adressé une formidable leçon de choses en annonçant, dès le lendemain du vote britannique, la poursuite des négociations sur l’instauration du libre-échange avec le Canada.
De leur côté, les partisans du fédéralisme se réjouissent secrètement de la défection d’un État qui constituait une pièce rapportée de la construction européenne. Et s’imaginant sans doute que l’UE y gagnera en cohésion, ils font la promotion d’un projet éminemment progressiste consistant à pousser les feux de l’intégration au moment même où un peuple d’Europe vient de la rejeter.
Ce projet repose, il est vrai, sur un mythe tenace qui refait surface à chaque crise comme un serpent de mer, et qui se présente comme la solution rêvée aux déraillements récurrents de la machinerie communautaire.
Ce mythe tenace, on le sait, c’est la transformation progressive de l’UE en un véritable État fédéral, au nom d’une communauté de destin supposée entre les peuples du Vieux Continent.
Haro sur l’État-nation
Perspective radieuse sur le papier, mais au prix d’une sérieuse prise de distance avec le monde réel. Ignorant toute profondeur historique, ses partisans font comme si la fabrication d’une entité supranationale pouvait damer le pion à des nations millénaires.
Biffant d’un trait de plume technocratique l’histoire et la géographie, ils voient dans l’État-nation, au mieux, la butte-témoin d’un âge révolu. Ils y discernent avec dédain une sorte de survivance archaïque promise à l’étiolement, voire un simple catalogue d’us et coutumes révocable à loisir sur injonction bruxelloise.
C’est pourquoi ils espèrent l’avoir à l’usure. Avec le rouleau compresseur de l’intégration, ils veulent le faire disparaître, cet État-nation qui sent le moisi. Pour prémunir le capital de ses foucades démocratiques, ils lui substituent patiemment, depuis trente ans, un artefact dont l’obéissance aux marchés est garantie sur facture. L’État-nation est déjà privé de sa monnaie ; sa politique budgétaire est corsetée par des règles absurdes ; on lui interdit toute politique industrielle ; il est assujetti à des directives soustraites à la délibération populaire, mais ce n’est pas suffisant ! Par de nouveaux transferts de souveraineté que l’on justifiera en agitant l’épouvantail du populisme ou en brandissant l’étendard de la modernité, le fédéralisme n’aura de cesse de le mettre complètement à poil.
Le lit de Procuste
Peu importe que la réalité historique des États-nations, attestée par la permanence des référents symboliques qui définissent le génie national, passe par pertes et profits du grand projet unificateur. Les langues nationales seront remplacées par l’anglais, et la culture originale dont témoignent ces idiomes ancestraux sera bientôt diluée dans les prétendues valeurs communes d’une Europe adonnée au Veau d’or. Comme le lit de Procuste, l’euro-fédéralisme coupe tout ce qui dépasse ! Il rêve d’annihiler les différences nationales pour les fondre dans un magma insipide dont le résultat prévisible sera, au mieux, la condamnation des Européens à l’impuissance collective.
Voulue par les concepteurs de l’Union, cette impuissance n’est pas un raté du système, elle en est l’essence même. En flouant la souveraineté nationale, en déniant à l’État le pouvoir de mener sa politique, le fédéralisme anéantit la volonté populaire. Car si un État ne peut plus décider de sa politique, on ne voit pourquoi il faudrait demander au peuple d’en délibérer. Les euro-fédéralistes le savent mais ils n’en ont cure : tuer l’État-nation, c’est tuer la démocratie. La nation, en effet, est le cadre ordinaire dans lequel un peuple peut s’imposer les lois de son choix, en changer si bon lui semble, et élire les dirigeants à qui il confie le soin de les appliquer.
Par une supercherie dont l’UE est la caricature, les fédéralistes entendent substituer à des États-nations historiques dans lesquels les peuples se reconnaissant une supra-nation dont personne n’a la moindre idée. Dans cette construction idéologique, le projet chimérique de l’État fédéral européen sert de paravent à une démolition en règle des corps collectifs dont l’État-nation est la clé de voûte. Au nom d’un super-État imaginaire, on entend saper l’existence de ces formes d’organisation collective qui ont fait l’Europe moderne, malgré les attaques qu’elles subissent désormais de la part des commis du capital.
Le modèle américain
Que l’Europe politique ait eu pour promoteur Jean Monnet, homme d’affaires travaillant pour les États-Unis, rappelle que la construction européenne est un projet made in USA. Car elle avait et elle a toujours pour finalité essentielle l’assujettissement de l’Europe occidentale, formidable réservoir d’hommes et de marchés, à l’hégémonie américaine. Mieux encore, les fédéralistes européens prennent les États-Unis comme modèle, comme si les deux continents avaient des histoires comparables. Ce faisant, ils s’aveuglent sur les vertus de cette comparaison. Car ils oublient que c’est le vide des grands espaces américains, purgés de leurs indigènes récalcitrants, qui donna aux États-Unis leur cohésion, leur permettant d’absorber les vagues d’immigration successives en provenance du Vieux Continent.
S’il y a une nation américaine, c’est parce qu’elle est dès l’origine la projection de l’Europe vers son propre occident et qu’elle s’est déployée depuis un centre, le Nord-Est des Pères fondateurs, vers une périphérie qui fut une terre de conquête.
Ce qui a fait l’unité américaine, c’est cette vacuité de l’espace. Terre sans histoire (autre que l’histoire à venir), l’Amérique a offert la virginité de ses plaines fertiles au labeur acharné de ses pionniers. Il est plus aisé, pour une communauté humaine, de forger son unité dans une géographie sans histoire que dans une géographie qui en est pleine, dans un espace vierge que dans un lieu déjà saturé de sens. Moyennant la destruction cynique des sociétés indiennes, la nation américaine a saisi cette chance.
L’alibi fédéraliste
Entre les États-Unis et l’Europe, comparaison n’est donc pas raison. Le terreau de la construction européenne est encombré d’histoire, tandis que celui de la nation américaine était déblayé avant usage. La mémoire européenne est pleine, celle de l’Amérique cherche désespérément à se remplir. L’Amérique a fait de l’un avec du vide, et elle s’est contentée de le remplacer. L’Europe veut faire de l’un avec un multiple saturé qui lui colle à la peau.
L’Amérique s’est bâtie sur une géographie sans histoire (européenne), l’Europe entend bâtir son avenir, mais en composant avec son passé. C’est pourquoi l’idée européenne a bien un sens, mais ce n’est pas celui que veut lui imposer au forceps l’idéologie fédéraliste.
L’euro-fédéralisme, en réalité, n’est pas un projet, mais un alibi. C’est une machine de guerre visant au désarmement unilatéral des souverainetés populaires, une tentative obstinée d’évidement, sous des prétextes humanistes, de ce qui constitue le substrat de la démocratie moderne.
Vêtu des oripeaux du pacifisme, de l’humanisme et du progressisme, sa logique infernale accoucherait immanquablement de leurs contraires. En ramenant au plus petit dénominateur commun des volontés populaires privées de leur cadre naturel, l’euro-fédéralisme, s’il parvenait à ses fins, porterait le germe des affrontements qu’il prétend empêcher.
Rien de bon pour les peuples européens ne sortira jamais du lit de Procuste.
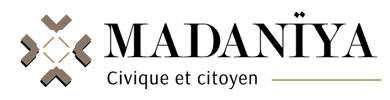


En tant qu’eurofédéraliste et opposant au Traité établissant une Constitution pour l’Europe, j’adhère à tout ce qui est écrit dans cet article…hormis la qualification d’eurofédéralisme. Une fédération, c’est une entité politique où les compétences sont réparties entre une autorité fédérale dotés des moyens d’un Etat et des entités fédérées qui exercent leurs compétences librement, sans tutelle de l’autorité fédérale. Une confédération n’est pas une fédération: elle n’a pas d’autorité fédérale. Un Etat décentralisé n’est pas une fédération.
L’Union européenne n’est pas une fédération puisque le cadre institutionnel européen n’est pas un Etat fédéral démocratique. Un: C’est une organisation incapable d’assumer les missions d’un Etat et dont les fonctionnaires ne veulent pas assumer les missions publiques vitale. Deux: Le cadre institutionnel a le niveau de démocratie de la République française de 1852. Trois: la commission européenne est dotée d’un pouvoir de tutelle budgétaire sur les Etats membres qui ont adopté le traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance, pratique abolie par la terrible France jacobine en 1982. Vu la façon dont se comporte les eurocrates vis à vis des Etats membres, on peut dire que ceux-ci sont bien plus mal traités qu’une collectivité territoriale française. Où est l’eurofédéralisme dans ce montage?
Par ailleurs, la volonté d’imposer l’ultralibéralisme économique le plus poussé et de remplacer les Etats-nations actuels par des Etats-région n’a aucun rapport avec le fédéralisme. La part de l’intégration européenne qui est pratiqué par le biais des institutions communautaires de l’UE est une intégration atlantiste et anarchocapitaliste, sans rapport avec l’eurofédéralisme. Il existe également différents courants dans le fédéralisme. Les Américains distinguent ainsi le fédéralisme jacksonien, wilsonien, jeffersonien et hamiltonien. Les Européens plébiscitent régulièrement les Etats-Unis d’Europe dans les sondages d’eurostat mais lequel?
Des « fédéralistes » tels que ceux qui postent des articles sur le Taurillon sont, au mieux, des fédéralistes hamiltoniens: le fédéralisme n’est qu’un marchepied vers un Etat européen centralisé. Je pense que l’Européen de la rue, lui, veut plutôt une fédération avec des entités fédérés, dont les entités fédérés sont les 27 Etats-nations et non leur région, dont les institutions fédérales respectent au moins les minima de démocratie représentative, dont le programme est fixé tous les ans par des parlementaires élu et pas gravé dans le marbre de la Constitution. Il y a une différence entre être eurofédéralistes et un béni oui oui de la commission.
A ce sujet, lire par exemple les réactions à cet article du Taurillon: https://www.taurillon.org/Francois-Bayrou-refaire-du-sujet-europeen-un-sujet-politique