Dernière mise à jour le 15 septembre 2016
La contestation syndicale française contre la Loi el Khomry, lors du printemps et de l’été 2016, remet en lumière la condition ouvrière dans les pays capitalistes, particulièrement aux États-Unis. madaniya.info soumet à l’attention de ses lecteurs cette étude de Loren Goldner sur «La lutte des Classes aux États-Unis depuis le Krach de 2008»
Et pour aller plus loin, cet article prophétique de l’ancien premier ministre français et fondateur de la «deuxième gauche» Michel Rocard «Resister aux sociétés multinationales» : http://www.monde-diplomatique.fr/1973/02/ROCARD/31334
La lutte de classes aux États-Unis depuis le krach de 2008
Revue, Échanges. N°138. Automne 2011. Par Loren Goldner.
Depuis juillet [2011], les médias dominants parlent de plus en plus fréquemment d’une «récession» «à double plongée» aux États-Unis. Mais nous pouvons affirmer sans crainte que, pour la plupart des travailleurs, la «récession» n’a jamais pris fin, et qu’elle va s’aggraver.
ANTÉCÉDENTS
Pour comprendre la lutte des classes aux États-Unis depuis la crise financière de 2007-2008, il nous faut d’abord rappeler brièvement l’histoire des quatre décennies précédentes, depuis la fin de l’insurrection des dernières années 1960 et du début des années 1970.
Comme on le sait, depuis 1973 environ, l’histoire de la classe ouvrière américaine est celle d’une régression et d’une suite quasiment ininterrompue de défaites. On l’a décrite comme «une guerre des classes au cours de laquelle un seul camp se battait». Pendant cette période, les salaires réels ont baissé de 15 % au bas mot et dès 1960 on a assisté à la disparition de la famille ouvrière vivant sur un salaire unique.
De nos jours, il faut 2 ou 3 salaires à la famille ouvrière typique, dont un pour couvrir les frais de logement (50 % du revenu du foyer). La semaine de travail moyenne s’est allongée d’au moins 10 % pour ceux qui ont un travail à temps plein ; en réalité la force de travail ressemble de plus en plus à «la société en forme de sablier», avec une couche de «professions libérales» qui travaillent 70 heures par semaine et une majorité de la population précarisée par des emplois intermittents à temps partiel.
Pendant la même période, les 10 % de la population formant la couche supérieure se sont vu attribuer environ 70 % de toutes les augmentations de revenu. Et on sait bien aussi que de vastes régions du nord-est autrefois industriel ont été transformées en «poubelles», où les emplois de «service» peu rémunérés et sans avenir (par exemple Walmart) se substituent aux anciens emplois ouvriers relativement stables et correctement payés.
États-Unis et Corée du Sud : Les lieux de travail les plus dangereux du monde capitaliste «avancé».
Les États-Unis ont, avec la Corée du Sud, les lieux de travail les plus dangereux du monde capitaliste «avancé» : 14 travailleurs y meurent quotidiennement. 2% de la population (sept millions de personnes) (1), majoritairement des Noirs et des Latinos, sont en attente d’un jugement, en prison ou en libération conditionnelle, surtout à cause de la «guerre contre la drogue». Des centaines de milliers de personnes perdent leur logement après avoir perdu leur travail, le nombre des sans-abri monte en flèche, et la «guerre contre les pauvres» s’intensifie par le harcèlement policier, l’entassement des gens dans des refuges sordides semblables à des prisons et la criminalisation de ceux qui vivent dans la rue.
Revue de détails de la réalité sociale dans «le pays le plus riche du monde».
I – LE DÉCLIN DE LA GRÈVE
Face à cette offensive capitaliste depuis la décennie 1970, et sans parler de la grève sauvage, la grève classique est devenue quasi inexistante. 20 % des travailleurs américains ont participé à une grève ou un lock-out chaque année au cours des années 1970 contre seulement 0,05 % en 2009. Les vieux syndicats industriels ont été sérieusement affaiblis par la désindustrialisation ; ils représentaient 35% de la main-d’œuvre en 1955 mais seulement 12% aujourd’hui, et la plupart de ceux qui existent encore sont des syndicats du secteur public. (Afin de dissiper toute ambiguïté, je précise que jusqu’en 1973, la plupart des grandes centrales syndicales luttaient contre les mobilisations sauvages de la base et pas contre les capitalistes. Il n’en reste pas moins que la diminution du nombre de leurs adhérents est due en partie à leur incapacité à assurer même ce «syndicalisme de négociation» qui les caractérisait au cours des années 1970.)
Lorsqu’ils font grève, les travailleurs qui ont encore des emplois permanents, des salaires décents et une couverture sociale, restent, presque sans exception, dans les limites de la légalité et des «cellules de négociation» dont les objectifs sont étroitement déterminés et leur assurent la défaite avant même d’engager la lutte.
II – ENDETTEMENT DES CONSOMMATEURS EN CASCADE
Après les années 1970, la classe ouvrière américaine et la «classe moyenne» (terme truffé d’idéologie qui se réfère au moribond «rêve américain» d’un travail stable, d’un logement à soi et d’une retraite décente) ont compensé la baisse des salaires réels en s’endettant de plus en plus.
Dès la décennie 1990 s’y est ajoutée la bulle immobilière, propagée par le mythe promotionnel des médias («les prix de l’immobilier ne baissent jamais») et grossie, dans les années 2000, par la bulle des sub-primes. C’était l’époque où presque tout le monde pouvait obtenir un prêt et acheter son logement, ou obtenir un second prêt, et utiliser ces «avoirs» imaginaires pour obtenir encore plus de crédits. La «relance» suite à la dégringolade de la bulle informatique de 2000-2003 était en grande partie liée au secteur de la construction et de ses industries satellites, ameublement et électro-ménager par exemple.
Cet empilement de dettes de consommation par les travailleurs, qu’ils soient ouvriers ou du secteur tertiaire, suivait en parallèle l’augmentation jusque-là inouïe de la dette de l’État (État Fédéral, états régionaux ou municipalités), ainsi que la dette extérieure des États-Unis (total net des dollars détenus à l’étranger, moins les actifs américains à l’étranger) qui s’élève à plus de 10 000 milliards de dollars.
Ainsi, avec l’éclatement de la bulle immobilière en 2007, suivi en 2008 par des convulsions dans le secteur bancaire, l’irruption de la crise ne fut que le point culminant d’un long processus d’atermoiement par une cascade de dettes depuis les années 1970, révélant une crise du profit sous-jacente (et finalement de la valeur au sens que lui donnait Marx) dans l’économie «réelle». Mais c’est une autre histoire, qui n’a pas sa place dans cet article.
III – LA DYNAMIQUE POLITIQUE
Pour avoir une vue globale du climat social, il ne faut pas négliger l’élection de Barack Obama en novembre 2008 (il a probablement été élu grâce à l’irruption de la crise en octobre, quelques semaines auparavant). Comme en 1929-1934, la majorité des Américains ont d’abord réagi au krach par un silence abasourdi.
Obama, que la «droite» (le Parti républicain et, depuis deux ans, le Tea Party, faction de droite radicale des Républicains) dénonce comme «socialiste» (et aussi comme «musulman» et même «marxiste»), a en fait mis en œuvre des politiques plus à droite que son prédécesseur George W. Bush dans presque tous les domaines. La réaction à ces politiques est restée très feutrée car sa base libérale (au sens américain du terme) a accordé le bénéfice du doute à son gouvernement.
Obama a intensifié la «guerre contre le terrorisme» qui s’est de plus en plus souvent étendue à l’opposition intérieure ; il a enfoncé le pays dans ses guerres perdues d’avance au Moyen-Orient (Irak, Afghanistan) et dans les bombardements du Pakistan au moyen de drones.
Dans son «équipe économique» figuraient des tueurs à gage connus comme Lawrence Summers (qui, en tant que sous-secrétaire au Trésor, avait supervisé le matraquage de la Corée du Sud lors de la crise asiatique de 1997-1998), Paul Volcker (qui, en tant que directeur de la Banque de réserve fédérale, avait géré la profonde récession de 1979-1982), et Tim Geithner (ancien directeur de la Banque de réserve de New York).
Cette équipe a organisé les sauvetages colossaux des banques qui s’écroulaient et des institutions immobilières en garantissant à 100 % des milliards de dollars de prêts pourris, tout en ne faisant rien, ou très peu, pour les travailleurs, sans parler des sans-abri et d’une population en voie de marginalisation.
La «réforme» orwellienne de la santé par Obama (elle aussi dénoncée comme «socialiste») a été pratiquement rédigée par les grandes compagnies privées d’assurance-santé qui dominent le système de santé américain rétrograde.
En décembre 2010, Obama a prolongé le versement des allocations de chômage en «passant un marché» avec le Congrès qui a aussi reconduit les abattements d’impôts consentis aux riches par Bush et qui avaient coûté au gouvernement fédéral une perte de revenu fiscal de 200 milliards de dollars par an chaque année depuis 2001, cependant que les guerres en Irak et en Afghanistan ont coûté 1,5 milliard de dollars, sinon plus.
Son administration a supervisé plus d’expulsions d’immigrants illégaux que pendant toutes les années Bush, frappant le plus durement les Latino-Américains marginaux arrivés dans le pays avant 2007 lors du boom immobilier pour travailler dans le bâtiment, et qui ont perdu leur travail quand ce secteur s’est effondré.
En juin et juillet, à l’occasion de la comédie qui se jouait à Washington au sujet du déficit fédéral américain, la minorité de droite radicale (Tea Party), grâce à son énorme influence à la Chambre basse du Congrès, a couvert un nouveau virage à droite d’Obama en prévision de coupes importantes dans les «droits sociaux» – autre expression bourrée d’idéologie pour désigner les soins médicaux pour les pauvres et les personnes âgées et le système de sécurité sociale des retraités. Tout ceci pour illustrer le rôle historique du Parti démocrate, qui est de mettre en place des politiques qui se heurteraient à une forte opposition si elles émanaient des Républicains.
IV – LE BON ET LE MÉCHANT
On a dit que le système américain était composé d’un parti de droite et d’un parti d’extrême droite. Depuis les années 1880 au moins, les deux partis dominants jouent la comédie du bon et du méchant. La moitié la plus pauvre de la population ne vote pas et la politique institutionnelle n’est plus qu’un jeu de pure forme qui nourrit la passivité et le cynisme de tous.
C’est un des éléments du contexte qui explique des phénomènes aussi bizarres que le Tea Party actuel. Lorsque les gens se rassemblent pour protester, le populisme de droite, et plus rare aujourd’hui, celui de gauche (la révolte du «petit») sont les premières soupapes de sécurité du système.
Le Tea Party a émergé en tant que force à l’aile droite du Parti républicain dès 2009 et il exprime, mieux que les autres regroupements politiques organisés, la rage populiste de droite qui fait partie du paysage politique américain depuis la fin de la décennie 1970 de manière intermittente. À ma connaissance, il n’y a pas d’équivalent notable de l’idéologie du Tea Party en Europe. Il représente «une fraction en déclin de la démographie» : des Blancs âgés, de la classe «moyenne» ou «moyenne-supérieure», qui s’imaginent que les problèmes de l’Amérique peuvent être résolus grâce au strict équilibre du budget à tous les niveaux du gouvernement, et donc grâce à un «minimum d’État» supervisant un «libre marché» sans entraves.
Une telle économie n’a jamais existé, même avant 1914 lorsque l’État ne représentait qu’une part réduite du «PIB», mais jouait tout de même un rôle central dans la politique tarifaire, l’éviction des Indiens en faveur de l’expansion de l’économie esclavagiste du Sud, ainsi que dans l’appropriation des terres pour la construction des chemins de fer et des canaux.
Bien entendu, le contenu concret de cette illusion du Tea Party renforcerait beaucoup un État répressif et le maintien de l’empire américain (en déclin) par des moyens militaires, tout en ravageant ce qui demeure des aspects «sociaux» de l’État, que la droite radicale américaine associe au New Deal «socialiste» des années 1930 et à la «Bonne Société» de Lyndon Johnson dans les années 1960.
Sa base sociale, blanche dans son écrasante majorité, révèle le programme véritablement racial bien que sous-entendu (en grande partie) de personnes que les tendances démographiques (la population blanche serait minoritaire en 2050), et un président noir, effraient. La véritable fonction du Tea Party dans la politique américaine est de permettre au «centre» (Obama et consorts) de virer de plus en plus à droite, permettant ainsi au «centre» d’apparaître comme une alternative rationnelle et sensée aux «fondamentalistes du marché».
Il est important de signaler que la conviction quasi universelle qu’une élite, banquiers ou régulateurs de l’État, est «responsable» de la crise, étouffe toute analyse sérieuse de la «crise de la valeur» sous-jacente, dont les banques, le crédit pour la consommation, les bulles immobilières ou la régulation des États ne sont que des épiphénomènes.
En novembre 2010, la rage populiste de droite à l’encontre des mesures «socialistes» d’Obama (le sauvetage des banques, la «réforme» de la santé, les faibles tentatives, symboliques surtout, de régulation de la finance par les États) a considérablement avantagé les Républicains dans les deux chambres du Congrès en éliminant une majorité démocrate à la Chambre (basse) des représentants et en s’emparant presque du Sénat. Une bonne partie de la base d’Obama de 2008, déçue (ou dégoûtée) par son action en faveur du grand capital sans trop s’en cacher, est restée chez elle. (Il ne faut pas négliger la rage populiste de droite contre la peau noire d’Obama, qui s’exprime rarement publiquement.)
V – «RÉCESSION» ET RÉSISTANCE FEUTRÉE
Depuis l’automne 2008, le taux de chômage aux États-Unis a atteint 9,1%, et il est très vraisemblablement plus proche de 15%, ces chiffres étant constamment «révisés» en excluant quiconque travaille une heure par mois ainsi que les millions de personnes qui ont renoncé à l’idée de trouver du travail.
Des centaines de milliers de gens ont perdu leur logement après avoir perdu leur travail, particulièrement dans les anciennes régions du «boom», comme Central Valley en Californie, Las Vegas ou la Floride ; des millions d’autres sont titulaires de prêts «noyés» (plus élevés que la valeur réelle de leur bien). Les maisons vides s’accumulent depuis des années et les prix de l’immobilier continuent à baisser. Au moment où j’écris – fin août 2011 – les Bourses mondiales sont fortement secouées et ces chiffres pourraient devenir caducs dans quelques jours.
Pour en revenir à l’écroulement du secteur immobilier, on est frappé par l’absence presque totale de résistance collective face aux saisies et aux évictions. Cela contraste fortement avec le début des années 1930 lorsque, par exemple, dans la ville de New York, des milliers de gens se rassemblaient pour protéger les voisins menacés d’expulsion, ou bien dans les zones rurales où des fermiers, souvent armés, tentaient de protéger leurs terres contre la saisie par les banques. Un camarade, dans l’une des villes les plus économiquement dévastées (Baltimore, Maryland), qui décline tout autant que Détroit depuis les années 1970, relate que la grande majorité des expulsés et victimes d’une saisie ont simplement «honte» de leur situation, la cachent à leurs voisins et partent la nuit sans faire de bruit.
Illustration
«Lunch atop a skyscraper» / Daily Sunny via Flickr CC License by
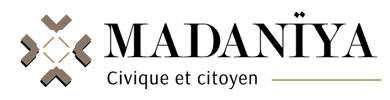


Cher René ,
Très bon article sur la classe ouvrière américaine. Un ami CGT et moi même nous l’amplifions.
Merci pour la qualité …. Ernesto