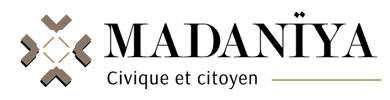Dernière mise à jour le 10 août 2017
J’ai découvert Gramsci1 en 1979, à Rome. A Paris, où je résidais auparavant, j’avais lu en traduction quelques textes de sa période turinoise, qui m’avaient laissé sur ma faim. Je savais que son œuvre maîtresse était les Cahiers de prison, mais elle n’était pas encore traduite en français. Installé en Italie, après quelques mois passés à apprendre la langue du pays, j’ai donc acheté les Quaderni del carcere et commencé à les étudier.
Ni sur la forme – l’ouvrage est une succession de fragments plus ou moins longs sur plusieurs milliers de pages –, ni sur le fond, je n’avais jamais rien rencontré de semblable dans la littérature marxiste classique qui avait jusque-là structuré l’essentiel de ma formation politique.
Les premiers instants de dépaysement passés, j’ai été littéralement captivé par l’ampleur, la puissance et la nouveauté radicale de la pensée qui s’offrait à moi.
Une douzaine d’années plus tôt, à Tunis, en m’immergeant dans la lecture du Capital, j’avais également vécu un grand moment d’excitation intellectuelle. Mais les choses n’étaient pas du même ordre.
Avec Marx, l’excitation était en quelque sorte purement cérébrale, abstraite, désincarnée. Je découvrais les ressorts souterrains qui déterminaient le fonctionnement du système économique régissant le monde.
Avec Gramsci, je n’étais plus dans le sous-sol, mais à l’air libre. Je n’étais plus dans les «infrastructures», mais dans les «superstructures». C’est-à-dire dans les domaines de la culture, de l’idéologie, de la politique, de la guerre, des représentations, des émotions, des passions – là où, justement, les groupes sociaux réels et les hommes en chair et en os évoluent, là où ils vivent, là où ils luttent, là où ils apparaissent puis disparaissent, en laissant parfois la marque de leur passage.
Et comme l’analyse des superstructures est toujours liée, chez lui, à la prise en compte du poids des infrastructures, on aboutissait, par son intermédiaire, à une image plus complète de la réalité, et l’on se trouvait doté d’un mode opératoire plus efficace pour la comprendre et agir sur elle.
Gramsci n’aurait certainement pas été Gramsci sans Marx, mais Gramsci a été plus loin que lui. Dans mon panthéon personnel, je le place en tout cas très haut dans l’échelle de l’intelligence humaine, comme je le place très haut pour son amour du peuple et son dévouement à la révolution.
Un autre facteur explique la permanence de mon intérêt pour lui. Gramsci est né en 1891, une vingtaine d’années après la réalisation de l’unité italienne. Dans le contexte de l’époque, par comparaison notamment avec la Grande-Bretagne et la France, il naît et grandit dans un pays arriéré, retardataire, situé à la périphérie du capitalisme central existant alors.
L’Italie éprouvait depuis longtemps de grandes difficultés à édifier son État national et à parachever sa transformation démocratique-bourgeoise. Sa conversion au capitalisme apparaissait comme une urgence existentielle, non parce que les conditions de cette transformation étaient réunies en son sein, mais parce que le capitalisme s’était déjà implanté dans des États voisins et que cette implantation, en modifiant brutalement les rapports de force, constituait désormais une menace. Comme tous les États moins évolués, l’Italie était placée dans l’obligation de combler son retard si elle ne voulait pas être condamnée à la dépendance et à la subordination.
La conscience du retard historique de son pays et la recherche des moyens nécessaires pour le combler sont au cœur de la réflexion théorique de Gramsci dans les Quaderni del Carcere, comme elles sont au cœur de la réflexion des autres penseurs et hommes politiques italiens de son temps (Benedetto Croce, Giovanni Gentile, ou encore Vincenzo Cuoco, leur prédécesseur). La célèbre distinction qu’il introduit entre révolution active (celle qui se produit dans les pays du capitalisme central) et révolution passive (celle qui se déroule dans les pays périphériques) en est l’illustration directe.
En tant que Tunisien, en tant que Maghrébin, en tant qu’Arabe, je suis moi-même, comme vous tous, citoyen d’un pays retardataire et dépendant. Vous comprendrez par conséquent pourquoi la lecture des Cahiers a pu à ce point m’intéresser, pourquoi elle a pu à ce point entrer en résonnance avec ma propre réflexion et combien elle a pu me marquer.
Avec Gramsci, je n’avais pas seulement affaire à un grand théoricien de l’universel, mais à un penseur dont l’universalisme provenait directement de ce qu’il assumait sa singularité de membre d’un pays retardataire – une singularité qui se trouve être le propre, aujourd’hui encore, de la majorité des femmes et des hommes qui peuplent notre planète.
A partir de là, il est parfaitement légitime d’essayer d’étudier ce qui se passe chez nous depuis six ans à la lumière des cadres d’interprétation qu’il a élaborés pour son pays et qui sont largement transposables à tous les nôtres, moyennant les précautions d’usage de temps et de lieu.
J’ai moi-même rédigé un livre, La promesse du Printemps, qui brosse un premier bilan de la révolution tunisienne et de la transition qui lui a succédé, en faisant la part de ce qui a été réalisé et de ce qu’il reste à accomplir. J’y cite rarement Gramsci, mais je peux vous avouer qu’il m’a souvent accompagné dans mon travail d’écriture. (Je vous dis cela en passant, pour vous inciter à lire ou relire Gramsci et, subsidiairement, pour vous encourager également à me lire.)
Je ne vais pas vous résumer ici ses principaux développements, mais uniquement insister sur quelques notions de base, et d’abord sur le concept de «bloc historique». Chez Gramsci, le bloc historique se compose de l’ensemble des classes et des groupes sociaux (avec leurs organisations représentatives: politiques, syndicales, culturelles…) qui se forme lors des périodes de grande mutation, c’est-à-dire durant les périodes de changement révolutionnaire. Les classes et les groupes sociaux concernés se constituent alors en bloc pour conduire le changement à son terme et réorganiser l’ordre existant en fonction de leurs intérêts et de leurs attentes2.
Nous avons connu une mutation de ce genre entre décembre 2010 et janvier 2011, lorsque le pays s’est massivement soulevé contre le régime Ben Ali.
Le déroulement du soulèvement permet d’identifier les différentes composantes du bloc historique – ou front de classes – qui s’est progressivement mis en place à cette occasion. Il a d’abord englobé la population rurale des régions intérieures, puis celle des quartiers périphériques des centres urbains (le monde de l’informel); ces deux premiers segments ont ensuite été rejoints par la population salariée (les ouvriers, les employés, les fonctionnaires – ce que l’on pourrait appeler le peuple de l’UGTT) et, en fin de trajectoire, par plusieurs secteurs de la petite et moyenne bourgeoisie (professions libérales, patrons de PME, etc.).
Au total, donc, quatre grands secteurs sociaux: la paysannerie, les ghettos périurbains, les salariés et la classe moyenne. Dans son inspiration fondamentale, leur soulèvement convergeant s’inscrivait dans une perspective typique de révolution démocratique.
Mais quel était le (ou les) mouvement(s) politique(s) représentatif(s) de ce bloc historique émergeant? La réponse tient en quelques mots: il n’y en avait pas. Le soulèvement est resté de bout en bout spontané, sans programme précis, sans encadrement partisan, sans leaders nationaux. Comment expliquer pareille lacune?
La science politique académique ne voit rien d’anormal dans un tel décalage. Pour elle, les révolutions commencent presque toujours de manière spontanée, sans encore disposer des élites politiques nouvelles capables de les conduire et de les faire aboutir. Ces élites politiques nouvelles s’affirment – quand elles parviennent à se constituer – presque toujours après le moment du soulèvement spontané et presque jamais avant.
Revenir à Gramsci permet d’aller plus loin et de mieux expliquer le constat. Commençons par considérer ce qu’il écrit à propos de la question des élites et des intellectuels. Laissez-moi le citer longuement:
«Les intellectuels constituent-ils un groupe social autonome et indépendant, ou bien chaque groupe social a-t-il sa propre catégorie spécialisée d’intellectuels? Le problème est complexe, étant donné les formes diverses prises jusqu’ici par le processus historique réel de formation des différentes catégories d’intellectuels. Les plus importantes de ces formes sont au nombre de deux:
«1 – Chaque groupe social naissant sur le terrain originel d’une fonction essentielle dans le monde de la production économique crée, en même temps que lui, de façon organique, une ou plusieurs couches d’intellectuels qui lui donnent son homogénéité et la conscience de sa propre fonction, non seulement dans le domaine économique, mais aussi aux plans social et politique (…)
«2 – Mais chaque groupe social «essentiel», au moment où il apparaît dans l’histoire, émergeant de la précédente structure économique comme expression de la mutation de cette structure, a trouvé, du moins dans l’histoire telle qu’elle s’est déroulée jusqu’à ce jour, des catégories d’intellectuels qui existaient avant lui et qui, en outre, apparaissaient comme les représentants d’une continuité historique que n’avaient même pas interrompue les changements les plus complexes et les plus radicaux des formes sociales et politiques antérieures. La plus typique de ces catégories intellectuelles est celle des ecclésiastiques (…)
«Une des caractéristiques les plus importantes de chaque groupe social qui cherche à s’élever jusqu’à la domination politique réside dans la lutte qu’il mène pour assimiler et conquérir «idéologiquement» les intellectuels traditionnels, assimilation et conquête qui sont d’autant plus rapides et efficaces que ce groupe social pousse plus loin l’élaboration de ses propres intellectuels organiques. L’énorme développement qu’ont pris l’activité et l’organisation scolaires (au sens large) dans les sociétés surgies du monde médiéval indique l’importance que revêtent les catégories et les fonctions intellectuelles dans le monde moderne (…). L’école est l’instrument qui sert à former les intellectuels…»3.
Cette division de l’intelligentsia entre une aile que j’appellerai par commodité moderniste et une aile traditionaliste peut être repérée chez nous (et dans d’autres pays arabes) dès le début du XIX me siècle. Leur coexistence, souvent conflictuelle et violente, se cristallise sous le protectorat français: Néo Destour contre Vieux Destour, UGET contre Saout et-Taleb, bourguibistes contre yousséfistes, etc.
Avec l’Indépendance, en 1956, c’est l’aile moderniste qui s’empare du pouvoir. Durant 15 ans, elle exerce une domination sans faille et impose au pays un projet de modernisation autoritaire copié sur le modèle capitaliste occidental. Je ne rentre pas dans les détails, vous les connaissez autant que moi. En 1969, ce projet de modernisation-occidentalisation explose en plein vol. L’échec est d’abord économique et conduit à l’abandon de l’ambition développementaliste visant à intégrer l’ensemble de la population active dans un système de production et d’échange unifié. C’est d’ailleurs après 1969 qu’apparaît le secteur dit informel et que les fractures sociales et territoriales commencent à se creuser.
Mais l’échec est aussi politique et idéologique. C’est encore après 1969 que l’aile traditionaliste, étouffée jusque-là, se renouvelle et réapparaît sous une autre forme, celle d’un mouvement islamiste, qui prend plus tard le nom d’Ennahdha et devient la principale force d’opposition.
Incapable d’établir son hégémonie dans la durée, la culture moderniste s’est également avérée incapable de convertir et d’assimiler de manière définitive la culture traditionnelle et ses partisans. Le système scolaire n’est pas épargné par cette évolution. De vecteur central de progrès et de changement, il se transforme progressivement en instrument de conservatisme et de régression.
Le groupe dirigeant, désormais débarrassé de son projet moderniste, ne se préoccupe plus que de rester au pouvoir. Le régime économique évolue dès lors dans un sens de plus en plus clientéliste et rentier, avant de devenir quasiment mafieux sous Ben Ali.
Après le renversement de ce dernier et les élections d’octobre 2011, les islamistes s’emparent de la direction de l’État. Si les modernistes destouriens avaient pu maintenir leur domination idéologique sur le pays pendant 15 ans, eux ne purent pas même l’assurer durant les trois années où ils monopolisèrent le pouvoir. Depuis 2015, ils sont ensemble aux commandes (Ennahdha et Nidaa Tounès, dernier avatar du Néo-Destour et du RCD), et on ne peut pas dire que les choses se soient arrangées pour eux à cet égard, bien au contraire. Les deux partis réunis ne représentent que le quart des Tunisiens en âge de voter et paraissent totalement déphasés par rapport aux besoins de la population.
Pourquoi ces ratages en cascade? Pourquoi cette espèce de fatalité dans l’échec ? Il faut encore faire appel à Gramsci. Je cite: «… Quand la poussée du progrès n’est pas étroitement liée à un vaste développement économique local (…), mais est le reflet d’un développement international qui transmet à sa périphérie ses propres courants idéologiques, nés sur la base du développement productif de pays plus avancés, alors le groupe qui porte les idées nouvelles n’est pas le groupe économique, mais la classe des intellectuels, et la conception de l’État dont celle-ci se fait le porte-parole change d’aspect: l’Etat est perçu comme une chose en soi, comme un absolu rationnel…»4. D’apparence anodine, ce passage des Quaderni fournit une clef essentielle pour comprendre les énormes difficultés rencontrées par les processus de modernisation dans les pays retardataires.
Traduit dans un langage plus explicite, l’extrait cité dit en effet ceci:
- Dans les pays retardataires, le besoin de changement ne vient pas du dedans mais du dehors;
- Ce besoin n’apparaît pas dans l’économie (l’infrastructure), mais dans l’idéologie et la culture (la superstructure);
- Il n’est pas porté par une classe productive, mais par un groupe social extérieur à la production;
- L’Etat acquiert, dans ces conditions, une forme de transcendance; il devient l’instrument dont se sert le groupe des intellectuels pour imposer le changement au corps social.
Ces déterminations modifient radicalement la donne. En inversant la relation unissant les classes productives aux milieux intellectuels, la modernisation des pays retardataires prend une physionomie inédite.
Lorsqu’ils accèdent au pouvoir, ces milieux intellectuels se trouvent dotés d’une forte capacité d’impulsion et d’entraînement, tout en restant frappés d’une sorte de fragilité, d’inconsistance organique, puisqu’ils ne peuvent s’appuyer sur des dynamiques sociologiques endogènes et qu’ils fonctionnent selon une logique de substitution, compensant leur manque de substance objective par un surinvestissement dans l’idéologie.
On a déjà indiqué que la réponse à la question du retard a pris, chez nous, deux formes principales, toutes les deux réactives et mimétiques:
- Une réponse d’imitation de l’étranger, de la part de ceux qui ont opté pour la modernisation, en cherchant à imposer le modèle qui avait triomphé dans les pays avancés;
- Une réponse d’imitation du passé, de repli sur soi, de la part de ceux qui ont opté pour le changement à partir de la revivification de la tradition.
De nature purement idéologique, les deux réponses étaient par définition inadaptées, inadéquates, et destinées, à terme, à échouer, notamment à partir du moment où les partisans de l’une ou de l’autre s’empareraient de la direction de l’État.
Mais revenons à la Tunisie d’aujourd’hui. Chacun sait que le soulèvement de 2010-2011 a été essentiellement spontané, sans organisation(s) politique(s) pour l’encadrer et lui fixer un cap. Au regard de ce qui vient d’être expliqué, on peut ajouter que le soulèvement a marqué un basculement, une rupture, l’instant où la population, dans sa masse, s’est affranchie de la tutelle de ses anciennes élites, aussi bien modernistes que traditionalistes. On peut dire qu’un point final a été mis, de cette manière, à la longue parenthèse ouverte par l’épisode colonial.
Dans un premier temps, à tour de rôle, ces anciennes élites intellectuelles ont pu, malgré leurs limites, pousser le corps social en avant, elles ont pu contribuer à le faire progresser et à le transformer. Ensuite, plus ou moins rapidement, leur aptitude à changer le réel s’est épuisée. Et le corps social a poursuivi – sans elles et malgré elles – l’entreprise de changement et de transformation. On est passé, en d’autres termes, d’une situation où les élites étaient en avance sur la société à une situation où c’est la société qui se retrouvait en avance sur les élites.
Mais le processus d’émancipation, sanctionné de façon éclatante le 14 Janvier avec la chute de la dictature, est resté largement inachevé. Il demeure à ce jour privé des leviers (culturels, politiques, organisationnels…) nécessaires pour mener l’œuvre d’émancipation à son terme.
Cet état de fait est lourd de menaces. Le front de classes constitué dans la ferveur populaire il y a six ans est toujours là, mais ne cesse de se fissurer sous nos yeux. Dépourvues de projet national commun, chacune de ses composantes ne se bat plus que pour ses seuls intérêts, y compris s’ils doivent s’opposer à ceux des autres. Du côté de la coalition au pouvoir, la tentation autoritaire est de plus en plus pressante. La démocratisation du régime politique s’est enlisée, tandis que les perspectives de la démocratisation économique et sociale s’éloignent sans arrêt, au profit de groupes rentiers et mafieux dont l’influence n’a jamais été aussi forte.
Bref: le pays est en danger. Et il l’est d’autant plus que nous ne disposons pas encore des élites nouvelles capables de faire face et de renverser la tendance. Pourtant, ces élites nouvelles existent et elles sont même relativement nombreuses. Elles restent toutefois dispersées, éparpillées, impuissantes à peser sur le cours des événements. Et cela notamment en raison de l’absence d’une force politique alternative crédible, capable de les rassembler et les fédérer. Et capable, en dépassant définitivement les anciens clivages entre modernistes et traditionalistes, de sortir d’une culture de révolution passive pour aller vers une culture de révolution active.
Construire une telle force politique est la tâche majeure du moment présent. C’est une responsabilité collective. Et je ne crois pas me tromper en affirmant que nous pouvons compter sur la pensée de Gramsci pour nous aider à l’assumer. En éclairant le chemin.
Notes
- 1– Intervention faite durant le séminaire «Le retour de Gramsci» organisé par la FSJEG Jendouba et la Fondation Rosa Luxemburg, pour commémorer le 80ème anniversaire de la disparition du penseur italien; séminaire tenu à Tunis le 29 mars 2017. J’ai gardé le ton oral de l’exposé.
- 2– A. Gramsci, Quaderni del carcere, vol. III, pp 869, 1091, 1237-1238, 1300-1301, Einaudi, Turin, 1975
- 3– Quaderni del carcere, op. cit., vol. III, pp 1513 et sq (les traductions sont de moi, AK).
- 4– Quaderni del carcere, op. cit., vol. II, p. 1360.