Dernière mise à jour le 2 février 2019
«Et si le printemps arabe n’avait pour finalité que d’ôter sa centralité à la cause palestinienne?»
Texte d’une intervention de l’auteur au colloque de l’UFAC (Union des Universitaires Algériens et Franco algériens), dont la 5eme session s’est tenue à Marseille le 7 avril 2018, sous le thème «Méditerranée: enjeux pour la paix dans la diversité».
Les sujets proposés à la réflexion et au débat d’aujourd’hui sont évidemment tous d’actualité. Il n’a donc pas été facile de faire un choix. Pourtant l’un des thèmes proposés a attiré mon attention. A la lumière des expériences nombreuses -pour ne pas dire innombrables- où la «démocratisation» est présentée comme l’enjeu principal, on peut effectivement se demander si celle-ci est «une nécessité politique ou plutôt un stratagème (de classe) pour la prise de pouvoir»…
Sûrement un stratagème dans bien des cas, mais pas forcément un stratagème «de classe» au sens marxiste du terme, dans la mesure où il vise très souvent à remplacer le parti ou le candidat «blanc bonnet» par le candidat ou le parti «bonnet blanc», le tenant du titre et son challenger partageant en général les mêmes idées, offrant les mêmes options à des détails près. Les exemples sont omniprésents…
N’engageant que ceux ou celles qui y croient, la promesse de chasser un «régime autoritaire» peut n’être qu’un stratagème, qui amènera un pouvoir nouveau, en général aussi autoritaire que le précédent, sinon davantage. La «démocratisation» n’est alors qu’un slogan programmant de déshabiller Pierre pour habiller Paul sans envisager un instant que le monde change de base.
1 – La démocratisation, un stratagème ?
La démocratisation est une nécessité politique, il est difficile de le nier, mais il est rare qu’elle tienne ses promesses lorsqu’elle figure dans un programme.
Quand elle vient, c’est par surcroît (pour ne pas dire par miracle) et elle reste l’objet d’une bataille permanente, y compris et notamment dans nos «grandes démocraties» qui méritent d’ailleurs de moins en moins ce qualificatif par lequel elles s’auto-désignent. Il n’est donc pas monstrueux de voir dans cette «démocratisation» -promesse de démocratie- un stratagème plus qu’un engagement sincère ou crédible.
A en croire les dictionnaires, le stratagème n’est pas seulement l’équivalent d’une stratégie ou d’un plan; il n’est pas seulement un moyen comme un autre permettant d’obtenir un résultat. Dans le terme se glisse une connotation de «ruse de guerre», de «méthode qui vise à tromper ou induire en erreur», quand ce n’est pas de malhonnêteté, de «manœuvre suspecte et condamnable».
Ce n’est évidemment pas la démocratisation elle-même qui est condamnable et malhonnête, mais le fait de la promettre comme priorité des priorités ou comme perspective afin de parvenir à un objectif qui est tout autre, ce qui revient donc à induire en erreur ceux à qui s’adresse cette promesse.
Voilà qui m’amène à évoquer l’une des variantes du stratagème en question, variante dont on a vu de nombreuses illustrations dans les «révolutions arabes» de ces dernières années. Dans ces conflits, qualifiés à tort de «printemps», la «démocratisation» a été sur-invoquée. Il s’agissait en réalité (c’est ce que démontre la suite des évènements) d’induire en erreur les populations, convaincues de combattre «pour instaurer la démocratie» et de tromper les membres de la communauté des nations, afin de justifier un droit nouveau, le «droit d’ingérence».
L’objectif de cette ingérence désirée est au final de faciliter une prise de pouvoir par des forces aux objectifs démocratiques aléatoires, appuyées et la plupart du temps téléguidées de l’étranger, un étranger peu compétent en matière de démocratie. Mais cela importe peu, puisque la finalité véritable est de provoquer un «changement de régime», rêve commun des pays de l’arrogance et des régimes rétrogrades et fanatiques.
On sait combien les pays de l’Empire Atlantique (Amérique, Europe et Israël) sont friands de cette filière: la démocratisation brandie en slogan (une nécessité politique qui constitue l’objectif prétexte) sert en réalité de stratagème pour justifier une intervention diplomatique puis militaire, décidée au nom de la «Responsabilité de Protéger» (version évoluée du droit d’ingérence), via une résolution du Conseil de Sécurité.
Répétons-le, cette intervention, de toute façon illégitime voire illégale, n’a aucunement pour objectif d’apporter ou même d’imposer la «démocratisation», mais vise à provoquer un «changement de régime», c’est-à-dire le remplacement du pouvoir existant qui déplait par un «régime» qui plait, non pas démocratique (car tout le monde s’en moque), mais docile face aux intérêts des parrains étrangers ci-dessus évoqués.
Il est facile de mettre un nom sur les forces locales ou régionales qui se font les fourriers de ce stratagème, puisque les exemples ont été particulièrement nombreux depuis quelques années sur la rive sud de notre Méditerranée, notamment depuis que George W. Bush, de sinistre mémoire, a montré la voie en présentant au monde en février 2004 son Grand Moyen-Orient: rendu public le 13 février 2004 par le journal Al Hayat, ce projet prévoit de réformer, de «démocratiser», de sécuriser et surtout de «libéraliser» la zone allant de la Mauritanie au Pakistan.
C’est le prétexte présentable pour les «régimes» dont la politique fait fi des principes du droit international. Mais Debeliou vise surtout à contrôler les ressources énergétiques de la zone, à encercler la Russie et à ôter sa «centralité» à la cause palestinienne, naguère sacrée pour les Arabes.
La «démocratisation» prétexte est censée rendre la région plus «conciliante» envers l’Amérique (après la destruction de l’Etat irakien) et envers l’Etat juif…
2 – Les principes fondamentaux du droit international
L’égalité souveraine des États et la non-ingérence, principes dits westphaliens en souvenir des Traités de Westphalie d’octobre 1648, qui consacrent les Etats comme acteurs principaux des relations internationales, constituent les deux fondements de la Charte signée à San Francisco le 26 juin 1945, connue sous le nom de Charte des Nations-Unies.
La souveraineté des Etats trouve son fondement sur le principe de l’égalité de droit entre les peuples et leur droit à disposer d’eux-mêmes. Cette souveraineté s’exerce à l’intérieur de l’Etat et vis-à-vis de l’extérieur, le respect de cette souveraineté sous ses deux aspects se traduisant à son tour par le principe dit «en raccourci» de non-ingérence.
En inscrivant ces deux principes dans la Charte au terme des horreurs de la Seconde Guerre Mondiale, les législateurs avaient le souci de protéger les États plus faibles et/ou les plus pauvres contre les Grands, riches et puissants, l’agressivité des forts contre les plus vulnérables étant considérée à juste titre comme le risque majeur pour la stabilité et la sécurité du monde.
Au droit des peuples à l’autodétermination (évoqué précédemment) fait écho un quatrième principe –le principe de neutralité idéologique– qui viendra se greffer sur les trois précédents. Promu par le bloc communiste et les Non-Alignés, et confirmé en 1970 par l’Assemblée Générale des Nations-Unies dans sa résolution 2625 (XXV), il conforte «le droit inaliénable de tout État à choisir son système politique, économique, social et culturel, sans aucune forme d’ingérence de la part d’un autre État ». Il ne sera pas entériné au niveau du Conseil de Sécurité, les Occidentaux ne l’acceptant pas.
Mais il garde toute sa valeur juridique, bien qu’il soit superbement ignoré par les seigneurs de l’Empire Atlantique, obsédés par leur droit divin à décider seuls du destin d’autrui.
3 – Les Nations-Unies, combien de divisions?
Durant la guerre froide, ces fondamentaux sont écornés à la faveur d’une règle du jeu implicite qui en limite la portée à l’intérieur de chacun des deux blocs. Les deux Super-Grands entendent être maîtres chez eux. Les États-Unis considèrent le «monde libre» comme leur domaine, ne tolérant pas d’écart chez leurs vassaux.
Ligotés par le Plan Marshall et l’aide US à la reconstruction, s’en étant remis une fois pour toutes à l’Amérique pour leur défense contre le communisme, les Européens filent doux, heureux et soumis et qui plus est contents de l’être.
La France et la Grande-Bretagne ont même droit à des espaces de sous-traitance, notamment dans leurs empires coloniaux vacillants. Au risque de se faire rappeler à l’ordre le cas échéant. L’Amérique, qui ne se gêne pas pour faire la loi dans son arrière-cour latino-américaine, garde encore un profil bas en Afrique et dans le monde arabe, mais se réserve le droit de condamner, voire de contrer telle ou telle entreprise néocoloniale: le coup d’arrêt donné par l’ultimatum conjoint de l’Amérique et de l’URSS à la fameuse expédition tripartite franco-anglo-israélienne de 1956 contre l’Égypte de Nasser en témoigne.
Dans le camp d’en face, les principes sont défendus avec intransigeance face «à l’impérialisme», mais il faut reconnaître qu’au sein de la communauté socialiste, la doctrine Brejnev ne laisse aux pays frères qu’une «souveraineté limitée» au nom de la défense des intérêts supérieurs du communisme.
Les évolutions qui marquent l’après-guerre vont introduire des inflexions dans cet ordre gendarmesque, mais somme toute équilibré.
Les décolonisations, la création du mouvement non-aligné, l’affrontement idéologique entre les deux Mecques du communisme, Moscou et Pékin, les révoltes à l’Est contre un socialisme trop réel, la prise de distance de la France par rapport à l’Amérique au nom de l’indépendance nationale, vont amener de l’oxygène à la vie internationale.
Cet équilibre sera rompu de façon imprévue par le sabordage de l’URSS, allant de pair avec la dissolution du bloc communiste et entraînant la fin du conflit est-ouest. Si ce séisme en douceur, finalisé sans réplique à la Noël 1991, est salué comme un grand bond en avant par les apprentis maîtres de l’univers, il ouvre à la communauté des nations l’une des périodes les plus étouffantes et les plus injustes qu’elle ait jamais vécues.
La fin de la guerre froide ayant sonné le glas pour l’ordre bipolaire Est – Ouest, les grandes heures du Mouvement des Non-Alignés appartiennent à un passé sans doute révolu: les deux décennies 1991/2011 du «moment unipolaire américain» réduiront de facto le choix idéologique potentiel à la soumission à l’ordre atlantique (rejoindre la «communauté internationale» de la bande des Trois occidentaux ) ou à la relégation vers le statut de hors-la-loi (en tant qu’Etat failli ou en faillite, paria ou voyou).
La naissance idéologique de la «communauté internationale» marque les débuts de l’offensive visant à réduire, au nom de la mondialisation, la portée des deux principes ci-dessus mentionnés (souveraineté des États et non-ingérence) et à introduire progressivement la prééminence d’un «droit d’ingérence» qui donnerait à la dite « communauté internationale » les moyens juridiques d’intervenir, quasiment à volonté, dans les Rogue-States, en décomposition ou en voie de démantèlement, selon la terminologie des experts US.
4 – La «responsabilité de protéger, héritière du droit d’ingérence
S’il est un concept discutable et contesté, c’est le droit d’ingérence, qui s’est invité depuis la décennie 1990 au centre d’un débat touchant aux fondements même du droit international, tel qu’ils sont gravés dans la Charte des Nations Unies.
Différents termes sont employés pour désigner ce concept, mais les nuances entre le droit d’ingérence, le devoir d’ingérence, le devoir de protection, le droit d’intervenir pour protéger, puis la responsabilité de protéger ne servent qu’à camoufler l’enthousiasme des activistes de «l’humanitaire» face à l’émergence d’une possibilité d’ingérence à tout va.
Le droit d’ingérence est né dans un contexte édifiant qui éclaire les motivations «humanitaires» de ses inventeurs. Il convient à ce stade de rafraîchir la mémoire «historique» des champions de l’humanitaire pur et dur, qui se présentent volontiers comme l’avant-garde d’une société civile internationale solidaire et bienveillante, défendant les défavorisés, les opprimés, les damnés de la terre contre les nantis, les puissants, les exploiteurs, les tyrans, les massacreurs, les bourreaux de toute appartenance.
En guise d’argumentation, une formule utilisée depuis toujours à toutes les sauces : «la fin justifie les moyens», ce qui signifie «pour secourir les civils innocents qui ne sont pas protégés, mais massacrés par leurs dirigeants, tous les moyens sont bons… y compris la force, sans autre forme de procès ».
Le hic, c’est que les «sauveurs» et les «bienfaiteurs» sont toujours occidentaux et que leurs « pauvres » ne le sont pas. Mais le hic c’est également, et peut-être surtout, que l’humanitaire si compassionnel permet de cacher les mobiles inavouables d’un Empire Atlantique à succursales multiples, déterminé à étendre son hégémonie sur le monde et ses richesses.
Il n’est pas inutile de rappeler le contexte historique de l’émergence du droit d’ingérence.
C’est à la fin de la décennie 1970, à l’occasion de la guerre de sécession du Biafra (région riche en pétrole et partie intégrante du Nigeria, lequel vient d’accéder à l’indépendance depuis peu d’années) que le concept de droit d’intervention est «inventé» par Bernard Kouchner, un médecin qui accédera ainsi à la notoriété médiatique.
Le concept est au départ à usage «humanitaire» : il s’agit de « sauver les Biafrais», menacés de massacre (de génocide ?) par leur gouvernement. L’entreprise de sauvetage se traduira notamment par la création de l’ONG française «Médecins Sans Frontières» et de plusieurs autres ONG en 1971. Humanitaire certes, mais par la suite on oubliera pudiquement de rappeler le contexte politique qui a inspiré cette fièvre de bienfaisance et de compassion.
La France soutient alors ouvertement les Igbos (chrétiens en majorité) dans leur combat pour la sécession, qui aboutirait à un début de démantèlement du Nigeria («anglophone» et à pouvoir nordiste musulman) et à la spoliation d’une partie de son or noir. La partition n’aura pas lieu, mais le concept d’ingérence humanitaire fera son chemin.
Il semble recevoir un renfort en 1977 avec le Principe Additionnel aux Conventions de Genève (de 1949), selon lequel «les offres d’assistance impartiales » aux victimes de conflits armés «ne doivent pas être considérées comme des ingérences ou des actions hostiles ».
La notion de «devoir d’ingérence» elle-même ne sera formulée qu’en 1987, vingt ans après son «invention», par Bernard Kouchner et Mario Bettati, un juriste français (décédé le 23 mars 2017) lors d’une conférence de presse sur le thème « Droit et morale humanitaire ».
Cependant, il faudra attendre la décennie 1990 pour que le droit d’ingérence réinvestisse avec vigueur le champ diplomatique, à l’initiative de la France qui l’aura invoqué à maintes occasions afin de faciliter ses ingérences de «gendarme de l’Afrique».
Ce n’est pas le fait du hasard, mais la résultante du bouleversement géostratégique survenu en 1990 avec la chute de l’URSS. En effet, les Occidentaux ne tardent pas alors à faire un constat riche de perspectives. Une fenêtre d’opportunités s’ouvre au Conseil de Sécurité: la Russie, héritière de l’URSS, et la Chine, toutes les deux d’une certaine façon orphelines de l’idéologie, semblent faire leur deuil de toute velléité de résistance, tétanisées, résignées et peut-être fascinées par le triomphe de l’ex-tigre de papier.
Dans ces conditions, faire légitimer un projet d’intervention unilatérale par le biais des Nations Unies, inenvisageable auparavant, est désormais relativement facile. Au pire, Moscou et Pékin marqueront-ils leur désaccord par une abstention au Conseil de Sécurité. Il suffit de montrer que les États ciblés pour leur indocilité ou leur dangerosité proclamée répondent aux critères fixés par le chapitre VII de la Charte des Nations Unies et de rédiger un projet de résolution qui soit acceptable par les cinq membres permanents ou ne les provoque pas trop. Le harcèlement, l’activisme, les pressions, les promesses suffisent en général à convaincre le reste de la clientèle du Conseil.
Utilisé systématiquement depuis le début du troisième millénaire par l’Occident en Afghanistan et en Irak, avec les résultats que l’on sait, le «droit d’ingérence» humanitaire transgresse délibérément les deux principes fondamentaux mentionnés précédemment, la souveraineté des États et la non-ingérence.
Pourquoi pas, disent les «interventionnistes», qui dissimulent leurs objectifs réels et feignent d’ignorer l’absence de consensus sur ce nouveau droit humanitaire. En effet, utilisé par le seul Occident vis-à-vis des seuls pays du Sud, ce devoir de protection dégage de forts relents de néo-colonialisme.
Cela n’empêchera pas certains de le considérer (ou de faire semblant) comme un concept reconnu par des textes onusiens, celui notamment de l’Assemblée Générale portant sur l’aide humanitaire aux victimes de catastrophes naturelles et de situations d’urgence » (43/131 en date du 08/12/1988), ou celui sur la création de «couloirs humanitaires» (45/100/1990), voués à devenir l’obsession des maniaques du «bombardement pour protéger».
Pourtant, l’Assemblée Générale invite bien les États-membres à faciliter l’acheminement de l’assistance, mais elle ne donne à personne le droit de l’imposer, la décision devant être prise en concertation entre les gouvernements et les organisations concernées. En 1994, exprimant son émotion face au génocide rwandais et aux massacres de Srebenitsa, Koffi Annan, alors Secrétaire Général des Nations Unies, lance un appel au Conseil de Sécurité, rappelant « son obligation morale à agir au nom de la communauté internationale pour sanctionner les crimes contre l’humanité ».
Toutefois, avant de lancer une intervention, le Secrétaire Général et les organisations régionales doivent déterminer si les violations du droit humanitaire mettent en péril la paix et la sécurité et définir quelle sorte de protection les Nations Unies peuvent offrir aux populations. A ce stade, ni les États ni l’ONU elle-même n’ont le droit d’intervenir dans un autre État, y compris pour des raisons humanitaires.
En 1999, dans le sillage du lancement d’opérations de maintien de la paix (OMP) en Somalie et en Bosnie, la sous-commission des Nations Unies pour les droits de l’homme rappellera qu’une OMP ne saurait en aucune façon établir un droit d’ingérence ou encore moins un devoir d’intervention.
En cas de crise interne (ou de catastrophe naturelle), le consentement de l’État concerné est indispensable avant toute intervention étrangère, quelle qu’en soit la nature.
A priori, la seule exception à cette règle concerne les cas de menace contre la sécurité collective, une action militaire pouvant alors être autorisée pour des motifs humanitaires (chapitre VII). Et c’est bien ce chapitre qui intéresse les partisans forcenés de l’interventionnisme, dont l’inventivité est monotone mais inépuisable.
À titre d’exemple, les juristes de l’ingérence ont mis au point une théorie à tiroirs fondée sur le devoir qui incombe à tout gouvernement de protéger ses populations civiles, quelles que soient les circonstances, et sur le droit de la « communauté internationale » à se substituer à ce gouvernement en cas de carence. Ce raisonnement est riche de possibilités, d’autant plus que les carences sont faciles à provoquer dans les États que l’on a décidé de mettre en déroute ou en faillite.
5 – Pourquoi une telle bataille à propos d’un simple concept ?
La légitimité d’une action reste en effet problématique tant que lui manque l’onction du droit international. Le Conseil de Sécurité en principe, constitue le véritable sésame ouvre-toi de l’ingérence. Sans son accord, pas d’ingérence.
Il est donc clair que la légitimation dont il est question ici entre dans une phase compliquée, dans la mesure où le concept d’intervention lui-même contrevient aux principes gravés dans la Charte des Nations Unies, qui fait foi en la matière, le Conseil de Sécurité des Nations-Unies ne pouvant en principe pas violer les règles dont il est le garant….
C’est la raison pour laquelle certaines « grandes puissances (occidentales) envisageront de recourir à une forme de légitimation différente, par le droit humanitaire. Pour ce faire, l’ingérence doit être présentée sous une forme reconnue par la communauté internationale.
Devenu un devoir, le droit d’ingérence va se transformer en un devoir de protection avant de se cristalliser sous la forme actuellement popularisée de « responsabilité de protéger » (R2P), un concept qui sonne moins néocolonial qu’un droit ou un devoir puisqu’il est présenté comme une responsabilité subsidiaire de la «communauté internationale» que celle-ci doit activer dans les cas où l’État ciblé n’assume pas ses obligations.
Les puissances occidentales se targuent d’avoir fait reconnaître cette R2P par l’Assemblée Générale des Nations Unies en 2005 à propos du Darfour. Mais il apparaît comme une simple référence dans la résolution 1674 du 28 avril 2006 sur la protection des civils en cas de conflit et dans la résolution 1706 du 31 août 2006, autorisant le déploiement de 17 300 casques bleus au Darfour, dans le cadre de la force hybride NU/UA.
Cette résolution restera lettre morte. La mécanique n’est pas rôdée comme ce sera le cas lors de la crise libyenne. Le Conseil de Sécurité éprouve encore le besoin de négocier la forme de ses interventions, comme en témoignent les longues tractations nécessaires pour aboutir à la transformation de l’AMIS africaine en MINUAD afro-onusienne.
L’OTAN rêve de mettre un pied au Soudan, mais le défaut de consensus et l’opposition du gouvernement de Khartoum feront obstacle à la réalisation de ce rêve atlantique. Le «devoir de protéger les populations civiles », traduction du droit d’ingérence, n’existe toujours pas, malgré les efforts de certains juristes qui rêvent de bousculer souveraineté des États et principe de non-ingérence.
Beaucoup présentent cette approche nouvelle comme un progrès : ne s’agit-il pas de limiter la toute-puissance des gouvernants réputés dictatoriaux, tyranniques, répressifs, sur leurs populations ainsi mises en danger.
En fait le rêve des partisans de l’ingérence est de faire avaliser par l’Assemblée Générale, puis par le Conseil de Sécurité le Devoir de Protéger (D2P) avant de tenter de l’incorporer à la Charte des Nations Unies, au chapitre VII qui définit les situations dans lesquelles des mesures coercitives peuvent être prises contre les États répondant aux critères ci-dessus, voire appliquées « manu militari».
Ce devoir de protéger (D2P) suscite beaucoup de réticences et souvent une franche hostilité. Ses adversaires dénoncent les risques de confusion ci-dessus mentionnés et encore davantage la contradiction entre le prétexte (protéger les civils) et la réalité (changer le régime et introduire le chaos, la démocratie étant totalement oubliée).
Cinq ans plus tard, en mars 2011, la responsabilité de protéger (R2P), dernier avatar du vocabulaire de l’ingérence, sera à nouveau invoquée pour engager en Libye, dans les conditions que l’on connaît et avec l’objectif que l’on sait, une opération «humanitaire» qui fera des dizaines de milliers de victimes. Sitôt Kadhafi liquidé, en octobre de la même année, la Chine et la Russie flouées par les Occidentaux diront « niet » en russe et «Bu» en chinois à la tentative occidentale de «remettre ça» en Syrie.
Plus de R2P pour les prochaines équipées.
La guerre de Syrie illustrera à partir de mars 2011 l’hypocrisie des guerres «pour la démocratie» en général conduites et parrainées par des forces foncièrement anti-démocratiques et lorsque la «démocratisation» n’est qu’un stratagème pour parvenir à un changement de régime, à la destruction de l’Etat ou à sa mise sous tutelle ou à la prise du pouvoir par des forces étrangères ou représentant des Etats étrangers. Si deux mots – le «dictateur» et le «régime» – sont les mots de passe pour «acheter la route» du politicide, c’est un concept – la «responsabilité de protéger » – qui est convoqué pour justifier l’injustifiable au regard du droit onusien.
Il suffit pour démasquer le mensonge de la démarche impériale de s’arrêter sur un constat: cette responsabilité est invoquée par les États qui affichent leur volonté d’agir en dehors de la légalité onusienne quand celle-ci leur est refusée.
Illustration concrète : devant le troisième véto opposé par la Russie et la Chine à l’adoption d’une résolution ouvrant la voie à une intervention militaire « humanitaire » en Syrie (sur le modèle libyen), les Trois occidentaux clameront leur intention d’agir désormais «en dehors du cadre des Nations Unies».
Cette option, autant dire ce chantage, restera désormais sur la table, marque indéniable de dépit de la part des Trois, accoutumés à faire la loi à l’ONU et confrontés à l’opposition déterminée des deux membres permanents non-occidentaux.
Mais l’Histoire n’a pas de fin, comme n’aurait pas dit M. Fukuyama. «Le plus puissant Empire que la terre ait jamais porté», qui n’aura pas fait long feu, en fera l’expérience à ses dépens.
La renaissance de la Russie des cendres de l’URSS et l’émergence irrésistible de la gigantesque Chine auront stoppé au bout de vingt ans les ébats solitaires de l’hyperpuissance qui pensait être éternelle à l’image de Dieu.
Désormais, à la lumière du conflit de Syrie, il apparaît que le monde onusien est clairement divisé en deux camps qui s’affrontent juridiquement et militairement: le camp de la paix et du droit, celui de la Russie, des BRICS, de l’OTSC (Organisation du Traité de Sécurité Collective) et de l’axe de la résistance arabo-musulmane d’une part, le parti de la guerre et du non-droit, celui de l’Occident «judéo-chrétien» et de ses complices takfiristes, d’autre part.
Michel Raimbaud: Ancien Ambassadeur de Frace au Soudan, en Mauritanie et au Zimbabwe, auteur de «Le Soudan dans tous ses états: L’espace soudanais à l’épreuve du temps» Paris Karthala 2012 et «Tempête sur le Grand Moyen Orient» Ellipses 2015 réédition 2017
Illustration
Photo ONU/Mark Garten
La copie originale de la Charte des Nations Unies conservée aux Archives nationales des Etats-Unis, à Washington DC
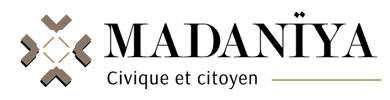

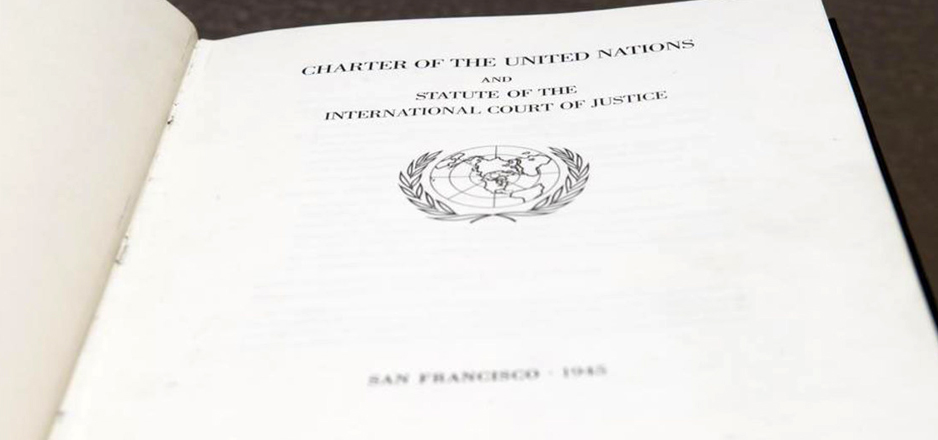
Déjà 8 ans de guerres en Syrie, une guerre sans nom comme nous l’avions nommée, ma femme et moi-même dans l’un de nos livres, paru en 2014, or comme la guerre s’est prolongée, nous avons alors publié la suite chronologique sous le titre de Syriapocalypse. Durant toute cette longue période marquée par des conférences, des débats, des interviews, radios, télés, nous n’avons cessé de témoigner de la réalité subie et imposée au peuple syrien, avec lequel nous avons vécu et partagé ses angoisses, ses désarrois, ses attentes, ses découragements, leurs exodes et si peu, leurs espérances, tout cela entre 2009 et 2012 et plus récemment en Novembre 2017….
Aujourd’hui, on entend plus les médias ni les politiques mainstream, pour la simple raison que l’armée syrienne est en train de vaincre le dernier bastion des Djihadistes à Edleb, que l’Arabie Saoudite s’obstine,signe et persiste en continuant à financer Daesh, avec l’aval des Occidentaux, de l’ OTAN et d’Israël>. Le bastion de la Mecque est depuis le pacte de Quinsy signé en 1945, elle est devenue la prostituée des Etats Unis pour le pire et jamais le meilleur, avec Trump comme le dealer idéal!
Pour tous les sceptiques, et les nombreux amis connus ou inconnus qui ne comprenaient plus rien à la tragédie syrienne, l’article de notre ami Michel Raimbaud, Ambassadeur bien connu pour sa compétence et sa connaissance du Proche et Moyen Orient, pour son intégrité morale et politique hors de toute démagogie ou idéologie partisane, son article est une illustration exemplaire de ce que peut engendrer la manipulation machiavélique de l’opinion publique, par les puissants de ce monde avec leurs cortèges de malheurs, de misères, infligées à tout un peuple héritier des plus anciennes civilisations du monde, qui ne demandait qu’à vivre en paix, JCA.