Dernière mise à jour le 28 novembre 2018
L’enracinement est, à juste titre, lié au nom de Simone Weil, non seulement parce que ce fut la première à en avoir explicitement parlé mais surtout parce que ce fut la première à en avoir fait un «objet de pensée». Soit! Mais on a eu tort, je crois, de réduire la révérence à ce seul nom. C’est à l’histoire de l’Europe que je voudrais le référer. Et comment, au terme de ce détour par l’histoire, l’on retrouvera L’Enracinement de Simone Weil, mais sous un éclairage différent mais néanmoins tragique.
1. De l’allochtonie
L’Europe dont il s’agit est celle dont l’histoire commence au XVe siècle alentour, après la découverte du Nouveau Monde qui marque son entrée dans la Modernité. Cette Europe-là, était, et l’est toujours, saisie de bougeotte. Ainsi, entre les XVe-XIXe siècles, l’Europe a entrepris quelque cent voyages d’exploration, soit une moyenne de 25/an ou de 2/mois.
Tout y a passé: les continents, les mers et les océans, les montagnes, les vallées et les sommets, les fleuves, les forêts et les déserts et, bien évidemment, les pays… qu’elle a renommé d’ailleurs au gré de son humeur conquérante; tout y passe veut dire donc tout le monde connu puisque, parallèlement à ces voyages d’exploration, la Modernité européenne a aussi initié les expéditions militaires de conquête et d’exploration (Cf. Christophe Colomb et tant d’autres) qui bâtiront à l’Europe – avec des distinguo et le temps – un empire universellement colonial sur tous les continents et parcelles de la Terre.
Saisie de bougeotte, certes, mais pas sous la même espèce. Aux XVe-XVIIe siècles, on était sûr, à moins d’un accident, que ceux qui partaient rentraient. Les XVIIIe-XIXe changèrent la donne. Sans annuler ou affaiblir la tendance lourde des «voyages collectifs» – expéditions d’exploration ou de conquêtes, allez faire la différence! -, les XVIIIe-XIXe inventèrent une nouvelle forme de voyager, familiale parfois mais massivement individualisée que les Anglais appelleront le Grand Tour.
Du tourisme avant la lettre: un tourisme aristocratique. Mais ce n’est pas le seul trait que ces siècles ajouteront aux sens du voyager.
Certains, comme Loti -pour réduire cette tendance à un référent et ce référent à un symbole-, finiront par préférer le pays phantasmé au leur propre; d’autres plus abruptement y ajoutèrent «s’expatrier» puisqu’ils choisirent de vivre dans ces pays lointains séduits par un exotisme de mauvais goût; d’autres enfin – comble du comble! – s’expatrièrent dans la religion de l’autre.
Ceux-là partaient pour ne plus revenir; ceux-ci, même s’il leur advenait de rentrer y rentraieraient comme des «revenants», c’est-à-dire, en l’occurrence, en «déracinés» établis comme des étrangers chez eux en exil.
Mais revenons à ce XVIIIe décidément riche. La fin du XVIIe siècle (1688) inventa le mot «nostalgie» (Johannes Hofer) pour nommer une maladie bizarre qui frappait les mercenaires helvètes qui avaient dû quitter les alpages pour servir en France ou en Italie. Si pour Hofer, le terme revêtait un aspect strictement médical et s’analysait en termes de traumatisme dû à l’«expatriation/déracinement», très rapidement, la mode intellectuelle s’en empara: des philosophes – comme Kant qui s’y intéressa de près dans son Anthropologie pour tenter de comprendre les raisons psychologiques de ce mal; des Hommes de Lettres – comme Rousseau qui rapporta, dans son Dictionnaire de musique (1767), cette anecdote tragique; à savoir, le pourquoi de l’interdit qui frappait de mort les mercenaires suisses qui chanteraient ou joueraient la mélodie du «ranz des vaches» au prétexte qu’immanquablement elle déclenchait un violent sentiment de «mal du pays» et des troubles de l’ordre militaire.
Très rapidement donc la nostalgie et sa consœur mélancolique devinrent tout à la fois et simultanément un mode d’être, un mode de penser et un mode de langage, dès lors que, un peu plus tôt, une autre maladie, appelée «mal du pays» -expression qui apparaît pour la première fois en 1651 d’après les lexicographes-, s’est retrouvée désignant la même maladie que désignera la «nostalgie» de Hoffer quelque quarante ans plus tard.
Décidément, le fond de l’air en Europe était chargé tant et si bien que la nostalgie, qui ne s’appliquait qu’aux Suisses au début du XVIIIe, cessa très vite, dès les milieux de ce même XVIIIe, d’être l’apanage des Suisses expatriés et frappa de sa malédiction autant les Allemands que les Français plus tardivement, et les autres Européens encore plus tard.
Ne se contentant pas de franchir les frontières nationales, elle franchit tout aussi allègrement les frontières des classes et couches sociales dans toutes sortes de direction et toutes sortes de domaines pour qualifier, par exemple, les marins enrôlés de force dans la Navy, les paysans transplantés à la ville, les provinciaux déracinés dans les capitales.
Un simple coup d’œil à la Table des matières de L’Enracinement de Simone Weil («Déracinement ouvrier». «Déracinement paysan». «Déracinement et nation») donne une idée de son usage transversal. A ces nombreux déplacés de toutes sortes qui sillonnaient les routes et les pays de l’Europe, les révolutions du XIXe siècle, baptisé «Siècle des exilés», (Sylvie Aprile) firent émerger une nouvelle figure de «déplacé», encore une, celle du «réfugié politique».
Nostalgique tous ceux-là qui ont été forcés de quitter leur pays? Non, pas tous! Seulement ceux d’entre eux qui ont vécu cet éloignement comme une rupture et une séparation douloureuse, c’est-à-dire encore comme un exil.
C’est en sens que, selon la belle définition de Starobinski (2012), la nostalgie/mélancolie est une «variété du deuil» … en ce que s’y révèle, il me semble, le pressentiment d’une perte fatale, existentielle que confirment, d’ailleurs, les usages métaphoriques qui relient «nostalgie» à «déracinement», «déracinement» à «exil», «exil» à «mort» … comme un immense serpent qui n’en finirait pas de se mordre la queue dans un entrelacs de mots et d’expressions qui se renvoient les uns les autres en effets de miroirs.
Le «vivre en exil», s’il induit le désir de rentrer chez soi… et si ce désir de rentrer… est si fort qu’il en devint une maladie, n’est-ce pas parce que cette maladie dévoile en l’oblitérant la question de l’identité consubstantiellement liée à la terre natale, et par-delà, à la Terre elle-même?
N’anticipons pas. Contentons-nous pour le moment de constater que s’il y a maladie – «mal du pays» ou «nostalgie» – c’est bien parce que le «vivre en exil» rend littéralement invivable le hic et nunc de l’exilé, et lui porte la mort: en le délogeant de son milieu (le «hic») l’expatriation le déloge de son temps (le «nunc»).
Toutes balises spatio-temporelles perdues, l’exil constitue pour l’exilé une menace existentielle de dépossession de soi: la perte de la terre est alors vécue comme perte d’identité, comme mort.
Paradoxal trajectoire du «voyage» qui «formait la jeunesse» au temps de Montaigne et entraine la mort aux XVIIIe-XIXe !
Or il se trouve que les Guerres mondiales d’Empire, conduites aux XVIIIe-XXe siècles, le tour précipité donné à la mondialisation de l’Après-Seconde Guerre et la dynamique de territorialisation qui s’en est suivi n’ont fait que souligner en abyme la menace séculaire qui travaille depuis le XVIe siècle l’imaginaire européen. Si, pour reprendre le célèbres propos, «un spectre hante l’Europe», aux lendemains de la Seconde Guerre mondiale c’est bien celui du déracinement… dans l’Empire-monde qui se construit à grand pas.
C’est bien contre cette menace d’allochtonie («dès-autochtonie» serait plus éloquent, mais!…) qui effraie son imaginaire depuis maintenant cinq siècles, que Simone Weil, en pleine Seconde Guerre mondiale, lança en Cassandre et avec toute l’énergie du désespoir ce cri d’enracinement, dans la mesure où, après des siècles voire des millénaires de sédentarisation, l’errance devient la règle.
Et tout le problème -qui est le défi des défis d’aujourd’hui- consiste à savoir comment penser l’instabilité et le mouvement qui caractérisent le monde présent sans pour autant perdre le rapport à la mémoire, à la continuité intellectuelle, au profit d’une exaltation du présent?
Voilà qui remet en question bien des notions, dont celle de l’identité. Et il est vrai que, jusqu’à une date récente, il ne pouvait exister d’être humain sans appartenance à une communauté qui l’intègre et lui lègue, de génération en génération, ses valeurs et le sentiment d’appartenance à un territoire, à une culture, à une langue, qui se présentait aux yeux de populations entières comme une source d’identification individuelle et collective.
Or, partout aujourd’hui, La Mondialisation s’élève et vient désaccorder, troubler, problématiser ce code paradigmatique. Comment saisir ce que devient l’identité à l’âge du mouvement, de la diversité, du métissage?
II – De la Métaphore et des métaphores
Si chaque vécu humain, chaque expérience humaine a et trouve son langage n’est-ce pas parce que la vie elle-même n’échappe pas à ce processus de construction d’une sémiotique qui, à la fois, construit le vécu et l’expérience, lesquels se trouvent eux-mêmes construits par ce langage? Les mots pour les dire représentent alors la forme discursive et symbolique du sens et de «pouvoir-savoir» (Foucault, 1969) au sein d’une pratique culturellement et socialement identifiée.
Dans quel univers sémiotique et selon quel langage s’est manifestée, exprimée et construite l’expérience européenne de l’allochtonie -comme nom générique à tous ceux qui sont en rupture de ban avec leur terre natale, quelle qu’en soit la raison ou le motif: «réfugiés», «proscrits», «bannis», «exilés», «migrants», «émigrants», «déportés», «expatriés» «déracinés», «voyageurs»…?
M’appuyant sur les travaux de Lakoff & Johnson sur la métaphore (1980), j’ai eu pour ambition dans mon propos, de décrire les enjeux existentiels qui se sont joués -et se jouent toujours- dans la perception/représentation métaphorique du déracinement/enracinement que s’est construite l’Européen (mais pas seulement lui) pour contrer les effets dévastateurs de la Modernité/Mondialisation cependant qu’elle lui ouvrait tout grand, pour la première fois dans l’histoire de l’humanité, le Monde de l’ailleurs et de l’autre.
C’est depuis ce temps mémorial que s’est posé à l’Europe la grande question de facture paradoxale, il me semble, et qui n’a, en tout cas, toujours pas trouvé de réponse.
Comment aller chez ou vers l’autre tout en restant soi? Ou, pour le dire autrement, dans les termes du colloque qui nous réunit aujourd’hui : comment se déraciner sans se déraciner?
C’est, depuis ces temps, que l’allochtonie/autochtonie s’est constituée en objet de «nostalgie structurelle» qui serait, selon Bourdieu (Silverstein, 2003, pp. 33 et sv.) une «forme moderne de souvenir social largement partagée».
La nostalgie nous apparaitra alors comme nostalgie d’un temps d’avant le temps de la Modernité, avant que l’identité menace se perdre dans l’horizon du Monde. Et c’est depuis ce temps mémorial que la machinerie métaphorique s’est mise en mouvement pour nommer ce «vécu déracinant» ou cette «expérience du déracinement» qui advenait à l’Europe.
Revenons à la métaphore pour tenter d’en comprendre les enjeux.
Si pour Aristote la métaphore est un concept rhétorique, si les linguistes y découvrent un aspect fondamental du langage, si les anthropologues la saisissent dans son œuvre au cœur de la formation des symboles, si les psychologues s’y intéressent pour s’intéresser aux rapports du langage et du psychisme, si les «pragmaticiens» du langage la saisissent au travers de son rôle dans l’argumentation, Lakoff & Johnson montrent, en 1980, dans leurs Métaphores dans la vie quotidienne, que non seulement notre langage dans son usage le plus quotidien est traversé par les figures/tropes mais qu’il est truffé de métaphores. Partant de ce constat, ils montrent que les concepts au moyen desquels nous appréhendons la réalité sont métaphoriques.
Aussi la métaphore, selon eux, ne saurait se réduire à ce que leurs illustres devanciers en ont dit; elle relèverait tout à la fois du sémiotique et du cognitif, et c’est à ce titre qu’elle organise le réel et lui donne du sens en lui permettant de passer dans le langage, de dire ce qui sans elle ne saurait être dit, et dans notre cas, l’expérience de l’allochtonie pour se signifier, a dû passer par les «racines» des arbres pour que l’on puisse en parler, en prendre conscience et en faire un objet de pensée. Du coup, la métaphore n’est pas comme une chose qui serait indépendante de la façon dont nous comprenons le réel et l’exprimons.
La conclusion s’impose d’elle-même: Si «la métaphore n’est pas seulement affaire de langage ou question de mots» c’est que «le système conceptuel humain est structuré et défini métaphoriquement» en ce que la métaphore offre à l’homme la possibilité de parler du monde et du réel et qu’elle lui «permet de comprendre quelque chose et d’en faire l’expérience en termes de quelque chose d’autre».
La réduire à un pur procédé de l’imagination ou à un objet de la rhétorique en oblitère sa dimension fondamentale: son aspect existentiel, puisqu’elle elle est ce qui permet de nommer le monde pour nous le rendre habitable, d’appeler les choses par «leur» nom pour nous les rendre familières.
En ce sens donc, la métaphore est un «processus cognitif fondamental» dans notre saisie du monde ou du réel, ce qui explique qu’«une large part de nos concepts est métaphoriquement structurée». (L&J, 1985, p. 15 et sq., passim).
III – D’un certain usage de la métaphore existentielle
Quoique non spécialiste en la matière, j’aurai quand même à émettre, bien timidement, une réserve a la thèse de Lakoff & Johnson: celle d’avoir réduit au seul langage quotidien l’œuvre «conceptuelle» de la métaphore. Les philosophes, et en l’occurrence Simon Weil dans le cas qui nous occupe, en ont volontiers usé.
D’ailleurs le concept d’«idée» lui-même, concept philosophique s’il en est, ne vient-il pas du latin «idea», lui-même issu du grec «ἰδέα/idèa» qui, dérivant de «ideîn» («voir), signifiait à l’origine «forme visible, aspect», bref quelque chose de sensible, que l’on «voit», et non pas le sens «abstrait» -quelque chose que l’on «pense»- qu’en a retenu la philosophie?
Tout ce détour par la métaphore -qui fut quelque peu long et pas mal savant- pour revenir à la question de l’enracinement: pourquoi, pour parler de l’allochtonie, l’Europe a emprunté la métaphore des «racines» ou le langage de la botanique et de l’agriculture?
Que l’histoire de la modernisation de la vie sociale -et ses reconstructions nostalgiques- emprunte au langage de la botanique et de l’agriculture n’a rien de vraiment surprenant en soi, les tropes de l’enracinement/déracinement ont une longue histoire dans le discours concernant les cultures et les nations. Ne parle-t-on pas, pour dire son identité, d’«arbre» généalogique?
Dès lors, en retrait dans les mots de la botanique, la métaphore de l’enracinement ne parle d’enracinement et ne dit ce qu’elle en dit qu’en parlant d’autre chose: elle ne parle d’enracinement que pour parler, sous son couvert, d’identité laquelle s’atteste au travers de la métaphore elle-même, puisque dans un enracinement ce qui compte ce sont les racines dont le singulier est l’Identité.
Pour s’en convaincre il suffit de relire la définition qu’en donne Simone Weil: «L’enracinement est peut-être le besoin le plus important et le plus méconnu de l’âme humaine. C’est un des plus difficiles à définir. Un être humain a une racine par sa participation réelle, active et naturelle à l’existence d’une collectivité qui conserve vivants certains trésors du passé et certains pressentiments d’avenir. Participation naturelle, c’est-à-dire amenée automatiquement par le lieu, la naissance, la profession, l’entourage. Chaque être humain a besoin d’avoir de multiples racines. Il a besoin de recevoir la presque totalité de sa vie morale, intellectuelle, spirituelle, par l’intermédiaire des milieux dont il fait naturellement partie.» (Idem, p. 36; SPN).
Pouvoir de la métaphore qui condamne qui veut parler de l’enracinement en termes d’identité, à en parler en une imagerie qui, immanquablement, la «naturalise», comme l’illustre la définition de Simone Weil, et définition qui, comble du comble pour une définition, mêle inextricablement, dans les mêmes énoncés définitionnels s’expliquant en boucle les uns par les autres, des qualificatifs qui relèvent de la nature et du monde physique [romain/gras] pour expliciter des qualificatifs qui relèvent de l’âme humaine [italiques/gras]; le tout progressant à coups d’assertions, en lieu et place de la démonstration.
Dans la définition que donne Simone Weil de l’enracinement tout se passe comme si, inlassablement redoublé en elle-même, la tautologie secrète qui nous porte alternativement du monde de la Nature au monde de l’Ame (ou de l’Esprit) -quand bien même elle s’envelopperait de significations qui d’ailleurs font sa causalité efficace et sa vraisemblance-;
Tout se passe comme si la fonction d’une telle définition semble non pas seulement de donner un sens à l’identité au travers des racines, mais d’agir sur le Monde à la façon d’une incantation dès lors que cette répétition interne induit la réalisation «magique» de l’identité dans le discours métaphorique.
C’est que la métaphore arboricole, pour signifier les représentations de l’éloignement du pays, a pour effet de conférer un caractère «naturel» aux liens entre les personnes et les lieux, de consacrer la constance de l’être sous le signe d’une métaphysique de la persévérance et de la mêmeté: de par l’enracinement on pense s’approprier le milieu, en faire un lieu d’ancrage, voire un lieu d’emprise au service de l’identité.
Mais de par l’enracinement on pense aussi s’approprier le temps de la mêmeté en ce que l’Homme s’assure une fixité afin d’éponger sa bougeotte et ses transformations qui se consument alors dans la perception de la continuité de son être. Elle permet, par-là, de rejoindre l’une des volontés fondamentales de l’humaine condition: si l’on cherche à s’enraciner dans un milieu, à s’ancrer dans la terre et à se fixer, c’est pour s’y réaliser.
Et c’est bien ce que susurre la métaphore de la racine: l’enracinement comme référence identitaire procède de la projection de l’individu dans un double héritage mythique: temporel – une langue, un groupe, une famille; et spatial – une terre, un lieu, le tout nous unissant à des parents, à des usages, à une mémoire commune, à des façons de vivre, cependant que la Mondialisation nous incite à faire éclater toute assignation à résidence, à rompre précisément avec ces liens qui nous enserrent et nous fixent.
Désormais que la mondialisation est notre contexte et qu’il y a de fortes chances qu’elle soit le contexte des temps futurs, la métaphore des racines ne vise-t-elle pas à conjurer le sort qui menace l’avenir en fixant ce qui dorénavant est condamné au changement, maintenant que l’être n’est plus permanence -et ne doit plus être- pour n’être plus que l’événement pur d’un passage.
Les plantes, comme on le sait, n’aiment pas voyager, l’homme de l’enracinement non plus. Plus exactement, il n’aime pas l’espace mobile de la Mondialisation, mouvant comme les sables qui fuiraient sous ses pas, l’empêchant de pouvoir se sécréter une identité, ses marques de passage et ses supports, faute de points fixes où l’accrocher. C’est bien pour cela qu’il n’aime pas l’allochtonie. Tout comme un arbre déraciné est un arbre mort, un homme déraciné est un homme mort, comme le note Simone Weil elle-même:
«Le déracinement est de loin la plus dangereuse maladie des sociétés humaines, car il se multiplie lui-même. Des êtres vraiment déracinés n’ont guère que deux comportements possibles : ou ils tombent dans une inertie de l’âme presque équivalente à la mort, comme la plupart des esclaves au temps de l’Empire romain, ou ils se jettent dans une activité tendant toujours à déraciner, souvent par les méthodes les plus violentes, ceux qui ne le sont pas encore ou qui ne le sont qu’en partie. (…) Qui est déraciné déracine. Qui est enraciné ne déracine pas. » (Simone Weil, 1949, p.39).
Ci-git, dans la Mondialisation, L’Enracinement de Simone Weil qui sonne comme le chant du cygne de l’identité comprise comme propriété substantielle, comme ce qui reste face au déracinement et au choc des nouvelles terres. Pour penser l’homme de la Mondialisation, il faudra il me semble le penser dans les signes d’une métaphysique du passage (à inventer) que porte dans ses flancs la Mondialisation. L’identité et son corollaire l’enracinement pourraient-elles être toujours maintenus comme propriétés de l’être?
Il sera difficile, me semble-t-il, de se débarrasser de l’autochtonie. Elle engage en amont et en aval, la question de l’identité: en amont.
Elle engage la question de l’altérité et chaque société semble éprouver ce besoin de marquer la distinction entre ceux qui sont d’«ici» contre ceux qui viennent d’«ailleurs», les allochtones; en aval, par rapport à soi, parce qu’elle essentialise l’«essence» de l’homme en une image «fabriquée» de l’identité où se revendique une sorte de consubstantialité du sol et du soi — comme le disait je ne sais plus poète: «Quand le sol consubstantiel est en cause, on touche au “sacré”».
Habiter une terre ne serait donc pas —ou pas seulement une affaire profane dès lors que lorsqu’on se qualifie par une relation d’appartenance à la terre natale avec laquelle on fait corps.
Il en est des motifs de voyage selon le gré de l’histoire humaine. Certains voyagent vers un ailleurs désiré et leur motif est un désir d’ailleurs; d’autres pour fuir un pays d’enfer, et leur motif est un désir de décampe; d’autres encore pour le plaisir de voyager, et leur motif est l’agrément. Avec la Modernité, l’homme découvre la nécessité de voyager sans motif: il voyage parce qu’il doit voyager. Il n’habitera plus une terre «autochtone», mais la terre du «monde». L’Enracinement de Simone Weil renvoie donc, il me semble, à l’histoire de la crise violente de l’allochtonie de l’Homme.
Notes
- Sylvie Aprile (2010). Le Siècle des exilés. Bannis et proscrits de 1789 à la Commune, Paris: CNRS Editions.
- Pierre Bourdieu et Abdelmalek Sayad (1964; nouv. éd. 1996). Le Déracinement, la crise de l’agriculture traditionnelle en Algérie: Paris, éd. de Minuit.
- George Lakoff et Mark Johnson (1980). Les Métaphores dans la vie quotidienne, Univesity of Chicago Press (Paris: 1985 pour la trad. fr., éd. de Minuit, ici cité).
- Michel Foucault (1969). L’Archéologie du savoir, Paris: Gallimard.
- Petra Rethmann (2008). «Nostalgie à Moscou», Anthropologie et Sociétés, n° 32, vol. 1-2/Mondes socialistes et (post)socialistes, pp. 85-102.
- Paul Ricœur (1975). La Métaphore vive, Paris: Seuil.
- Jean Starobinski (1966). «Le concept de nostalgie», in Diogène, n0 54, pp. 92-115.
- Jean Starobinski (2012). L’Encre de la mélancolie, Paris: Seuil, Col. «La Librairie du XXIe siècle».
- Simone Weil (1949). L’Enracinement. Prélude à une déclaration des devoirs envers l’être humain, Paris: Gallimard, Col. «Idées»; existe en édition électronique:
http://classiques.uqac.ca/classiques/weil_simone/enracinement/weil_Enracinement.pdf - Paul A. Silverstein (2003). « De l’enracinement et du déracinement. Habitus, domesticité et nostalgie structurelle kabyles», in Actes de la recherche en sciences sociales 5/2003, n0 150, pp. 27-42.
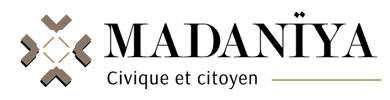


La métaphore permet en effet de fabriquer une image de l’Identité mais l’Homme ne peut être assimilé à une tomate hors sol (l’homme nomade de Jacques Attali ?)
ni à un palmier dattier replanté dans un jardin européen comme semble le penser Eric Zemmour (qui franchit le Rubicon en s’arrêtant sur la passerelle !)
La démarche de Philippe de Villiers est également intéressante. Mais la mondialisation est-elle bien « notre nouveau contexte » et on peut reprocher à de Villiers « de
s’approprier le milieu pour en faire un lieu d’ancrage…au service de l’identité. »
Cette analyse est néanmoins très pertinente !
Merci et amitiés.