Dernière mise à jour le 2 février 2019
Comment penser Dieu au XXIe siècle ?
Entretien avec Roger Naba’a propos recueillis par un groupe d’élèves des classes terminales de l’International College (IC) -Beyrouth I SEE, Année 1997- Maitre d’oeuvre Rony Alpha.
- Le fondamentalisme (qu’il soit chrétien, juif ou musulman) c’est, toujours et partout, l’invention du mouvement avec de l’immobilité.
- En Orient, la religion est toujours le seul horizon de pensée, le seul discours du Monde qui fasse le Monde.
- Il faut bien que quelque chose meure dans l’Islam…. afin qu’il puisse se réinventer, réinventant la vie.
- L’histoire n’est grosse de rien d’autre que des finalités que les hommes y investissent.
Q: Comment vivre sans Dieu ?
A vrai dire je ne sais pas. Personnellement j’essaie de penser le contraire. Comment vivre sans Dieu? Est-il possible à l’homme de vivre sans Dieu?… Et me revient en mémoire cette terrible vérité poétique, énoncée par le plus grand poète «métaphysicien» de la fin du XIXe/début XXe siècle de l’Italie: « Dieu existe à l’instant même où on le tue!»
De même que me revient en mémoire cette autre prophétie de Nietzsche, tout aussi terrible que la précédente: «Dieu est mort, et c’est le malheur de l’homme», toujours citée et reprise sous une forme tronquée, puisque le «et c’est le malheur de l’homme» a été très symptomatiquement refoulé.
Il reste à penser Dieu au XXIe siècle!
La question est fort complexe et elle ne peut avoir qu’une seule réponse, la même pour tous ces Xxe siècles qui composeront le XXIe siècle.
Disons, pour schématiser à l’extrême, qu’il y au moins deux XXe siècle: celui de l’Occident, qui a symboliquement et donc sociétalement «tué Dieu», et les XXe siècles de tous les autres peuples et civilisations pour qui la pensée de Dieu, symboliquement et sociétalement toujours-déjà-là, est fondamentalement présente.
Or ce même Occident qui a «sociétalement» tué Dieu, a échoué à en extirper la figure de l’univers des représentations des gens: beaucoup d’Occidentaux sont croyants. Mais qu’ils croient comme la grande majorité au Dieu des religions abrahamaniques, ou comme, les «sectaires», à des dieux qui ressortent à des symptômes maladifs, cette croyance se vit et est vécue à titre individuel quand bien même elle se pratique(rait) dans des rituels de groupe, en ce que le discours religieux n’est plus, pour l’Occident, le discours du monde qui fait le monde.
Car les athées de ce même Occident se sont avérés des croyants, mais pratiquant une «théologie de la mort de Dieu», comme ce fut le cas des Aüfklerer, ces philosophes des Lumières européennes, philosophes du Progrès et de la Raison, voire du Progrès de la Raison dans l’Humanité, ou pratiquant une «théologie athée» comme ce fut le cas des progressistes, socialistes, marxistes, maoïstes, gauchistes, et autres istes dans le sens de l’Histoire.
Comme vous le voyez, si on met les choses religieuses dans une perspective historique, rien n’empêcherait de conclure que la pensée de Dieu, sa présence «mondaine» serait incontournable pour l’Homme, et que l’Homme serait, également, un «animal religieux».
Q: Mais vous-même, comment pensez-vous Dieu ?
J’éprouve de la gêne à y répondre, ici, à titre personnel. Je dis bien «ici», parce qu’en d’autre lieu j’y ai répondu. «Ici», je me perçois/je suis perçu comme professeur de philosophie, et il n’est pas bon, il me semble, qu’un professeur de philosophie assène «ses» vérités à des élèves qui ne sont pas, Dieu merci, ses disciples!
Q: Mais c’est très précisément à titre personnel qu’on voudrait vous interpeller.
Evidemment que je ne crois pas en Dieu, pour reprendre la formule consacrée. Mais je dois bien croire à quelque chose, sinon, eh bien c’est la mort, le suicide, puisqu’il est établi, depuis Freud, Nietzsche et quelques autres, qu’il est impossible de vivre sans de la croyance. Mais, dans le cas qui est le mien, je «crois à…» qui ne devrait pas se confondre avec «croire en…»; car ma croyance ne s’inscrit dans aucune théologie de la transcendance, même pas dans une théologie de la mort de Dieu comme le sont souvent les «religions» qui se méconnaissent. Je suis, un peu, dans la situation de Don Juan qui, à la question de savoir s’il croyait, répondait à Sganarelle par un «Laisse tomber» définitif et sans appel.
Pour un peu mieux cerner ce «lieu» où je suis et d’où je vous parle de cette question de la pensée de Dieu et de la croyance en son existence, je comparerai cette situation que j’occupe aux autres figures de la croyance. Si la différence d’avec les «croyances religieuses» s’impose d’elle-même — à l’instar de Don Juan je ne suis pas concerné par cette question, ceci ne la réduit pas, pour moi, à n’être qu’une question inimportante.
Dès lors que l’Homme, en tant que tel, est concerné par cette question, elle me concerne. Précisément parce que c’est une question colossale, qui intéresse et concerne l’Homme, cet être en souci de Dieu. Mais je n’y suis pas concerné de la même façon.
Alors que le Dieu des religions contribue à définir le croyant qui ne serait rien sans (son) Dieu — En dehors de Dieu il n’est point de Salut — personnellement je me définis en homme et je définis l’homme autrement que par la foi religieuse ou la pensée de Dieu.
Et c’est bien parce que Dieu, quelque soit ce Dieu, contribue originellement et originairement, pour la majorité des hommes, à la définition même de l’Homme qu’il faut respecter toutes les religions, bien que je sois moi-même athée. «L’homme est cet être qui porte en lui l’idée d’infini», disait Descartes. Et c’est vrai qu’il en est ainsi.
Comme vous le voyez, si je ne suis pas concerné par la question de Dieu en tant que croyant, cette question me concerne en tant qu’homme. Mais elle me concerne d’une manière «analytique» si je puis dire, en ce que pour moi Dieu «existe» dans la mesure où il «existe» dans et par — pour ne pas dire «de par» la parole et le discours de l’Homme. «Humainement» parlant Dieu existe. Mais rien ne dit qu’il existe hors de la parole de l’Homme. Dont acte.
Parce que, à la différence des «croyants athées», qui, eux, croient en quelque chose et veulent l’établir en vérité, et en bon kantien, je ne crois pas que la raison humaine ait jamais les moyens de prouver en la matière quoique ce soit. L’ayant compris, K. Jaspers tirera magistralement la conclusion de la leçon kantienne: «La foi s’éprouve, mais ne se prouve pas».
Q: Est-ce la seule différence que vous établissez entre vous et ceux que vous appelez les «croyants athées»?
Ce qui me sépare d’eux mérite d’être explicitée. Après tout, c’est avec eux qu’il y a risque de confusion. Comparons, si vous voulez bien, les formes de nos croyances. La leur s’inscrit dans une perspective téléologique (ou eschatologique), une perspective qui postule que la fin de l’Histoire se doit de «réaliser», à son terme, la vérité même de l’Histoire.
L’Histoire alors, forcément universelle, se confond avec le procès de cette révélation (Hegel), de cette réalisation (Marx) ou de ce dévoilement (Heidegger). C’est cette perspective téléologique qui, réinscrivant leur croyance dans une théologie de la transcendance, l’investit de sacré; mais d’un sacré dénié et méconnu parce que transfiguré, qui fait retour pour s’écrire, après la «mort de Dieu», dans des termes profanes d’une théologie. Ainsi, le «croyant athée» renoue-t-il avec une certaine théologie de la transcendance, bien que ce soit, ici, sous la forme d’une Essence (d’une Idée) consubstantielle au sens de l’Histoire.
Le Progrès, la Raison, la Liberté, le Bonheur, la Dictature du Prolétariat, bref tous ces «paradis terrestres» doivent se réaliser… puisqu’ils doivent se réaliser. Pétition de principe que l’on retrouve probablement aux fondations de toutes les croyances de ce genre et qu’a formulée remarquablement bien Hegel: «Ce qui apparaît à la fin est toujours au commencement.»
Ce qui aurait dû prendre la place de Dieu c’est, en principe, un lieu vide, éternellement vacant, ayant valeur d’hébergement. Mais, dès les origines, cette «place vide» au lieu que de rester vide, a été investi et occupé par un mythe cosmopolite et universel, comme si, l’homme moderne, face au vide auquel il était confronté, a cherché à l’éviter par une ruse de la raison; attitude de fuite remarquablement décrite par Rilke dans ces vers éclatants des Elégies de Duino
«Et soudain dans ce pénible nulle part,
Soudain la place indicible, où l’insuffisance pure
Incompréhensiblement
Se transforme et bondit en cette surabondance vide.
Où le compte aux postes nombreux s’achève en l’absence de tout chiffre».
Tout en étant «moderne» et que j’inscrive ma réflexion dans la perspective de la «mort de Dieu», j’essaie de maintenir la vacuité du vide. Je ne crois donc pas que l’histoire recèle un sens quelconque qui doive se révéler, se manifester ou se réaliser. Je pense que l’histoire n’est porteuse en elle-même, de par elle-même, d’aucune vérité transcendante, sacrée ou profane que soit cette vérité. L’histoire n’est grosse de rien d’autre que des finalités que les hommes y investissent. En ce sens je me sens très proche de Nietzsche quand il affirme que l’homme est un «animal perspectiviste» en ce qu’il est une représentation construisant le monde à partir de lui-même.
Mais toute représentation est fausse, précise Nietzsche: «Toute croyance, toute opinion est fausse, parce qu’il n’y a pas de «monde vrai». Il n’y a donc qu’une apparence perspectiviste dont l’origine est en nous». Ce qui lui faisait dire que la grandeur de l’homme est d’avoir inventé la «fable, le mythe, la métaphysique, la religion», et sa misère d’y avoir cru. Le mythe peut mais ne doit pas être cru.
Je pense que c’est la certitude de la foi, que cette foi soit une foi religieuse ou athée, qui anime la croyance des croyants, pendant que c’est la seule vertu du possible qui anime la mienne. Et c’est en cela, je pense, que réside la différence fondamentalement métaphysique qui me tient à l’écart de la foi, de toute foi, à quelque ordre qu’elle appartienne.
Quand les croyants, athées ou religieux, postulent que la réalité doit s’unir au possible dans la nécessité (c’est çà, la téléologie), moi, je pense que c’est cette dernière, que c’est donc la nécessité qui peut — et non, «doit» — s’unir au possible dans la réalité. A leur déterminisme mécaniste sûr de ses prémisses causales et de son terme, j’essaie de substituer un déterminisme «chaotique», où il y place à l’intervention de l’homme.
S’il est vrai cependant que je pense que l’homme se définit par un projet de liberté et de raison, il demeure que ce projet est une aventure, qui peut aboutir ou se casser la gueule — «le possible vraiment, comme l’écrit Kierkegaard, contient tous les possibles, donc tous les égarements» (Traité du désespoir).
Car l’idée de projet, en reportant le possible dans la réalité plutôt que dans la nécessité oblige l’homme moderne du XXIe siècle à se penser sans la transcendance: à se familiariser avec l’idée que ce monde-ci, celui où il vit, ne laisse rien derrière lui ni au-delà, qu’il est l’horizon total de son être et qu’il n’y a pas d’autre domaine qui lui serait transcendant. Cela n’empêche pas qu’il y ait des dimensions, des profondeurs, qui nous échappent ou nous échapperont définitivement. S’il en est ainsi, ce monde-ci est donc la seule source et le seul contexte de toutes les normes éthiques ou politiques.
Je ne pense pas qu’il faille chercher la source des valeurs morales ou sociales et de la légitimité politique dans un au-delà sacré, ou une transcendance historique. Elle se retrouve dans les êtres humains, hommes et femmes qui s’interrogent pour les élaborer, elle se retrouve dans cette vérité fondamentale mise en lumière par Kant et qui fait de l’homme, de tout homme toujours et partout, une fin pour lui-même et les autres ses semblables, et non un moyen. Mais surtout il lui faut accepter que tout cela qu’il élabore et conçoit, c’est toujours et partout un homme fini qui l’élabore et le conçoit dans un monde lui-même fini. Là dessus il y a un philosophe, peu connu hélas, Yirmiyahu Yovel, qui a dit des choses essentielles (Kant et la philosophie de l’Histoire; Spinoza et autres hérétiques).
On aura reconnu, peut-être, Spinoza, dans cette leçon de l’immanence des fins ultimes de l’homme, mais je ne suis pas sûr que les hommes de l’Occident, ou ceux d’ailleurs, pourront substituer à la pensée transcendante de Dieu ou de l’Histoire, la pensée d’une fin immanente au monde d’ici-bas.
Q: Vous n’avez jusqu’à présent parlé que de l’Occident. Mais qu’en est-il de la pensée de Dieu ailleurs, par exemple dans cet Orient qui est le nôtre ?
Dans cet Orient qui est le nôtre comme vous dites, les choses se passent de manière radicalement différente. La religion est toujours le seul horizon de pensée; c’est toujours le seul discours du monde qui fasse le monde. Dès lors tout «trouble» introduit dans la configuration du religieux est un trouble introduit dans la cohérence du monde, son sens et sa représentation. Ici, le phénomène religieux, la croyance en Dieu est toujours un phénomène de société.
L’athéisme n’est pas, comme en Occident, un «phénomène de masse», mais un phénomène toujours individuel et individualisé. Et c’est bien parce qu’il en est ainsi qu’il n’est pas demandé aux gens de penser individuellement Dieu.
C’est la société, plus exactement la communauté croyante, à travers ses représentants légitimes, qui doit dire comment penser Dieu. Ce que j’en dis là ne s’applique pas particulièrement à l’extrémisme ou au fondamentalisme, ni non plus à l’une seulement des trois religions révélées qui enveloppent cette région du monde, mais bien aux trois, ainsi qu’à toutes les «sociétés/communautés» du Proche-Orient.
Q: Pourquoi selon vous cet écart si grand entre l’Occident et l’Orient?
Qu’est-ce qui a conduit l’Occident à renoncer à Dieu, et nous pas ?
Pour expliquer ces histoires différenciées, je ne puis que m’aventurer sur des terres inconnues. Ce que j’en dis relève du principe d’intelligence de l’histoire, plutôt qu’il n’en procède d’un principe d’explication.
Je pense que l’Occident, en Europe, à partir des XIIe/XVe siècles, a connu et vécu quelque chose que l’humanité avant lui n’avait pas connu ou vécu. C’est la première fois que dans l’histoire de l’humanité, le discours du monde qui fait le monde n’est plus comme naguère le discours de la religion qui a perdu, ontologiquement perdu pour toujours, sa force performative.
Le discours du monde de la modernité ne fait plus le monde, il se contente de l’expliquer ou de l’interpréter — (au grand dam de Marx. Cf. sa «thèse sur Feuerbach»: La philosophie n’a fait jusqu’à présent qu’interpréter le monde alors qu’il s’agit de le transformer).
Tout devait changer et être bouleversé par cette conversion dont devait sourdre et s’induire ce qui deviendra la «modernité». Tout: le rapport de l’homme à Dieu, au Sacré à l’au-delà et à la mort, son rapport à la vérité, à la nature, au langage, à la politique, au pouvoir et à la société, son rapport à soi, à l’autre, à la famille, son rapport au temps dans toutes ses catégories confondues (passé/présent/avenir), son rapport à l’instant et à l’éternité, son rapport à la nature…
C’est à cette époque, d’ailleurs que devaient naître les concepts fondateurs de la modernité: l’individu et la société, l’humanisme, le sujet et l’objet, l’objectivité et la subjectivité, l’infini, l’universel et l’universalité, l’économie, le marché, le capitalisme, la nation et l’Etat, les droits de l’homme et du citoyen, le concept de peuple comme actant de l’histoire, les syndicats et le syndicalisme, le concept de parti politique et de société civile…, et, surtout le concept du sens de l’histoire qui — faisant fond sur le concept d’une Histoire universelle de l’humanité postulé par Kant et les Aüfklerer —, fonde tous les discours du monde qui ont à expliquer le monde.
Car, c’est ce concept qui aura permis à l’homme de la modernité d’organiser la foule des événements qui lui viennent du monde physique, des mondes humains, des mondes non-humains et des mondes d’ailleurs, et de leur conférer un sens, en les subsumant, précisément, sous l’Idée d’une histoire universelle de l’humanité.
C’est sur les ruines du discours religieux, sur la «catastrophe» de la mort de Dieu que devaient s’édifier la trame de tous les discours du monde qui expliquent le monde de la modernité, et qui toutes devaient se mettre en perspective, à partir des Xve/XVIe siècles, selon les termes de cette idée d’une histoire universelle de la nature et de l’humanité.
Les premiers à se mettre en place, l’initiant, furent les discours de l’Astronomie avec la révolution copernicienne, de la Physique mathématique avec Galilée, de la Philosophie moderne avec Descartes, de la Politique moderne avec Machiavel, des sciences humaines avec la naissance de la psychologie aux Xve/XVIe siècle. Le reste devait suivre. C’est à tous ces discours qu’échoit, dans le monde de la modernité, le droit de dire le monde «en vérité», vocation qui revenait, de droit, au discours religieux.
Dieu est boutée hors de l’Univers. Et dès lors que Dieu est boutée hors du cosmos, les enjeux de la vérité ne relèvent plus de l’ordre du transcendant, que le discours religieux devait refléter, traduire et transmettre, mais de l’ordre de l’humain qui le construit et le valide.
C’est cette catastrophe — qui devait désenchanter le monde aux dires de Max Weber — que n’ont pas connu les peuples et les religions de l’Orient, pour nous en tenir à eux, ou, s’ils l’ont connue, ils ne l’ont pas reconnue.
Vous comprenez, pour revenir au début de notre entretien, qu’on ne puisse pas penser Dieu aux Xxe/XXIe siècles, selon que l’univers de représentations du monde de ceux qui le pensent s’inscrit dans la catastrophe reconnue, mais convertie par la modernité, ou dans une catastrophe vécue mais toujours méconnue.
Q: Et selon vous, la situation qui correspond à celle du Proche-Orient contemporain serait du type catastrophe vécue mais méconnue?
J’en ai bien peur. Je pense qu’au Proche-Orient on est confronté à la situation traumatisante d’un «effondrement méconnu».
Q: Qu’est-ce que cela veut dire, effondrement méconnu ?
L’effondrement correspond à une «crise des signes». Qu’il soit méconnu, signifie qu’il relève de l’indicible, de l’irreprésentable et dès lors du méconnaissable (ou du non reconnaissable); bien qu’éprouvée, cette crise des signes demeure obstinément invisible, car le reconnaître, menace d’ébranler les fondations d’une Loi fondamentale vécue comme sacrée; non reconnue, cette crise s’établit comme entité verbale mais sans lieu propre dans la compréhension de la totalité de ce qui se passe. Bref, on ne tient pas compte de ce qui s’est passé et on continue à fonctionner comme si ce qui s’était passé ne discréditait pas définitivement les croyances établies. On continue d’agir en pensée comme si le ciel, le soleil les éléments et les hommes n’avaient pas changé d’ordre, de mouvement et de puissance et ne sont pas différents de ce qu’ils étaient autrefois.
Q: Vous pourriez vous expliquer un peu plus ?
Oui, vous avez raison. Je vais réfléchir sur un exemple. Soit le nationalisme arabe. Je suis d’autant plus aise d’en parler que j’ai été durant une vingtaine d’années, bien que marxiste, un fervent militant du nationalisme arabe; et ce que je vous en dis là est une pensée «d’après-coup», une pensée d’après l’échec, d’après l’effondrement en catastrophe de son univers de discours et du système de représentations et de perception qui lui correspondait, quand la pensée fait retour sur l’échec pour chercher à en comprendre le sens. Car on peut fuir ce retour de la pensée réflexive et réagir comme si l’on pouvait en faire l’économie. Mais même si on réussissait à éviter de se poser les questions gênantes que pose cet échec, eh bien ce serait un effondrement vécu mais méconnu. C’est un effondrement qui serait, en termes de psychanalyse, refoulé je l’espère, occulté je le crains.
Pour en revenir au nationalisme arabe. Ce fut un phénomène de pensée qui a enveloppé la vie politique, culturelle, historique… de ces cinquante dernières années.
Tout le monde y a cru, ses ennemis qui le craignaient ainsi que ses partisans qui le créditaient d’une valeur absolue; et pourtant c’est un concept mythique, un fantasme de concept. Or, après-coup, ce qui m’a paru suspect, c’est d’abord sa date de naissance.
Car après tout, la naissance du nationalisme arabe a correspondu, historiquement, avec ce que l’on appelle la «chute» de l’empire ottoman, sa «balkanisation», son «démembrement»… bref son effondrement en catastrophe.
Mais ce qu’à l’époque de mon militantisme je n’avais pas compris, c’est que l’effondrement de l’empire ottoman en cachait un autre et le voilait, puisque s’y effondrait également quelque chose de la pensée religieuse de l’Islam qui portait cet empire, le supportait, le fondait et le légitimait aussi bien sur le plan social, politique, culturel, imaginaire, économique, anthropologique et, surtout, symbolique. La naissance du nationalisme arabe est venu, très précisément, recouvrir l’effondrement recèle de la pensée islamique, pour l’oblitérer.
D’ailleurs si l’on s’interrogeait sur le sens de ce phénomène, on pourrait se rendre compte que c’est un signe flou, au ventre mou, un signifiant sans signifié, ou plus exactement, que le signifié qui lui correspond se déclinant, connotativement, sur fond de pensée islamique, n’a correspondu à nul référent dans la mémoire de ces lieux, à nul référent dans la réalité historique des peuples de la région.
C’est en ce sens que la nationalisme arabe a fonctionné comme entité verbale mais sans lieu propre dans la compréhension de la totalité de ce qui se passe. Interrogez tous les slogans, tous les mots d’ordre, tous les postulats et les axiomes du nationalisme arabe vous retrouverez, comme des objets perdus, les mêmes «lieux de vérité», les mêmes topoï aurait dit Aristote, que ceux de la pensée islamique.
On y retrouve, mais comme objet non reconnu, l’unité de la oumma islamiyya, sa mémoire, son imaginaire… mais transcrites dans les termes profanes de l’unité (postulée) du peuple arabe. Or, rien ne dit que les «masses arabes», quand elles vibraient aux slogans de l’arabisme, n’y vibraient pas parce qu’elles se reconnaissaient dans le dénotatif du discours du nationalisme, plutôt que, comme je le pense maintenant, dans les échos islamiques que le discours du nationalisme arabe recelaient et auxquels il renvoyait connotativement.
C’est d’ailleurs cela qui a rendu le nationalisme arabe «acceptable» aux yeux des intellectuels et des masses arabes, et qui expliquerait le pourquoi de son «efficacité» (sic). Rétrospectivement on ne peut s’empêcher de remarquer que le nationalisme arabe n’a fait que reprendre à l’Islam, rétroactivement, la totalité de son legs, et qu’il l’a repris tel quel.
Quant à moi, je pense que le nationalisme arabe a permis aux gens d’ici d’occulter, de refouler l’effondrement de l’empire ottoman, certes, mais, surtout, d’occulter le sens recèle de celui de l’Islam.
Et j’ai bien peur que ce ne soit un effondrement à répétition qui a donné à s’illustrer dans l’histoire contemporaine du «Monde arabe» (sic) — de la naqba de 1948, à la naksa de l’expédition de Suez en 1956, à la hazima de 1967, à l’effondrement de l’unité syro-égyptienne, à la mascarade de la victoire de la Guerre d’octobre de 1973, à la l’invasion du Liban en 1982, suite de catastrophes qui s’est conclue, tout naturellement, par un retour à l’Islam, radical ou pas, comme si de rien n’était dans la mémoire de ces lieux.
Q: Quelles conséquences cela a-t-il, pour les gens d’ici? Comment pourront-ils «penser Dieu» aux XXe/XXIe siècles ?
Une rétraction de celui qui est saisi par la peur devant les menaces de destruction de cette Loi de l’identité et de la reconnaissance; un rapport au réel qui se tisse selon un palimpseste indéchiffrablement oblitéré, mais subsumé en définitive par de l’imaginaire sur lequel s’écrit et s’efface l’histoire; et, sur le plan religieux ou de la foi, on assiste à l’émergence d’une espèce d’hortogolossie qui donne «la prééminence au dit sur la pensée», à l’absolue nécessité de passer par tous les détours obligatoires du dit, à une ritualisation de la pensée et de la foi… toutes choses qui caractérisent la pensée fondamentaliste (Cf. Les Talibans, le GIA en Algérie ainsi que les autres radicalismes)… Bref on n’ose plus réinventer ce que pourrait être la vie.
Q: Est-ce à dire qu’on doive renoncer à l’Islam?
Les choses m’apparaissent plus complexes que cette formulation abrupte. L’exemple de l’Europe et de l’Occident, où le retour du religieux et le renouveau du christianisme sont manifestes, m’inciterait à plus de prudence.
Il ne s’agit pas de renoncer à l’Islam (ou à sa religion). Je ne prêche pas l’athéisme, je n’y crois pas. Mais, il me semble évident, de par ailleurs, que la parole du poète est vraie. «Rien n’est que par la mort», affirme Bonnefoy dans L’Improbable.
Et il faut bien que quelque chose meure dans l’Islam (pour réduire celui-ci à un exemple et cet exemple à un repère symbolique) afin qu’il puisse se réinventer, réinventant la vie… Car il me semble, qu’un des paradoxes de la répétition du même réside dans le fait que pour cesser d’être une répétition il faut qu’elle soit reconnue comme telle, c’est alors que quelque chose de nouveau peut naître.
Q: Sinon? …
Sinon… Je ne sais pas ! Si les choses me paraissent si sombres, c’est parce qu’il me semble que l’Islam (encore une fois pour réduire celui-ci à un exemple et cet exemple à un repère symbolique), il me semble donc que l’Islam est plongé dans une problématique de l’impuissance: il y a comme le sentiment qu’il lui est impossible d’agir sur son destin…
C’est une authentique crise culturelle, mais une crise où les moyens intellectuels de se la représenter font défaut. Et surtout de se la représenter d’une manière positive. C’est cette incapacité à trouver les concepts nouveaux permettant d’appréhender la crise qui est tragique. Elle est intimement liée, je pense, à la méconnaissance qui frappe l’effondrement vécu et méconnu…ainsi qu’au fait que du nouveau n’ait pas émergé!
… Et demeure au fond de cette démarche passéiste, le refus de reconnaître la catastrophe qui nous est advenue. Le fondamentalisme c’est bien cela. Je ne pense pas qu’il faille l’expliquer par la psychologie, même comprise comme psychologie de masse.
Car, par delà l’appréciation morale qu’on peut y porter, le fondamentalisme c’est une tentative désespérée d’oblitérer la nouveauté du présent, dès lors que celui-ci se doit de retrouver le passé prophétique — comme l’on «retrouve un objet perdu», pour coïncider avec lui.
Au fond, le fondamentalisme (qu’il soit chrétien, juif ou musulman) c’est, toujours et partout, l’invention du mouvement avec de l’immobilité.
L’avenir n’est plein que du passé, et le temps, un moyen pour remonter vers le passé perdu de la «promesse».
Illustration
Photo taken at night from a high point in Kfour Kesrwan, in the picture you can see Kfour, Jounieh, Harissa Mountain, Jounieh Bay, etc.
http://www.lebanoninapicture.com/pictures/view-of-city-lights-from-top
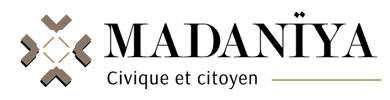


C’est du lourd, c’est du profond, c’est du limpide. Je l’ai lu avec grand intérêt. Merci à Roger.