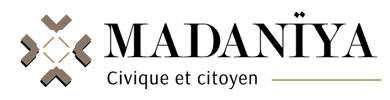Dernière mise à jour le 5 février 2024
Le Liban, théâtre de deux guerres civiles (1958/ 1975-1990), célèbre en Mars 2020 le cinquième mois d’un soulèvement populaire, qui transcende les clivages ethnico confessionnels, en signant la faillite de la chefferie traditionnelle. Retour sur ce phénomène politico social, à l’arrière-plan d’une confrontation stratégique entre l’Iran et les États Unis. La version arabe de ce texte est co-publiée par la prestigieuse revue littéraire Al-Adab, fondée par Souheil Idriss, l’un des grands romanciers arabes du XX siècle, grand traducteur de la littérature existentialiste et père de Samah Idriss, l’actuel directeur https://al-adab.com/
- https://www.courrierinternational.com/notule-source/al-adab
- https://cpa.hypotheses.org/4165
- http://daraladab.com/text.php?id=69
Beyrouth, Janvier Février 2020
Roger Naba’a, philosophe libanais, contributeur du site https://www.madaniya.info/
«L’idée de révolution est plus féconde que la révolution elle-même.» Anne Honymes, Écrits sur la révolution, Paris, Le Cercle jacobin, 1789.
Prologue
Un évènement inédit
Il y eut soudain comme une étincelle qui se propagea en éclat. Une colère qui leur venait de loin les a précipités dans les rues et les places publiques de toutes les villes et les bourgs du Liban, de Tripoli à Beyrouth, à Tyr, à Nabatiyyé, à Baalbeck, à Sayda, à la Bekaa, au ‘Akkâr, à Jbayl.
Effaçant les barrières confessionnelles, régionales, de classe, de genre et d’âge, leur révolte a entrainé les Libanais sur ces rues et ces places qu’ils ont occupées, y ont bivouaqué, chantant, dansant, dessinant, sculptant, festoyant et discutant.
Depuis cinq mois maintenant, contestant une classe politique corrompue, en faillite et ayant mis le pays en faillite, de ces rues et de ces places ils exigent tout : la chute du régime, la fin du confessionnalisme, un État civil, le dégagement de la classe politique, la traduction en justice des corrompus et des véreux, la récupération de l’argent volé par milliards de dollars, la surveillance des banques, tout.
Quand une population surpasse sa peur, quand elle dépasse ses divisions et ses antagonismes qui l’empêchaient de se retrouver unie, quand elle accepte de s’assembler dans un même combat, bref quand elle passe à l’acte, alors seulement une chose pouvant s’appeler «peuple» commence à s’articuler et à prendre forme pour commencer à s’exprimer comme «souveraineté populaire» contre toutes les autres – celle de l’État, des zu’amâ’, des confessions – qui l’aliénaient. Réclamant son dû, sur toutes ces places ce «peuple» exerce son droit de s’exprimer «souverainement» et non plus d’«être exprimé» selon la «souveraineté des autres».
Il montre, de par ce passage à l’acte, le respect dû à sa dignité et à ses droits. Dans ces nouveaux espaces publics, se réappropriant sa situation et sa voix politique dont il était dépossédé, ce «peuple» qui n’avait pas de place dans les décisions prises et qui cependant le concernaient au plus haut point, veut s’y imposer au titre de sa «souveraineté» nouvellement acquise et qu’il apprend à exercer dans les forums, les débats, les discussions, les conférences, … qui se tiennent sous les tentes dressées dans les rues et les places
Aussi les expressions auxquelles on a eu recours pour rendre compte de ce phénomène – un évènement «inouï», «inédit», «du jamais vu», «du sans précédent», «du sans pareil», «du sans égal», d’«unique», d’«extraordinaire» – semblent-elles justifier la «nouveauté» de ce qui est advenu au Liban et continue d’advenir aux Libanais.
En soi, la tenue de manifestations à caractère social ou économique n’est pas un fait nouveau au Liban. À différentes occasions des groupes (enseignants, ouvriers, étudiants, …) se sont mobilisés pour revendiquer leurs droits économiques et sociaux.
Cependant, ce qui le rend unique, c’est que le mouvement d’Octobre s’est «dé compartimenté » pour se généraliser au travers de la cristallisation de trois crises majeures: la crise de l’État, la crise de la classe dirigeante et la crise de la société.
Mais l’originalité de ce Mouvement ne tient pas seulement à la généralisation de la crise, mais également par rapport aux mouvements de rue qui ont jalonné l’histoire du Liban depuis son indépendance, quand les mouvements en interne, de nature «domestique», visant à améliorer les conditions de vie (cherté de la vie, salaires, etc.) ne débouchaient, de mémoire du Liban indépendant, jamais au grand jamais sur une crise politique, et encore moins une crise de régime comme c’est le cas avec le soulèvement d’octobre 2019. C’est une première, car seuls les mouvements en externe, dont les revendications étaient de nature «géopolitique» (1958 : crise du Pacte de Bagdad versus le nassérisme; 1969-1982 : crises emboitées de l’irruption de la Résistance palestinienne sur la scène libanaise) ont conduit le régime à ses confins, à la discorde, à la guerre intestine et à la région, à l’internationalisation de la crise.
Si les seuls en externe ont donné naissance à une crise politique – voire carrément une crise de régime avec l’irruption de la Résistance palestinienne sur la scène libanaise (1969-1982) – c’est que ces mouvements, dans la mesure où ils portaient sur la politique étrangère du Liban laquelle détermine le camp auquel il se rallie et s’affilie, portaient de par-là même sur son identité: un Liban identifié de par sa «Phénicie» et son «occidentalisation» versus un Liban inscrit dans le tissu régional des solidarités, s’identifiant, selon les époques, à l’appel de la Grande Syrie dans la décennie 1940, à celui de l’arabisme dans les décennies 1950-1980 à travers le nassérisme ou le baasisme et, dans la décennie 1960, à travers l’appel de la Résistance palestinienne. Deux identités antinomiques, à somme nulle: «Deux négations ne font pas une nation», prophétisait Georges Naccache en 1949.
Or le mouvement d’Octobre 2019 se distingue également de ces mouvements «géopolitiques», en ce fait capital que dans ce mouvement, la rue libanaise est un acteur à part entière, pendant que lorsqu’elle était «arabo-libanaise» – ou comme maintenant, «irano-libanaise» – elle était déterminée par un acteur «étranger» (l’Égypte nassérienne, la Résistance palestinienne, la République islamique d’Iran, etc.) à la scène libanaise et aux intérêts «domestiques» de la rue qui se soulevait.
Subjuguée par les bouleversements qui advenaient à un rythme haletant dans le sens de ses attentes (1952, «révolution» égyptienne; 1958, l’irakienne; 1958, unité syro-égyptienne; 1979, Révolution islamique), cette rue externe a applaudi, s’est enthousiasmée, s’est emballée, a soutenu avec entrain les bouleversements en cours mais n’y participa pas en tant qu’acteur.
Entérinant le faire des autres, de la «politique de rue» n’émergea jamais quelque chose qui serait comme un faire propre à elle, décidé par elle et conduite sous sa direction, ne fût-ce que partiellement.
Aristote, demos et plethos
Dans l’ordre politique, si la «rue» au Liban fut ce lieu trop plein de gens, elle fut tout à la fois un lieu politiquement vide. On peut recourir à Aristote pour chercher à s’expliciter l’énigme de ce «trop plein du vide». Pensant la population de la cité, Aristote a recours à deux vocables, demos et plethos. D’après les connaisseurs, il réserverait l’usage de demos à la réunion des individus qui composent la cité en tant qu’elle agit politiquement. On peut en déduire que demos réfère au «peuple comme sujet politique» et «sujet du politique»; pendant qu’il utilise plethos quand il veut parler de la multitude, du grand nombre d’individus réunis au gré des circonstances mais qui, comme telle, n’agit pas en politique et n’en est pas un acteur. Ainsi, là où demos saisirait le «peuple» comme organe de la cité, plethos semblerait correspondre à ce genre de rassemblement populaire qui prendra, au XIXe siècle, le nom de «foule» qui, réagissant passionnellement à une situation donnée se rassemble éphémèrement, le temps de la colère, puis se dissout sitôt la colère passée. Aussi vite assemblée que désunie, elle reste sans effet aucun sur le politique.
Ce long détour par Aristote pour dire que, contrairement à ce qui est dit et cru, il me semble que la rue «arabo-libanaise» ou «irano-libanaise» relève du plethos plutôt que du demos, n’ayant pas de puissance en elle-même, sa mobilisation dépend entièrement de ce qui n’est pas elle, cependant que le mouvement d’Octobre se présente bien, lui, comme le seul mouvement de rue qui ait vocation de demos. Mais n’anticipons pas.
De «l’ingouvernementalité» du Liban à la révolte des Libanais
«Les révoltes ont un corps avec lequel il est possible d’engager la lutte. Les révolutions, en revanche, ont beaucoup en commun avec les spectres.» Metternich à Guizot, 31 octobre 1847[1]
Or donc il y eut l’impôt sur le WhatsApp et il y eut la révolte. De l’un à l’autre, de l’impôt à la révolte, c’est comme si le ciel s’était enflammé et que le monde avait changé de teneur ; les heureux temps de l’Etat ne furent plus, depuis qu’en ces lieux les dieux ont soufflé le vent de l’intempestif pour ouvrir la politique du Liban au temps à venir.
Est-ce une révolte, une rébellion/«tamarrud» ; une «thawra»/révolution, un soulèvement/«Intifâda» ou un «hirâq»[2] comme aiment à l’appeler les insurgés eux-mêmes ? Difficile de répondre à cette question tant l’incertitude propre à la dynamique actuelle de ce mouvement rend aléatoire tout pronostic quant à son issue politique, quand bien même ce serait dans l’enthousiasme de la certitude que se vit le bouleversement porteur d’une si belle promesse. D’autant qu’en la matière, le nom d’un évènement de cette ampleur qui veut s’inscrire dans l’histoire du Liban comme un évènement de bascule, devrait lui venir après coup, quand le mouvement aura accouché de sa vérité à la lumière de laquelle on pourra lui donner le nom qui lui convient.
Néanmoins, s’il est impossible pour l’heure de nommer en vérité cet évènement phénoménal, on peut à tout le moins déterminer la nature de la crise qui se trouve en être à l’origine. Et si l’impôt sur le WhatsApp n’en fut pas la cause, c’en fut néanmoins la goutte d’eau qui fit déborder la vase.
2 – Gouvernementalité et crise de gouvernementalité
Au travers des mots et des slogans criés par les contestataires – «Le peuple veut la chute du régime», «Tous, c’est-à-dire, tous», «Dégagez», «Lâ Islâm wa lâ masihiyya, badna wihdé wataniyya)» [Ni musulmans ni chrétiens, on veut l’unité nationale] et tant d’autres repris, chantés, dessinés, peints ou sculptés – les manifestants ne protestent pas seulement contre la corruption de la classe politique, la paupérisation du pays, le système confessionnel ou la faillite de l’État ; mais beaucoup plus fondamentalement contre la façon dont ils sont gouvernés, inaugurant par là une «crise de gouvernementalité» selon l’expression de Michel Foucault.
Au-delà de la dramaturgie qui l’entoure, cette crise s’inscrit dans une histoire dans laquelle la « gouvernementalité confessionnelle » ne fut pas toujours décriée ni dénoncée. Elle eut même, avant la guerre de 1975-1990, notamment avec Fouad Chéhab, son heure de gloire. Elle n’entra en crise qu’après la guerre.
Mais avant que de nous aventurer dans le pourquoi de cette entrée en crise, qu’entendre, selon Foucault repris par nous à nos risques et périls, par «gouvernementalité» et «crise de gouvernementalité» ?
Gouvernementalité …
Dans les procédures de gouvernementalité, en revanche, il n’y a pas de cession de la volonté ni de renoncement à la volonté, il y a des techniques qui guident la volonté des individus de façon à ce qu’ils veuillent ce que d’autres veuillent, qui les orientent de façon à ce qu’ils se conduisent suivant la manière dont ils sont conduits par d’autres. »[3]
Ainsi donc, gouverner consiste à «aménager les conditions dans lesquelles la liberté des individus, jouant librement, pourra produire des effets d’ensemble conformes aux objectifs attendus.»[4]
Gouverner relèverait non de l’exercice de la contrainte par laquelle une volonté s’impose à une autre, mais plutôt d’une «conduction indirecte», de ce que Foucault appelle une «conduite des conduites».
Celle-ci suppose de jouer activement sur l’espace de liberté laissé aux individus pour qu’ils en viennent à se conformer d’eux-mêmes à certaines normes. Il ne s’agit donc pas, comme il est dit et cru, de gouverner contre la liberté, mais par elle et grâce à elle, étant entendu que par «liberté» il faut entendre ici non pas le «libre arbitre», mais le fait que l’action ait à choisir entre plusieurs possibles dans une situation donnée. Le terme de «gouvernementalité» aurait l’avantage de signifier ce nouveau mode de gouvernement des hommes, qui ne se confond nullement avec l’action du «gouvernement» au sens de l’institution qui dirige un État. L’essentiel n’est pas l’adhésion intellectuelle des individus aux normes, ni leur consentement actif et volontaire, mais la contrainte exercée sur le choix des individus par des situations qui se construisent à l’insu de la population et des dirigeants, mais avec leur concours.
et « crise de gouvernementalité »
Si gouvernementalité indique «l’encadrement des hommes pour les amener à réaliser par eux-mêmes des fins déterminées par le pouvoir», crise de gouvernementalité indique, par contre, la remise en cause par les gouvernés eux-mêmes, de la façon dont ils sont gouvernés. La contestation peut n’être d’abord que localisée, mais pour qu’il y ait crise de gouvernementalité il faut qu’elle s’élargisse pour mettre en question le dispositif général de gouvernement, l’ensemble des relations de pouvoir. Le mouvement d’Octobre traduit bien une «crise de gouvernementalité» dans la mesure où la contestation y est l’expression d’un sentiment d’abus local et particulier (nouveaux impôts sur l’essence, le tabac et les appels en lignes/taxe WhatsApp) mais qui s’est très rapidement élargi à l’ensemble des relations de pouvoir, voire au dispositif entier de gouvernance. En cela c’est une manière certaine et explicite d’exprimer un refus: «nous ne voulons plus être gouvernés ainsi».
Aussi le propre de la contestation du mouvement d’Octobre c’est qu’elle déborde le cadre du système politique stricto sensu pour mettre en cause non seulement son ordre normatif propre mais aussi le modèle culturel général (le système culture !) qui lui assure sa légitimité profonde et s’attaque au système qui a la plus grande valeur «contrôlante».
C’est la raison pour laquelle le soulèvement d’Octobre déborde le terrain spécifiquement politique, ses fronts d’attaque étant simultanément les fronts politique, économique et culturel.
Or donc si crise de la gouvernementalité confessionnelle il y a, il s’agit de la nouvelle gouvernementalité, celle qui s’est mise en place après la guerre, façonnée par la convergence de trois dynamiques : la faillite de l’Etat ; la guerre et l’émergence d’un ordre milicien ; et surtout mais surtout, la tutelle syrienne et la syrianisation de la vie politique libanaise qui transforma de fond en comble les rapports gouvernants/gouvernés.
De la gouvernementalité d’avant-guerre à celle de l’après
«À 73 ans, Marie … pour subvenir à ses besoins, se ravitaille à Beit al-Baraka, un supermarché gratuit à Beyrouth. « La situation est pire maintenant. Aucun politicien n’agit de manière responsable. Nous n’existons pas à leurs yeux ».»[5]
Tournant charnière à plus d’un titre, 1989-1990 s’est distingué par l’accord de Taèf (1989)[6], lequel consacra la tutelle syrienne sur le Liban[7] et dans la foulée, la syrianisation autoritaire qui se saisira de la vie politique libanaise, et, dernier des traits qui mériterait d’être retenu dans la perspective qui est la nôtre, la montée en puissance[8] du capital financier. Ce sont ces faits qui, au terme de la guerre, introduiront de nouveaux types de rapports de pouvoir, lesquels ne manqueront pas de donner un tour nouveau à la gouvernementalité confessionnelle.
Non pas que le système politique eût changé ! C’est toujours le même système confessionnal-clientélère. Mais par contre ce qui a changé, et du tout au tout, constituant le fond du nouveau mode de gouvernance, ce sont la grammaire des rapports gouvernants/gouvernés et la nature du régime politique.
Grammaire des rapports gouvernants/gouvernés
Dans la gouvernance d’avant-guerre, le respect des sujets de la communauté (les gouvernés), comme sujet de droits et de devoirs, par ses dirigeants (les gouvernants) pour le bien de la communauté – on était dans une logique holiste -, était la politique suivie. Certes, s’ils ne sont pas, dans le système d’alors, des sujets de la politique, ils constituaient néanmoins des sujets dans la politique communautaire, statut qu’ils perdront dans la gouvernance de l’après-guerre. Et la révolte d’Octobre peut se comprendre ou s’interpréter comme un refus des Libanais d’être méconnus ou, ce qui revient au même, une comme lutte pour leur reconnaissance politique, cependant plus seulement au regard de la communauté mais à celui de l’État que l’on veut précisément et désormais «civil» ou «citoyen».
Le modèle syrien aidant, la nouvelle classe politique[9] s’est ainsi constituée en «société à part», totalement déconnectée, voire coupée de ses sujets respectifs qui ne sont plus que l’objet de son pouvoir, tout au plus un simple moyen, plutôt que sujet d’une politique communautaire; et nous passons d’une logique holiste/communautaire a une logique de chefferie individuelle [za‘âma fardiyya]
Et depuis ce tournant de la décennie 1989-1990, la classe politique libanaise, à l’instar de sa consœur syrienne, ignore non pas seulement les aspirations de ses gouvernés, mais les gouvernés eux-mêmes.
Depuis, pour elle, c’est comme si les Libanais n’étaient pas. Réduits à rien, elle n’en tient pas compte ni ne s’en soucie, dans la mesure où les Libanais, aux yeux de la classe dirigeante, seraient une néantité ou, comme dit Jacques Rancière, des «sans-part»[10], certes, des déshérites ou des exclus du partage de la manne mais, plus radicalement, exclus de la parole en ce que la leur est privée des conditions nécessaires à son expression et ne peut être entendue parce que rendue inaudible du fait qu’ils ont été «effacés de l’espace public» tout comme de celui de leur communauté. Autocentrée sur elle-même, elle estime n’avoir de compte à rendre à personne et jouit d’une impunité totale[11].
Le comportement de cette classe, toutes ses composantes confondues, est une illustration exemplaire de son je m’en foutisme. Contrairement à ce qui est dit et cru, un conflit n’est pas le contraire d’une relation sociale, bien au contraire, c’en est une, mais c’est un type particulier de relation social: être en conflit avec quelqu’un/un groupe… n’est-ce pas en connaître et reconnaître l’existence plutôt que l’ignorer ?
Or la classe politique ne veut même pas reconnaitre qu’elle est en conflit avec sa société, et par-là, ne pas reconnaitre[12] qu’elle est.
En l’occurrence, en traitant avec mépris l’Intifada, il s’agit d’un déni d’existence, non pas seulement de l’Intifada, mais de la société qui s’insurge, comme l’a démontré à l’envi son comportement, regardant la rue insurgée sans la voir ni l’entendre, ni vouloir la comprendre, ne cherchant même pas à se réapproprier ses revendications. C’est comme si l’Intifada n’existait pas et n’a jamais existé. La traitant comme un non-évènement, elle a persévéré dans son jeu de muhâçaça[13] pour former un gouvernement, après la démission de Saad Hariri, non pas de crise ou de salut public, mais des plus ordinaires. Un mépris royal !
Face à la crise – tout comme face à toutes les questions de fond : sur le système et son fonctionnement, sur la corruption, sur les gros scandales – la classe politique se comporte de même : elle fait front commun, resserre ses rangs et dénie tout quand bien même bien elle s’affronterait férocement sur d’autres thèmes, notamment sur la politique étrangère.
Or, ce qui s’est exprimé à travers la révolte d’Octobre, n’est-ce pas précisément la quête de dignité, c’est-à-dire la volonté des Libanais d’échapper au mépris de ses dirigeants et de mériter enfin ce que leur confère ce beau nom de peuple qu’on leur dénie ?
Caractéristiques du nouveau régime politique
La fin de la guerre n’a pas mis fin à la guerre parce que l’Accord de Taèf, censé y mettre fin, n’a pas réussi à mettre un terme à la lutte des grandes confessions[14] pour la conquête de la ghalaba d’Etat[15].
Bien au contraire, comme projet de réforme du partage des pouvoirs, Taèf a fait passer le Liban d’un Etat dominé par une seule communauté, les chrétiens maronites, à un Etat partagé entre ses différentes grandes communautés. Or une telle formule, ne pouvait achever la guerre : elle ne pouvait qu’engendrer de nouvelles luttes pour la conquête de la ghalaba d’Etat.
La pax syriana a pu faire illusion dans la mesure où la tutelle syrienne avait confisqué cette ghalaba à son profit, suspendant la lutte pour sa conquête. Mais sitôt les Syriens partis (2005), la lutte reprit de plus belle[16]. Paraphrasant Clausewitz on pourrait dire, à la suite d’Ahmad Beydoun[17], que pour les grandes confessions, la paix, après le retrait syrien, a été une continuation de la guerre par d’autres moyens.
Il est vrai que la lutte pour la conquête de la ghalaba d’État est la marque de fabrique du Liban indépendant.
Mais dans la période d’avant la guerre, les maronites, adossés à la France, puissance mandataire (puis aux Etats-Unis à partir de 1958) avaient réussi à conclure cette lutte – et donc à provisoirement la clore – en l’enlevant à leur profit.
Aussi de son indépendance jusqu’aux accords du Caire (1969), à part les troubles de l’été 1958, le Liban sous la ghalaba des maronites connut-il une ère de stabilité et de prosperité. Ce qui ne fut pas le cas après Taèf qui inscrivait le conflit dans le « Préambule » même de l’Accord, lequel stipule dans l’un de ses attendus, l’article «J», que «Tout pouvoir qui contredit la charte de vie commune est illégitime et illégal», définissant par là ce qu’on désignera par mithâqiyya et qu’on peut traduire par «pactualité» (de «pacte») ; conflit qui sera soulignée en abyme par la mise à mort du pouvoir exécutif.
En effet, si les prérogatives du Président de la République ont été, avec Taèf, largement réduites, il reste que Taèf s’est débrouillé pour rendre quasi impossible toute prise de décision gouvernementale dès lors que les prérogatives du chef de l’État ont été transférées au Conseil des ministres qui devient, lui, l’organe de prise de décision, rendant ainsi collégiale la direction de l’exécutif[18].
Car, d’après Taèf toutes les communautés (en tout cas les grandes d’entre elles) doivent se mettre d’accord sur la politique du pays et, de ce fait, le consensus devient nécessaire pour éviter qu’une minorité – ou une seule communauté – ne prenne une décision qui engage le tout[19].
Quand le consensus s’avère impossible, on passe au vote et les décisions sont alors prises à la majorité simple pour les questions courantes pendant que les «sujets essentiels»[20] requièrent l’approbation des deux tiers des membres du gouvernement, ce qui explique l’acharnement du Hezb et de ses alliés à obtenir le 1/3 de blocage.
En condamnant l’action du gouvernement au consensus, Taèf le condamnait soit à l’impouvoir soit à une continuelle épreuve de force ; du coup, le Liban ne traversait plus une crise ni n’était en crise, mais dans un temps en crise qu’illustra parfaitement la crise de 2007[21]-2008, qui sera à l’origine d’un nouveau cycle de crises. L’incapacité des acteurs libanais à trouver un successeur à Emile Lahoud, en 2007, dans le contexte des tensions aiguës consécutives à l’assassinat de Rafiq Hariri (2005), au retrait syrien (2005) et à la guerre de 2006, entraîne une vacance de la Présidence. Une série de manifestations et de sit-in, conduites par le duo chiite (Hezbollah-Amal), auquel s’associera le Courant patriotique libre (CPL) de Michel Aoun, condamna à la mort économique et social le Centre-ville. Rien n’y fit.
Les 7 et 8 mai 2008, le Hezbollah et ses alliés du 8 Mars prirent le contrôle de Beyrouth. Il a fallu la médiation du Qatar et les accords de Doha pour résoudre la crise.
Mais par de-là les solutions attendues – élection d’un nouveau Président de la République (le général Michel Sleiman), formation d’un gouvernement dit d’unité national – la crise ne fut réglée au vrai que par l’instauration d’un droit de veto (le 1/3 de blocage) accordé aux 8-Marisistes, qui conclurent ainsi, à leur avantage – notamment à celle du Hezbollah[22] -, la marche vers la conquête de la ghalaba d’État.
À la fin du mandat de Michel Sleiman (mai 2014), l’absence d’accord – un défaut de consensus – entraine à nouveau une longue vacance du poste qui perdurera jusqu’à 2018. Dans le même temps, le gouvernement a lui‑même été partiellement ou totalement entravé dans son action, soit à cause de longues périodes de consultation pour la nomination d’un Président de Conseil, soit à cause de la démission d’une partie du gouvernement. Enfin, les élections législatives prévues en 2013 ont été repoussées à deux reprises, faute de consensus sur la loi électorale. Ce blocage des institutions n’est-il pas la traduction politique de l’impossible consensus et n’a-t-il pas eu pour conséquence de mettre l’État et le pouvoir en régime de crise.[23]
Vingt-neuf ans après la fin de la guerre, l’État a prouvé qu’il était incapable de s’imposer comme autorité centrale et continue.
A cette crise institutionnelle, s’ajoute la dérive de la classe politique mis en place par les milices entre 1975 et 1990 et la Syrie après Taèf. Réduisant son ambition politique à l’extrême, il semble bien que la classe politique post-Taèf n’ait eu pour tout projet politique ou de société, et en tout cas pour seul programme d’action, que celui de se maintenir au pouvoir pour ses privilèges matériels et symboliques, à travers la sauvegarde de sa clientèle. Aussi a-t-elle choisi de détourner le contrat social vers un contrat entre chefs communautaires (les zu’amâ’), détournement qui passe par la captation des ressources de l’État en faveur de ses intérêts clientélistes et de ses intérêts privés, en flagrante contradiction avec l’intérêt des Libanais.
Dès lors, l’obtention et la distribution de la manne politique feront l’objet de luttes acharnées. La culture consensuelle du système libanais, et le perpétuel partage des pouvoirs qui s’ensuivait, exigeaient l’emprise des élites sur les ressources disponibles pour être à même de se répartir systématiquement les parts (muhâçaça) entre les principaux acteurs. Aussi l’oligarchie au pouvoir a-t-elle canalisé de manière parasitaire les ressources de l’État vers ses réseaux clientélistes et, par la force des choses, elle s’est très fortement intriquée avec les milieux d’affaires (immobilier, banque, commerce, tourisme, …).
Selon la presse spécialisée[24], en 2013, 29% du capital de 7 banques est entre les mains de huit familles comptant des hommes politiques, dont certains de premier plan. Ce qui amène à sérieusement s’interroger sur l’indépendance des politiques gouvernementales, notamment en matière de réduction de la dette dont le service représente 36% du budget de l’État. Or, les dividendes issus des bons du Trésor représentent 280 millions de dollars soit 31,8% du total des revenus du secteur. Des politiques de diminution significative de la dette auraient ainsi pour conséquence de réduire les revenus de ces acteurs politiques.
Enfin, facteur aggravant car il faut bien que les banques placent leurs excédents de trésorerie, elles n’ont rien trouvé de mieux à faire que d’investir dans des obligations de l’État libanais, qui ne valent pas grand-chose, vue la dette du pays – mais pour lesquelles l’État paye un intérêt démesurément supérieur aux taux du marché à seule fin d’obtenir les liquidités dont il a besoin (de 4% à 7% au-dessus du marché selon les cas !) le système a continué à tourner avec des rémunérations de dépôts supérieures au marché, afin d’attirer l’argent de nouveaux souscripteurs.
L’incapacité du système à gérer sa propre crise est évidente, les dirigeants ne cherchant pas de réponse, ni politique ni autre, aux problèmes du Liban
Ainsi, Octobre ne s’origine pas seulement dans l’incapacité de l’État, mais bien plus dans le je m’en foutisme affiché des responsables à répondre et à apporter des solutions efficaces aux problèmes quotidiens de la population, cependant que le Liban est en état d’urgence économique depuis belle lurette, qu’il connait un taux de chômage des jeunes à plus de 30%, qu’un quart de sa population vit sous le seuil de pauvreté, que sa dette publique avoisine les 90 milliards de dollars, soit 150% du PIB, qu’il manque cruellement d’infrastructures, que des coupures quotidiennes d’électricité et d’eau potable sont le lot quotidien des Libanais
3 – Limites et promesses du soulèvement d’Octobre 2019
«Je me révolte, donc nous sommes.» Albert Camus, L’Homme révolté
Le soulèvement d’octobre est, dans l’horizon libanais, un évènement à la frontière des évènements, comme l’ailleurs de tous les évènements qui peuvent ou ont pu lui ressembler: un événement où le «bon peuple», muet, pitoyable, consentant, soumis s’est brusquement levé en cette nuit d’octobre pour se transformer en autre chose, en «un peuple pour de vrai».
Peu importe le nom qu’on lui donnera, l’essentiel étant cette rupture dans l’ordre établi. Certes, l’ordre ancien n’a pas été renversé, ni remplacé par un autre nouveau, mais l’Intifada restera comme un événement mémoire qui a réussi à changer, aux yeux d’une partie des Libanais – et de tous, peut-être, par la suite – le sens de la société et de la politique.
Sans doute on ne peut déterminer, au moment même d’une crise, si cette dernière est un élément constitutif d’une révolution ou si elle n’est qu’un simple mouvement de révolte, mais dès lors qu’une révolution n’est pas identifiable sur le moment même de sa réalisation il est nécessaire de laisser un espace temporel entre le déclenchement de la crise et sa suite, pour apprécier dans toute son ampleur la réalité et l’effectivité du changement de paradigme. Néanmoins, rupture il y a eu, changement de discours et d’imaginaire social il y a eu ; peut-être pas assez fortement pour que s’élabore une «formation sociale», c’est-à-dire que s’inventent d’autres rapports sociaux et que se disposent les vecteurs politiques (partis, relais sociaux) à même de réaliser les aspirations de cette formation en gestation et de les organiser en vue de la bataille politique qui se prépare.
Dans le cas du Liban la formation sociale en voie de naitre ne s’est pas encore engendrée en culture populaire de masse ni ne s’est dotée de ses vecteurs politiques et sociaux suffisamment transversaux et forts pour renverser les puissantes structures communautaires ; aussi, parallèlement à la rue révolutionnaire, a subsisté tout au long de l’Intifada des rues confessionnelles (chiite, chrétienne/maronite, druze, sunnite) concurrentes.
Ce qui aura manqué à l’Intifada d’octobre, c’est probablement une pensée de la politique comme rapport de force stratégique à l’œuvre. Il y a comme une valorisation de la révolte pour elle-même, sans nécessairement de traduction politique, comme s’il suffisait de manifester et de tenir les places publiques pour que le pouvoir en place cède. Or le moment crucial pour réussir un moment de bascule est celui où l’on construit cette stratégie pour aboutir à un véritable renversement politique. Or, bien que le voulant, il n’y a pas eu, face au pouvoir, une formation sociale qui prenne conscience d’elle-même et puisse s’imposer.
Et quand bien même l’Intifada ne pourrait pas changer la gouvernementalité du Liban, le Liban, lui, ne pourra plus faire comme si l’Intifada n’a pas eu lieu. Car si le retour au statu quo ante n’est plus possible, un changement radical – à savoir la suppression complète de l’oligarchie au pouvoir – reste peu probable.
Mais, comme l’indique le slogan d’Extinction Rebellion[25], « Quand l’espoir meurt, l’action commence».
Les Libanais n’espèrent rien quant à la capacité des dirigeants à gouverner autrement. Mais c’est précisément cette désillusion qui fait la force de leur Intifâda et la rend immaîtrisable et « ingouvernable » par ceux du pouvoir en ce que, désormais et de plus en plus, le Pouvoir et les communautés perdront la capacité à orienter l’action collective de leurs sujets et à discipliner leurs conduites au nom de leur «rationalité».
En ce sens l’Intifada d’octobre a réussi à mettre en crise les dispositifs de gouvernementalité libanais. Le refus d’être gouverné comme il l’était est, pour le et les pouvoir/s en place, tout simplement désarmant.
Depuis octobre, quelque chose s’est déclenché et ne quittera plus les Libanais.
Références
[1] Cité par Mounia Bennani-Chraïbi et Olivier Filleule, «Pour une sociologie des situations révolutionnaires. Retour sur les révoltes arabes», Presses de Sciences Po | Revue française de science politique, 2012/5 – Vol. 62, pp. 767-796. Article disponible en ligne à l’adresse: http://www.cairn.info/revue-francaise-de-science-politique-2012-5-page-767.htm
[2] Pour les sens de Hirâq et Intifâda, cf. Kadour Naimi, « »Hirak » ou « intifadha »?», URL :http://kadour-naimi.over-blog.com/2019/07/hirak-ou-intifadha.html; Akram Belkaid, «Hirak. Aux origines d’un mot», URL: https://orientxxi.info/magazine/hirak,3418 : consultés, 15/11/2019.
[3] Michel Foucault, Du gouvernement des vivants. Cours au Collège de France, 1979-1980, éd. M. Senellart, Paris, Gallimard-Seuil-EHESS («Hautes Études»), 2012.
[4] Mathieu Potte-Bonneville, Foucault, Paris, Ellipses, 2010. SPN.
[5] France 24, jeudi 16/01/2020, «Les politiques ne voient pas qu’on a faim» https://www.france24.com/fr/20200116-crise-%C3%A9conomique-au-liban%C2%A0-les-politiques-ne-voient-pas-qu-on-a-faim. (SPN)
[6] suivi de la loi constitutionnelle de 1990
[7] «On» parle de «tutelle syrienne» ou de la « mainmise syrienne » alors que l’on devrait parler de la ghalaba syrienne. Mais passons !
[8] La montée en puissance du capital financier remonte à l’époque de Rafiq Hariri qui mettra en place les mécanismes aboutissant à la crise actuelle. En effet, sa politique économique – plutôt financière qu’économique – était basée sur un endettement public important, des taux d’intérêts avantageux pour le système financier et bancaire, mais pas pour le secteur productif (économie de rente), ou encore le maintien coûteux pour les réserves monétaires de la parité entre livre libanaise et dollar. Avec le temps, une vingtaine d’années, cette politique, basée sur de la dette pour payer principalement de la dette et pariant sur une croissance indexée sur des secteurs comme les investissements étrangers, le BTP et le tourisme dans une région politiquement instable, est devenue destructrice de richesse. Voir, François El Bacha, «Un changement audible du discours politique et économique au Liban mais qui n’est pas encore suffisant», Libnanews, 12 février 2020, https://libnanews.com/un-changement-audible-du-discours-politique-et-economique-au-liban-mais-qui-nest-pas-encore-suffisant/, « Au crépuscule du Haririsme économique », 14 février 2020, https://libnanews.com/au-crepuscule-du-haririsme-economique/, consulté : 14/02/2020 ;
Jean-Pierre Sereni, « Le pitoyable effondrement du « miracle » financier libanais », URL : https://www.french.alahednews.com.lb/33608/358, consulté : 25/01/2020.
[9] La classe politique dont il est question constitue une oligarchie clientéliste et se compose de trois segments: les vieilles familles «féodales» et les notabilités d’avant-guerre qui ont réussi, sauf dans la communauté chiite, à se reconduire dans le jeu politique ; les élites issues de la guerre (pour les sunnites Rafiq Hariri, le duo chiite Amal et Hezbollah, le druze Walid Joumblatt, les chrétiens Michel Aoun et Samir Geagea qui la rejoindront, en 2005, après le retrait syrien. Tous au pouvoir guerrier à l’exception de Hariri au pouvoir financier) ; enfin le club des grands financiers (banquiers, hommes d’affaires, milliardaires) qui sont montés en puissance à partir des années 1990.
[10] Jacques Rancière, La Mésentente. Politique et philosophie, Galilée, 1995. Voir également, Guillaume Gourgues, «Sans-part», DicoPart, https://www.dicopart.fr/fr/dico/sans-part; Etienne Balibar, La Crainte des masses, Galilée, 1997.
[11] La liste des scandales de toutes sortes, demeurés sans jugement et impunis, est impressionnante. Citons les plus célèbres :
- Electricité/EDL (39 milliards de dollars, dépensés entre 2005 et 2019 pour «restaurer» l’EDL qui ne l’a jamais été);
- 2005-2009, Sanioura est accusé d’avoir «fait disparaitre» 11 milliards de dollars lors de son mandat ;
- 2005-2008, Mohammed Safadi est accusé d’avoir raflé Zeitouna Bay, pendant qu’il était ministre ;
- 2015, crise des déchets ou un milliard de dollars d’aide internationale aurait été détourné au profit de plusieurs parties prenantes locales et européennes ;
- 2016 scandale Ogero où son directeur général, Abdel-Moneim Youssef a été déféré devant le premier juge d’instruction ;
- 2017, scandale de l’Eden Bay où son promoteur, Wissam Achour – proche de Hariri et ancien gendre du Président de la Chambre Nabih Berri – a obtenu le droit de construire sur le sable, à une dizaine de mètres du rivage, alors que c’est interdit par la loi ;
- 2019, le ministre Gébrane Bassil et gendre du Président Michel Aoun est accusé par le quotidien Ad-Diyar de détournements de fonds publics, blanchiment d’argent et enrichissement illicite. Aucune plainte n’a été portée contre le quotidien ;
- le Conseil de Développement et de Reconstruction (CDR) est mis en examen par le procureur financier ;
- 2019, Ghada Aoun, procureur du Mont Liban, a mis en examen l’ancien Premier ministre, Nagib Mikati, son fils Maher et son frère Taha ainsi que la Banque Audi, pour s’être enrichi de manière illégale dans le cadre de prêts subventionnés par la Banque du Liban (BDL), pour des dizaines de millions de dollars.
[12] Pour les concepts de « reconnaissance » et de « mépris », voir Axel Honneth, La Lutte pour la reconnaissance, Trad. de l’allemand par Pierre Rusch, Éditions du Cerf, 2000, Réédition : Gallimard, «Folio essais», 2013 ; La Société du mépris. Vers une nouvelle Théorie critique, La Découverte, 2006 ; et bien évidemment Hegel, Phénoménologie de l’esprit.
[13] … que Georges Corm traduit par «système de dépouille», à la base du clientélisme-communautaire : «chaque communauté s’approprie un secteur de l’économie [ou une part du pouvoir], ce qui nuit au développement économique du pays», Jenny Saleh, Georges Corm : « Le Liban n’est pas sorti de son statut d’État tampon »», URL : https://www.middleeasteye.net/fr/entretiens/georges-corm-le-liban-nest-pas-sorti-de-son-statut-detat-tampon?fbclid=IwAR30IQhZpa80QuFRKr0iArkJSICKZiO3uyZmdkL-AZHbxndg2OSrJXxrj9E, consulté : 24/12/2019. En ce sens le système confessionnel, tel qu’il a été conçu, ne peut que conduire et à un système de corruption parce que chaque za‘îm communautaire est dans un marchandage permanent avec les autres pour parvenir à une espèce d’équilibre dans lequel chacun veut sa part du gâteau ; et à l’immobilisme politique.
[14] Il y a, au Liban, confessions et confessions. J’appelle grandes confessions ses acteurs qui pèsent sur son destin, infléchissent sa politique et qualifient sa conjoncture. Le Liban en a connu quatre, par ordre d’apparition: les maronites et les druzes entre 1830 et 1860, les sunnites à l’époque du mandat et de l’indépendance, les chiites entre 1964 et 1982 (Moussa Al-Sadr – naissance du Hezbollah).
[15] En fait Taèf consacre et amplifie le système confessionnel issu du Pacte national de 1943 qui a amplement prouvé qu’il n’était pas viable, Les communautés libanaises y sont reconnues dans leur double fonction d’agents politiques – en place et lieu des citoyens – et de centres de pouvoir. De surcroît, l’alliance entre maronites et sunnites y est toujours considérée comme pivot de l’équilibre communautaire alors que l’émergence de la communauté chiite comme acteur majeur de la scène libanaise et son aspiration à un rôle politique proportionnel a son importance n’y est pas pris en compte.
[16] En 2005, après l’assassinat de Rafiq Hariri et le retrait syrien du Liban, deux grandes coalitions, foncièrement géopolitiques, sont nées: celle dite du 14-Mars, mené par le clan Hariri et comprenant les Forces libanaises de Samir Geagea et le Parti socialiste progressiste de Walid Joumblatt, et parrainé par Riyad; celle du 8-Mars, mené par le Hezbollah et ses alliés (Sleiman Frangié, Omar Karamé, auxquels viendra se joindre Michel Aoun qui conclut, en février 2006, un accord avec le Hezbollah) et parrainé par Damas et Téhéran.
[17] Déjà cité. Beydoun, d’ailleurs, reprend la formule à Foucault.
[18] Le pouvoir exécutif appartient au Conseil des ministres et non au chef du gouvernement – qui ne joue que, formellement, un rôle prépondérant: il convoque le Conseil, en fixe l’ordre du jour, est responsable de l’exécution – et non de la conception – de la politique générale et donne les directives en vue de garantir la bonne marche des affaires. Il n’est que le Premier des ministres, mais il ne leur est pas hiérarchiquement supérieur et ne détient pas de prérogatives constitutionnelles par rapport au reste des ministres.
[19] Dans le cas libanais post-Taèf, la recherche à tout prix du consensus n’implique pas l’éradication du conflit, ni ne vise à éliminer la lutte pour la ghalaba, mais à le gérer aux moindres frais. Dans un tel régime en effet, qui ne tolère pas les adversaires et où toute voix opposée est présentée comme celle d’un ennemi, la confrontation « nous/eux » ne se présente pas comme une confrontation politique entre des adversaires mais comme une opposition radicale entre des ennemis.
C’est bien pour cela qu’il faut, à tout prix, gérer cet antagonisme pour ne pas sombrer dans la guerre; il faut donc chercher à transfigurer ce qui, par nature, est antagonistique en agonistique, le consensus étant précisément ce cadre où les conflits pourront prendre la forme d’une confrontation agonistique entre adversaires au lieu de se manifester par une lutte antagoniste entre ennemis.
[20] Taèf énonce, comme « sujets essentiels » : « l’état d’urgence, la guerre et la paix, la mobilisation générale, les accords internationaux, le budget général de l’Etat, les plans de développement intégral de longue durée, la nomination aux postes de fonctionnaires de première catégorie ou aux charges équivalentes, la révision de la carte administrative, la dissolution de la Chambre des députés, les lois électorales, les lois réglementant la naturalisation, le statut personnel, la révocation des ministres ».
[21] 2007 a été témoin d’un dysfonctionnement sans précédent des trois principales institutions du pays. Le Parlement, présidé par un chiite, n’a pas été réuni en session parlementaire pendant près d’un an. Le gouvernement, présidé par un sunnite, est paralysé parce qu’illégitime (non mithâqi) depuis la démission, novembre 2006, des ministres chiites. Enfin, la présidence de la République, dévolue à un chrétien maronite, est vacante depuis la fin du mandat d’Emile Lahoud, le 24 novembre 2007.
[22] D’autant que le Hezb, après la guerre de l’été 2006, émergeait à la fois comme une force politique libanaise incontournable et comme un acteur régional.
[23] Crises des élections du Président de la République
| 1998-2007
|
Emile Lahoud
Fin de son mandat : 23 novembre 2007 Six mois de vacance présidentielle |
| 2008-2014
|
Michel Sleiman
Date de son élection : 25 mai 2008 Fin de son mandat : 24 mai 2014 |
| 31 octobre 2016 : Michel Aoun | 28 mois de crise, soit, 2 ans et 4 mois de vacance présidentielle |
| En neuf années (2007 et 2016)
le Liban aura vécu le ~ 1/3 de ce temps en vacance présidentielle : 34 mois , soit ~ 3 années |
|
Crises de formation des gouvernements
| 2005-2009 : Sanioura | Seul gouvernement rapidement formé : 19 jours de négociations |
| 2009-2011 : Hariri | 05 mois d’âpres négociations |
| 2011-2014 : Najib Mikati | 05 mois d’âpres négociations |
| 2014-2016 : Tammam Salam | 11 mois d’âpres négociations |
| 2016-2019 : Hariri | 08 mois d’âpres négociations |
| 29 octobre 2019 | Démission de Hariri/Intifâda |
| Hassan Diab
Désignation : 19.12.2019 Formation : 21.01.2020 |
01 mois après sa désignation 03 mois après la démission de Hariri |
| En 10 ans (2009-2019) il y a eu ~ 30 mois de vacance du pouvoir exécutif pendant lesquels
les gouvernements n’étaient en charge que de l’expédition des affaires courantes. |
|
[24] Éric Verdeil, «Un système politique à bout de souffle», Presses de l’Ifpo, Publications de l’Institut français du Proche-Orient, URL : https://books.openedition.org/ifpo/10730, consulté : 31/01/2020 ; Aude Martin, «Liban: derrière la crise, une porosité entre l’Etat et les banques», Alternatives économiques, https://www.alternatives-economiques.fr/liban-derriere-crise-une-porosite-entre-letat-banques/00090959, consulté : 10/02/2020 ; La Croix, «Liban, une économie en état critique», https://www.la-croix.com/Economie/Monde/Liban-economie-etat-critique-2019-10-30-1201057529, consulté : 10/02/20.
[25] Mouvement mondial de désobéissance civile en lutte contre l’effondrement écologique et le réchauffement climatique, lancé en octobre 2018 au Royaume-Uni.
Illustration
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:2019_Lebanese_protests