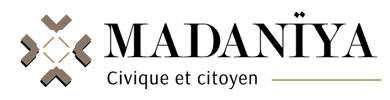Préface
Avant toute chose, je tiens à remercier mon vieux camarade Fathi Bel Haj Yahia d’avoir bien voulu prendre en charge la traduction de ce livre. Dans sa nouvelle vie en arabe, je ne doute pas qu’il trouvera un public plus large, plus averti et plus concerné.
L’édition française de La Gauche et son grand récit1 est parue début 2021, au lendemain des grandes manifestations de jeunes du mois de janvier 2021. L’édition arabe va paraître début 2022. Dans l’intervalle, la scène nationale a subi un profond bouleversement, suite au coup de force opéré par le président Kaïs Saïd le 25 juillet: auto-attribution des pleins pouvoirs, suspension du parlement, renvoi du gouvernement de M. Hichem Mechichi.
Étant donné l’importance de l’événement, je veux consacrer cette préface à l’examen du contexte inédit qu’il a instauré.
Je dois commencer par un aveu: je n’ai pas la mémoire courte. Ce qui signifie que je ne fais pas partie de ceux qui regrettent le renversement du système de pouvoir qui a littéralement saccagé le pays les dix dernières années.
D’une certaine manière, en qualité de ministre-conseiller à la présidence de la République entre 2012 et 2014, j’ai été un témoin privilégié lors de la mise en place de ce système. Durant cette période, malgré le devoir de réserve, j’ai multiplié les mises en garde et les critiques publiques face aux dérives que je constatais2. Après ma démission, j’ai poursuivi plus librement mon activité dans l’opposition, marquée notamment par la publication de deux livres et de nombreux articles.
Entre temps, après les élections générales de l’automne 2014 et l’alliance conflictuelle conclue entre les partis Ennahdha et Nidaa Tounès, la dégénérescence du régime s’était accélérée, pour devenir, dès 2016 et le gouvernement de M. Youssef Chahed, une réalité incontestable, évidente pour la plupart des citoyens. Qu’on en juge:
La dépendance à l’égard des États occidentaux et de leurs organismes financiers a atteint un degré insoutenable, qui s’est exprimé en particulier dans l’explosion de notre endettement extérieur;
Outre leur tropisme pro-atlantique, les partis de gouvernement et quelques autres se sont également transformés en relais complaisants, inscrits à l’intérieur de la guerre des axes à laquelle se livrent les puissances régionales – les Frères musulmans d’Ennahdha ancrés dans le camp turco-qatari; les formations issues de la décomposition de l’ancien RCD (Nidaa Tounès, Qalb Tounès, PDL, etc.) ralliant le camp saoudo-émirati.
L’envoi par Ennahdha de plusieurs milliers de jeunes Tunisiens rejoindre les milices jihadistes en Libye et en Syrie était une conséquence directe de l’alignement de ce parti sur Doha et Ankara. C’était le prix à payer pour continuer de bénéficier de leur appui financier et diplomatique;
Les contradictions internes de la classe dirigeante – des organisations fortement hostiles les uns aux autres, néanmoins obligées de former des coalitions et de gouverner ensemble en raison de leur caractère minoritaire – ont eu d’autres résultats désastreux. Elles ont d’abord détruit l’unité et la cohésion de l’État. Les principales institutions (l’administration, la justice, la police, les médias, etc.) ont été vampirisées et découpées en «royaumes indépendants», chacun au service du courant auquel il avait fait allégeance. Dès lors, dépourvu de volonté et de commandement communs, l’État s’est vite délité et a quasiment cessé d’agir en tant que tel;
-Le délitement de l’État a ouvert la voie à un essor vertigineux de la corruption. Jusque-là relativement contenu, le mal s’est promptement propagé à tous les milieux, à tous les domaines. La corruption est ainsi devenue le trait dominant de notre régime politique: financement illicite des partis; financement illicite des campagnes électorales; financement illicite du «tourisme» inter-partis dans les diverses assemblées… Elle est aussi devenue le trait dominant de notre régime économique: marché national inondé par les importations clandestines de biens de consommation courante; opérations spéculatives incessantes sur les prix des produits de base; multiplication des ententes illégales et des cartels dans la plupart des secteurs d’activité ; etc., etc.;
Tout au long de ces années de supposée «transition démocratique», le pays a été pratiquement abandonné à son sort.
Exclusivement préoccupés par les luttes de pouvoir et la captation d’avantages matériels, les partis dominants ont tout laissé se défaire autour d’eux. Les infrastructures et les territoires ont cessé d’être entretenus et aménagés. Les services publics ont poursuivi leur dégradation programmée.
Rapide et brutal, l’effondrement de l’économie a provoqué un véritable sinistre social, se traduisant par une augmentation massive du chômage (plus de 40% dans certaines villes de l’intérieur) et une paupérisation accrue des classes populaires, la chute des niveaux de vie frappant tout autant les classes moyennes. Dans ces conditions, l’écart séparant la population du régime politique censé la représenter, cet écart n’a cessé de s’élargir, comme en témoignent les chiffres de participation aux élections successives: près de 5 millions de votants pour la constituante en 2011, autour de 2,5 millions aux législatives de 2019. L’écart s’est encore aggravé en 2020 et 2021, pour se convertir en divorce, sous l’effet de deux fléaux simultanés: la pandémie Covid-19 et le gouvernement de M. Hichem Mechichi. Avec ce dernier, on avait en quelque sorte atteint le point de rupture.
* * *
Brièvement esquissées, telles étaient les caractéristiques fondamentales du système mis en place il y a dix ans, qui n’a apporté que ruine et désolation. Encore une fois, je ne regrette pas son renversement. Je le regrette d’autant moins sachant qu’il n’était pas capable, par lui-même, de se réformer et se corriger, et ne pouvait évoluer, par conséquent, que vers le pire.
Je m’explique. L’armature juridique sur laquelle reposait ce système était hermétiquement verrouillée. Elle était conçue, en effet, pour lui assurer durée et pérennité, et empêcher tout changement qui n’aurait pas été dans l’intérêt des partis politiques qui en étaient les artisans et les uniques bénéficiaires.
Le verrouillage était organisé autour de deux dispositifs centraux: 1) le mode de scrutin électoral ; 2) l’article 80 de la constitution.
Le mode de scrutin
Préconisée par un consultant américain, prétendument «expert en transitologie», la formule adoptée en 2011 – restée en usage depuis – et connue sous le nom de «scrutin de liste à la proportionnelle au plus fort reste», a eu pour incidence immédiate de perpétuer l’émiettement et la fragmentation de la représentation des partis au parlement, interdisant de fait toute possibilité de constituer des majorités gouvernementales stables, fortes et homogènes. Échéance après échéance, la logique interne de ce mode de scrutin a conduit progressivement à légitimer ce que l’on pourrait qualifier de régime de dictature des minorités.
Les résultats électoraux successifs d’Ennahdha en apportent la démonstration éclatante. Ce parti avait devancé ses concurrents lors de l’élection de la constituante en octobre 2011 (1.500.000 suffrages, soit 37% des voix, et 89 sièges à l’ANC sur 217). Sans disposer de majorité avec ses seuls députés, il avait pu imposer sa loi sur la vie politique durant 3 ans, en s’appuyant sur des alliés, le CPR et Ettakattol, trop faibles et inconsistants, trop opportunistes pour pouvoir – ou vouloir – lui résister.
Aux législatives de 2014, Ennahdha s’était classé deuxième derrière Nidaa Tounès, perdant du même coup le tiers de sa base électorale initiale (950.000 suffrages, soit 27% des voix, et 69 sièges à l’ARP, toujours sur 217). Malgré le recul, le parti islamiste avait pu continuer à exercer une influence considérable. Il redeviendra hégémonique lorsque les divisions de Nidaa Tounès priveront cette formation de son statut de première force au parlement.
Enfin, aux législatives de 2019, Ennahdha retrouvait la première place à l’ARP devant Qalb Tounès, mais en ayant perdu, cette fois, les deux-tiers de ses électeurs de départ (550.000 suffrages, soit 19% des voix, et 52 sièges).
Ce dernier pourcentage – 19% des voix – est d’ailleurs largement trompeur. Il ne se réfère qu’au total des suffrages validés. En revanche, si on le rapporte à l’électorat effectif global – le nombre total d’individus âgés de 18 ans et plus, c’est-à-dire l’ensemble des Tunisiens en droit de voter –, le pourcentage obtenu est trois fois plus faible et tombe à 6%. En d’autres mots, le parti islamiste est arrivé en tête aux élections de 2019 avec les voix de seulement 6% de l’électorat national réel.
Comment peut-on remporter la compétition et diriger le pays en n’ayant été élu que par 6 citoyens sur 100? On peut répondre à cette question de manière superficielle, en disant que l’effritement de leur assise électorale entre 2011 et 2019 n’a pas concerné que les islamistes, mais a touché aussi les autres partis, parfois plus cruellement. (Dans le même laps de temps, par exemple, les divers groupes de gauche avaient vu partir les neuf-dixièmes de leur électorat.)
Le reflux d’Ennahdha n’aurait été ainsi qu’un reflux en chiffres absolus. En chiffres relatifs, et comparativement aux autres formations, on ne pouvait pas parler de reflux, puisque les islamistes étaient parvenus à préserver une longueur d’avance sur leurs poursuivants.
L’explication est radicalement différente si l’on pousse plus profond l’analyse. Avec le mode de scrutin à la proportionnelle au plus fort reste, les partis en lice, exagérément nombreux, ne sont pas encouragés à se regrouper au sein de formations plus grandes, correspondant aux principaux courants de pensée existants et aptes, pour cette raison, à représenter plus fidèlement la population.
Élection après élection, l’éparpillement de la représentation parlementaire va conduire à former des coalitions hétéroclites, incapables de gérer les affaires publiques, et dont les composantes vont consacrer l’essentiel de leur énergie à se combattre, croyant améliorer leurs positions respectives de cette façon.
Graduellement, la situation d’ensemble va se dégrader, la base sociale du système va se rétrécir et le pays légal va avoir tendance à se séparer de plus en plus nettement du pays réel.
A terme, la déconnexion ainsi créée va déboucher sur une impasse politique majeure, une véritable crise de représentation. Mais le parlement ne pourra prendre aucune initiative crédible pour casser cet engrenage suicidaire. Il refusera, en particulier, toute remise en cause du mode de scrutin. Pourquoi? Parce que tous les groupes parlementaires, y compris ceux de l’opposition, lui devaient d’exister politiquement.
Le scrutin au plus fort reste n’arrangeait pas le seul mouvement islamiste, il arrangeait en vérité l’ensemble des partis présents à l’ARP. En matière d’obtention de sièges, il attribuait une sorte de prime non seulement aux formations les plus importantes (Ennahdha et Nidaa Tounès, puis Qalb Tounès), mais également aux formations d’importance moyenne (Haraket Ech-chaab, Ettayar, PDL, etc.), en leur permettant d’avoir des députés élus avec un nombre réduit de suffrages. (En 2019, certains de leurs candidats sont passés avec moins de 500 voix en leur faveur3).
Malgré leurs dissensions et leurs querelles, les dirigeants de ces formations privilégiées étaient attachés à la formule du plus fort reste comme à la prunelle de leurs yeux. Dans l’immédiat, un tel mode de scrutin leur apportait ce qu’ils désiraient le plus: une parcelle de pouvoir, plus ou moins grande selon les cas.
Ils ne pouvaient pas imaginer que ce même mode de scrutin, parce qu’il était nuisible pour le pays, finirait par les condamner à leur tour.
Voilà pour le premier verrou empêchant le système politique de se réformer de lui-même. Passons à présent au deuxième verrou.
L’article 80 de la constitution
Toutes les constitutions démocratiques à travers le monde renferment des clauses dites d’exception, conçues pour faire face à des situations de grand péril. Ce péril peut être d’origine extérieure, comme dans le cas d’une menace d’agression étrangère. Et il peut être d’origine intérieure, comme dans le cas d’un blocage total des institutions, ou d’un effondrement dramatique de l’économie, ou encore d’une épidémie dévastatrice.
Ces clauses de sauvegarde accordent au chef de l’État la latitude de prendre les mesures qu’il estime nécessaires pour combattre le danger imminent et le surmonter. Elles lui confèrent, ce faisant, une forme de souveraineté quasi absolue et exclusive dans la conduite des affaires du pays, durant la période marquée par la situation d’exception. L’éventail des décisions envisageables est vaste: il peut décréter la mobilisation générale, instaurer l’état d’urgence, dissoudre le parlement, renvoyer le gouvernement, suspendre les libertés publiques ou certaines d’entre elles, etc. Bref, il a le droit de concentrer entre ses mains tous les pouvoirs, pour un temps déterminé, que lui seul détermine en dernier ressort.
Je le répète: ce type de dispositions est prévu dans toutes les constitutions des pays démocratiques. Qu’en est-il de la nôtre, adoptée à la quasi-unanimité des membres de l’ANC en janvier 2014?
Elle renferme bien, elle aussi, un article consacré aux clauses d’exception – le fameux article 80 –, mais c’est un texte en trompe-l’œil, qui donne d’un côté ce qu’il reprend de l’autre.
Les premières lignes de l’article 80 débutaient pourtant de la meilleure des manières: en cas de danger imminent, elles reconnaissent au président de la République le droit de prendre les mesures requises par cette situation exceptionnelle.
Jusque-là, il n’y avait rien à redire. Mais tout de suite après venait une série de restrictions privant le chef de l’État de toute marge de manœuvre, de toute décision indépendante :
- D’abord, il devait consulter le Premier ministre et le président de l’ARP;
- Ensuite, il ne pouvait pas dissoudre l’ARP ;
- Enfin, il ne pouvait pas démettre le gouvernement4.
Autrement dit, le président de la République pouvait prendre toutes les décisions qu’il voulait, à la condition sine qua non que celles-ci soient acceptées et agrées par le parlement et le gouvernement. Sur le fond, il s’agissait là d’un détournement caractérisé du droit constitutionnel pur, puisque le chef de l’État, alors même qu’il y avait situation d’exception, se voyait dénié les attributs de souveraineté que cette situation d’exception devait en principe lui déléguer.
J’ai mentionné les deux verrous qui protégeaient le régime établi en 2011, pour lui assurer durée et pérennité.
Ils étaient positionnés aux deux extrémités de la chaîne, en amont et en aval en quelque sorte.
Le premier verrou – la proportionnelle au plus fort reste – servait à sélectionner les partis appelés à dominer la scène politique; le second verrou – l’article 80 – servait à obtenir que rien ne puisse venir de l’extérieur perturber leurs jeux pervers.
En juillet 2021, cependant, la Tunisie se trouvait bien dans une situation de péril imminent, un péril multiple, tout à la fois économique, social, sanitaire et institutionnel. Ceux qui portaient la plus grande part de responsabilité dans ce péril multiforme étaient précisément le parlement et le gouvernement. Ils regardaient le pays s’enfoncer chaque jour un peu plus dans l’abîme sans réagir, en donnant l’impression – notamment le Premier ministre Hichem Mechichi – que cela ne les concernait pas.
Pour être crédibles et efficaces, les premières décisions de l’état d’exception devaient impérativement être dirigées contre eux, pour mettre fin à leur nuisance.
C’est ce qu’ont d’ailleurs exigé des masses innombrables de citoyens à travers l’ensemble du territoire, tout au long de la journée du 25. Le gel des activités de l’ARP et le renvoi du gouvernement décrétés par Kaïs Saïd en début de soirée constituaient une réponse directe à cette exceptionnelle mobilisation populaire – mobilisation repartie de plus belle en fin de soirée après l’annonce par les médias des décisions présidentielles.
Ces décisions étaient indispensables et urgentes, il s’agissait réellement de mesures de salut public. Mais celles-ci ne pouvaient être prises en respectant la lettre ni même l’esprit de l’article 80. Par conséquent, pour contourner l’obstacle, il convenait de faire violence à l’article en question.
C’est ce qu’a fait le chef de l’État, en s’appuyant sur une interprétation très personnelle du texte (dans sa position, il ne pouvait agir autrement). Le verrou devait sauter; il l’a fait sauter. L’acte était, en tout cas, justifié et légitime. Nécessité fait loi.
* * *
Le moment de sidération passé, les partis ont évidemment dénoncé les agissements de Kaïs Saïd, les qualifiant de coup d’État contre la démocratie et les libertés.
Avec Rached Ghannouchi, le mouvement Ennahdha s’est démené en tous sens pour rameuter ses parrains étrangers et les inciter à réclamer le rétablissement du parlement dans ses droits.
Cette agitation est toutefois restée sans résultats notables. Et il est vite apparu – confirmant ce que l’on savait déjà – que la carte Frères musulmans, après avoir beaucoup servi lors du «Printemps arabe», n’était plus considérée comme une carte gagnante, ni par les stratèges de l’OTAN, ni par les émirs du Golfe.
Depuis, au niveau du parti islamiste, on ne compte plus les scissions et les départs, qui ne concernent pas que les militants de base, mais de plus en plus les cadres dirigeants. Les choses ne vont guère mieux au niveau de Qalb Tounès. L’écroulement a pris ici une tournure rocambolesque, puisque le président du parti, le sulfureux Nabil Karoui, afin d’échapper à un éventuel emprisonnement en Tunisie où il était poursuivi pour plusieurs affaires de fraude, n’a pas trouvé mieux que de s’enfuir en Algérie… où il a été placé en détention, pour d’autres délits perpétrés dans ce pays.
Plus globalement, c’est l’ensemble de l’ancienne classe dirigeante qui paraît désormais en pleine déroute, incapable de reprendre l’initiative des mains de Kaïs Saïd, malgré les atermoiements et les erreurs commis par ce dernier dans la gestion de la période d’exception.
Au-delà de ces faits, le changement le plus important enregistré après le 25 juillet est sans doute celui de la très nette reconfiguration du paysage politico-idéologique national. Celui-ci est dorénavant structuré autour de trois pôles: les anciennes élites; la présidence de la République; la grande masse de la jeunesse et des milieux populaires.
Dans ce trinôme, c’est la présidence qui joue actuellement un rôle de référence centrale; c’est par rapport à elle que les deux autres pôles se déterminent, soit positivement, soit négativement.
Alors qu’elles étaient auparavant divisées entre islamistes et anti-islamistes, les anciennes élites (pas seulement les élites politiques, mais également les élites intellectuelles, avec leurs deux blocs identitaire et moderniste) paraissent maintenant très largement soudées autour d’une commune détestation de Kaïs Saïd.
Ce qui les alarme par-dessus tout, c’est la volonté qu’elles lui prêtent de chercher – par le biais de l’état d’exception – à établir une dictature personnelle. Dans l’absolu, cette inquiétude n’est pas sans fondement, même si l’objectivité oblige de reconnaître qu’elle est, du moins jusqu’à présent, plus virtuelle que réelle.
Mais il y a plus troublant. En dehors de la focalisation sur le pouvoir personnel, on a peine à trouver d’autres sujets de préoccupation dans le discours politique de ces anciennes élites. L’économie est dévastée; les conditions d’existence de la population sont dramatiques: cela ne suscite pas de vrai intérêt parmi elles ni ne les pousse à prendre position et à agir. On pourrait presque en conclure que les problèmes au quotidien de leurs compatriotes ne les concernent pas.
C’était le cas hier lorsque l’énergie des anciennes élites était consumée dans la querelle entre islamistes et modernistes et que tout le reste était ramené à cet unique clivage.
Cela continue aujourd’hui, où la seule rhétorique qui vaille dans leurs rangs porte sur la dénonciation des pleins pouvoirs que s’est octroyé le chef de l’État.
Cette forme de surdité à l’égard des soucis concrets de la population – et d’abord de ses revendications économiques et sociales – a pour pendant une indifférence similaire de la population à l’égard des préoccupations des anciennes élites.
Si celles-ci sont dans une attitude majoritaire d’hostilité vis-à-vis de Kaïs Saïd, celle-là est dans une attitude majoritaire de soutien et d’adhésion.
La grande masse de la jeunesse et les milieux sociaux les plus modestes sont en effet persuadés que le chef de l’État les représente et les protège, et, à la limite, qu’il les incarne. Ils sont convaincus qu’il comprend leurs attentes et est décidé à les faire aboutir. Ont-ils raison? Ont-ils tort?
Pour le savoir, il faut formuler autrement le problème. Et se demander, devant l’échec consommé de l’ancienne classe politique, si Kaïs Saïd représente réellement une alternative adéquate, s’il dispose d’un projet suffisamment élaboré pour répondre de façon effective aux besoins immédiats et à venir de la Tunisie et des Tunisiens ?
* * *
Kaïs Saïd appartient à la catégorie des dirigeants politiques populistes, catégorie en forte expansion ces derniers temps. Dans son acception la plus vaste, être populiste signifie que l’on est tout à la fois pro-peuple et antisystème, c’est-à-dire anti-élites. Derrière cette définition purement descriptive, il y a cependant une conjoncture historique spécifique, qui caractérise ce que l’on pourrait appeler le moment d’émergence du populisme. Ce moment est toujours conditionné par une situation de crise, une situation de transition inachevée, une situation de faillite des idéologies dominantes.
Le populisme apparaît dans un contexte temporel précis, de déclin accéléré des anciennes idées et conceptions dominantes. Il apparaît lorsque les anciennes idéologies et les anciennes élites qui les portent ne sont plus opératoires, lorsqu’elles commencent à être rejetées par le corps social, alors que la relève – les nouvelles idéologies et les nouvelles élites destinées à les remplacer – n’est pas encore disponible et cristallisée.
Le populisme vient remplir un manque. Il vient à un moment où l’ancien n’est plus accepté et n’est plus légitime, mais où le nouveau n’est pas encore en état d’affirmer pleinement son existence et sa légitimité.
Le populisme s’installe dans ce manque, dans ce vide provisoire. Il va dénoncer l’ancien – l’ancien système, les anciennes élites –, contribuant ainsi objectivement à précipiter sa chute, mais sans pouvoir porter par lui-même radicalement le nouveau.
Et c’est directement pour cette raison – parce qu’il est lui aussi extérieur au nouveau, parce qu’il ne dispose pas d’une alternative adéquate – que le populisme se rabat sur l’autre versant de son identité constitutive: l’appel au peuple, le recours au peuple. Un peuple magnifié, sacralisé, auquel le populisme va attribuer la capacité spontanée de concevoir et de mettre en œuvre le nouveau, reconnaissant ainsi sa propre incapacité à cet égard.
L’aventure personnelle de Kaïs Saïd depuis 2019 s’inscrit parfaitement dans la trajectoire qui vient d’être décrite. Lors de la campagne présidentielle, le slogan «Ech-chaab yourid…», repris du soulèvement de 2010-2011, résumait l’intégralité de son programme. Le peuple veut, et le peuple sait exactement ce qu’il faut faire pour réaliser ce qu’il veut. Lui, Kaïs Saïd, n’avait pas à interférer dans ses choix. Le seul engagement qu’il pouvait prendre en sa qualité de candidat était d’aider, s’il était élu, à mettre en place un régime politique de démocratie directe. Avec un tel régime, déclarait-il sans entrer dans plus de détails, le peuple disposerait de représentants «authentiques» qui sauraient quoi faire une fois au pouvoir. Il n’avait rien d’autre à proposer et à offrir.
Dans une situation normale, pareil discours n’aurait soulevé aucun intérêt ni aucun engouement. Dans un pays dont la population était plongée dans le désarroi et dont la classe politique était en décomposition, ce discours improbable a fait mouche et trouvé son public.
Parvenu au palais de Carthage, Kaïs Saïd a continué à délivrer le même message, sans jamais avancer la moindre proposition concrète pour régler tel ou tel problème particulier. Ses compétences constitutionnelles étant limitées, il ne disposait d’ailleurs d’aucun pouvoir exécutif réel.
Tout cela a brutalement changé après le 25 juillet. Désormais, le président de la République est aussi, de fait, le chef éminent du gouvernement et doit, à ce titre, rendre des comptes. Si les premiers mois de la période d’exception ont été marqués par des interventions convenues contre la corruption et les corrompus, on peut néanmoins constater depuis quelques semaines – approximativement depuis novembre – un début d’évolution dans les sujets qu’il aborde.
En raison sans doute des pressions provenant de la population et peut-être aussi de sa propre base, Kaïs Saïd a commencé à traiter de questions dont il s’était tenu très éloigné jusque-là :
- La dette extérieure et la menace qu’elle fait peser sur notre souveraineté;
- Les terres domaniales, délaissées, et dont il faudrait ouvrir l’accès aux paysans;
- Les bas prix des céréales et la nécessité de les relever pour augmenter la production et améliorer les niveaux de vie à la campagne;
- Les méfaits provoqués par le système rentier; etc., etc.
(Détail intéressant à noter: ces différentes thématiques sont directement inspirées des analyses que nous sommes quelques-uns à développer à gauche depuis plusieurs années et sur lesquelles s’exerçait, jusqu’à présent, une sorte de blocus officiel. La présidence a levé le tabou et c’est tant mieux.)
Cette évolution indique un début de prise de conscience, qui devrait avoir des retombées pratiques sur l’action gouvernementale à court terme. Sur le terrain, les lignes ont d’ores et déjà commencé à bouger. Les mobilisations en cours vont en être encouragées et seront conduites à s’élargir et à s’approfondir.
Selon la manière dont les forces de police géreront les inévitables conflits à venir, on saura alors, de façon certaine, si la dévotion affichée par Kaïs Saïd à l’égard du peuple est sincère ou si elle a été l’instrument ayant servi à masquer une éventuelle soif absolue de pouvoir!
L’étape qui débute va nécessairement connaître un essor des luttes sociales. La jeunesse y tiendra sa place, qui est décisive. Issues de cette jeunesse, les nouvelles élites en gestation depuis dix ans vont se renforcer et se rassembler. On peut prévoir qu’elles pèseront de plus en plus dans la détermination des stratégies alternatives qu’attend le pays.
Le combat sera long, mais vaut d’être mené. Et c’est d’abord à ses acteurs que ce livre sur le grand récit de la gauche tunisienne est dédié.
Notes
- 1– Éditions Mots Passants, Tunis, 2021. Éditeur : Mots Passants- Tunis, 2021-ISBN:978-9973-9890-2-4
-
2– La Promesse du printemps (Editions SCRIPT, Tunis, 2016) recense plusieurs de ces positions exprimées publiquement entre 2012 et 2014.
-
3– Cette prime attribuée aux formations importantes ou de moyenne importance avait évidemment son envers: elle se faisait au détriment des petites formations et des listes les plus modestes. Des dizaines de groupes et de listes étaient dans ce cas durant les législatives de 2019. Ensemble, leurs candidats ont totalisé environ 700.000 voix – le quart des suffrages exprimés –, sans pour autant obtenir un seul élu.
-
4– «En cas de péril imminent menaçant la Nation ou la sécurité ou l’indépendance du pays et entravant le fonctionnement régulier des pouvoirs publics, le Président de la République peut prendre les mesures requises par ces circonstances exceptionnelles après consultation du Chef du Gouvernement, du Président de l’Assemblée des Représentants du Peuple et information du Président de la Cour Constitutionnelle. Il adresse à ce sujet un message au peuple. Ces mesures garantissent, dans les plus brefs délais, un retour à un fonctionnement régulier des pouvoirs publics. L’Assemblée des Représentants du Peuple est considérée, durant cette période, en état de réunion permanente. Dans ce cas, le Président de la République ne peut pas dissoudre l’Assemblée des Représentants du Peuple et il ne peut être présenté de motion de censure à l’encontre du Gouvernement.» Constitution de la République Tunisienne, p. 29, Tunis, 2014.