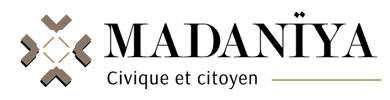«Sexe, Race et Colonies» La domination des corps du XVe siècle à nos jours
Interview de Nicolas Bancel animateur de l’ouvrage collectif de 97 chercheurs.
Avec l’aimable autorisation de https://www.golias-editions.fr/
https://www.madaniya.info/ soumet à l’attention de ses lecteurs ce texte publié à l’occasion de la commémoration de la « journée nationale des mémoires de la traite, de l’esclavage et de leur abolition » célébrée en France le 10 Mai depuis 2006.
- Ci joint la déclaration de Mme ChristianeTaubira, vingt ans après la loi qui porte son nom.
https://www.youtube.com/watch?v=FMNgF__JTwc&ab_channel=PublicS%C3%A9nat - Le long combat pour la mémoire de l’esclavage
https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/05/14/en-france-le-long-combat-pour-la-memoire-de-l-esclavage_6080167_3232.html - Lecture annexe
https://www.madaniya.info/2018/10/25/du-bougnoule-au-petit-negre-de-la-permanence-dune-culture-francaise-de-la-stigmatisation/
En présentant le colonialisme non plus seulement comme une violence économique et culturelle, mais aussi sexuelle, l’ouvrage Sexe, Race et Colonies, coécrit par 97 chercheurs (éditions de La Découverte) participe à un travail indispensable. Ce n’est pas un beau livre, mais un livre d’histoire. L’historiographie française, des années durant fascinée par la IIIe République, n’a longtemps pas voulu voir qu’elle fut le principal artisan du colonialisme.
Mais l’usage que le livre fait des images soulève un ensemble de problèmes. Les polémiques ont accompagné la sortie de cet ouvrage. Le choix des images est primordial. Il en allait de la crédibilité de la discipline historique à l’égard de la société dans laquelle elle s’inscrit.
Nicolas Bancel, né le 29 décembre 1965, est un historien français, spécialiste de l’histoire coloniale et postcoloniale française. Professeur ordinaire à l’Université de Lausanne, à la Faculté des Sciences sociales et politiques chercheur au Centre d’histoire internationale et d’études politiques de la mondialisation (CRHIM). Il nous livre sans langue de bois et avec la rigueur qui s’impose, son regard sur cet ouvrage majeur et sa contribution à cette somme qui fera date.
Golias: «Sexe, Race et Colonies» est un ouvrage coécrit par 97 chercheurs. Spécialiste du fait colonial, vous avez participé à cette démarche collective. Considérez-vous que la polémique née des images et du choc émotionnel produit, ne soit pas une façon de jeter un discrédit sur cette somme historique pour éviter d’évoquer le fond de la question dans ses diverses dimensions?
Nicolas Bancel: Au départ, je ne pense pas. La polémique est née après la publication d’une tribune rédigée par un collectif militant. Il faut leur faire crédit de leur sincérité, même si le livre n’était alors pas encore paru et que cette réaction s’est uniquement appuyée sur les articles publiés par Libération.
La polémique s’est ensuite développée selon deux axes. Premier axe: il ne faut pas montrer ces images car elles réitéreraient la souffrance des victimes. Cet argument – qui avait déjà été utilisé lors de la publication d’images de la Shoah par exemple à l’occasion de la publication du livre de Jonas Goldhagen Les bourreaux volontaires d’Hitler – est compréhensible, venant de minorités dont les ascendants étaient directement impliqués dans cette histoire. Mais pour un historien, on doit le dire nettement, il n’est pas recevable. Je pense que ces images sont des témoignages, des sources d’archives irremplaçables et qu’au contraire, nous avons le devoir de les montrer. C’est couteux, historiquement, et dirais-je psychiquement car c’est vrai, certaines images sont particulièrement dérangeantes et violentes, mais nécessaire car ces images donnent à voir, au plus profond, l’imaginaire et les pratiques sexuelles coloniaux. Ne détournons pas à nouveau notre regard de cette réalité.
Argument connexe: ce sont des blancs qui ont réalisé cet ouvrage et, d’une certaine manière, ils n’en avaient pas le droit, puisque cette histoire «appartiendrait» aux descendants des victimes. Outre que l’ouvrage réuni 97 spécialistes dont nombre sont membres des «minorités», l’argument est là aussi, on doit le dire tout aussi clairement, irrecevable.
L’histoire appartient à tous (et de surcroît l’histoire des sexualités et de la domination des corps est une histoire mondiale). Si nous commençons à réintroduire la rhétorique raciale qu’utilisait les oppresseurs pour justifier l’exclusion de chercheurs «blancs» (et pourquoi pas alors, «noirs» ou «hommes» pour d’autres sujets?) dans des domaines de recherche, alors nous courrons à la catastrophe en revitalisant les divisions et hiérarchies que ceux-là même qui dénoncent les historiens « blancs » sont censées combattre.
Heureusement – et cela semble être ignoré par ceux qui emploi de tels arguments – l’histoire est une discipline désormais largement internationalisée, et des historiens de toutes origines se rencontrent sur les sujets les plus divers. C’est la réalité du débat scientifique international.
Le second axe de la polémique s’est développé sur le traitement des images. Ici ce n’est plus la question «fallait-il les montrer?» qui est posée, mais «les a-t-on bien montrées? Notre travail sur les images a été très conséquent. Toutes les images sont légendées, de nombreuses images font l’objet d’un commentaire explicatif, plus de 100 notices spécifiques ont été rédigées dont environ la moitié concernent les images enfin nous avons fait un important effort pour systématiser les liens entre les textes des grands articles et les images (ce que l’on nomme les liens intertextuels). Mais sur ce plan, nous sommes ouverts à la critique. À l’évidence, les polémiques se sont focalisées sur la cinquantaine d’images particulièrement violentes. Mais rappelons que le livre en contient 1200! Cependant, certaines remarques critiques, sur ce plan, sont intéressantes. Peut-être aurions-nous pu renforcer encore l’appareil critique de certaines images? Nous y songeons pour les prolongements éditoriaux de ce livre.
Golias: Alors, après avoir dit cela, on peut effectivement regretter que ces polémiques aient un peu masquées, au moins au début, le fond de la question, qui est: comment, pendant des siècles, de l’esclavage à la colonisation et de la colonisation à aujourd’hui, les Empires (au sens large: empires européens, américain, japonais…) ont construit à la fois des pratiques sexuelles modelées par les rapports de domination et des imaginaires qui soutenaient ces pratiques? Et quels sont les héritages, massifs, de cette longue histoire?
Ces documents iconographiques, d’une richesse inouïe, disent-ils le fait colonial dans sa complexité sans en être une simple illustration?
Nicolas Bancel: Les documents iconographiques disent énormément de choses: ils informent de pratiques, par exemple lorsqu’un colon se fait photographier avec deux concubines africaines nues, le colon tenant fermement le sein de l’une d’elle. Cette photographie du début du XXe siècle nous renvoie à la réalité de l’époque : les colonies étaient perçues comme un gigantesque lupanar où les hommes blancs pouvaient se permettre de transgresser tous les interdits qui leurs étaient imposés en métropole (à l’inverse d’ailleurs des femmes blanches, qui elles devaient se conformer, aux colonies, à l’image prude et chaste qui les distinguaient radicalement des femmes indigènes).
Mais cette image nous dit aussi que cette pratique non seulement était tolérée, mais qu’on s’en vantait, les «exploits» sexuels aux colonies faisaient partie d’une expérience valorisée. J’ai évoqué cette image, mais d’autres racontes d’innombrables autres histoires: elles nous font pénétrer des univers de pratiques, mais aussi des univers mentaux. En cela l’image est une source irremplaçable et donc non, évidemment, l’image ne fait pas qu’«illustrer» l’histoire. Mais bien sûr l’image ne dit pas tout, elle doit être croisée avec d’autres sources (archives, témoignages, etc.). C’est pourquoi, dans le livre, nous faisons appel à des historiens qui connaissent ces autres sources, qui permettent de contextualiser ces images, de les comprendre dans le fil d’une histoire.
Golias: Si les images et l’émotion ont fait polémique, la couverture aussi. Elle veut traduire «le symbole de domination sexuelle des uns sur les autres». Plus largement, la volonté de ne pas – de ne plus – cacher et de permettre le débat sont-elles un des objectifs de cette somme historique, afin de permettre une forme de «réparation» collective de ce passé représenté par le fait colonial?
Nicolas Bancel: Je pense que c’est d’abord un livre d’histoire, une synthèse de travaux qui se mènent depuis plusieurs années dans de nombreux pays. Mais oui, le livre vise aussi à mettre à plat cette histoire encore largement méconnue, permettre sa diffusion à un plus large public, et donc ouvrir un débat. Non seulement sur le passé, mais aussi sur les répercussions contemporaines de cette histoire.
Golias: Rupture normative entre métropoles et colonies, domination et ségrégation autour de l’homme «blanc» offrent une première grille de lecture remplie de paradoxes. Comment expliquez-vous cela?
Nicolas Bancel: Sans doute parce que la colonie a toujours été conçu – et vécu – comme un espace d’exception. Nous partons de loin: je rappelle que sous le régime de l’esclavage les esclaves étaient des biens meubles, les femmes esclaves étaient donc destinées explicitement au travail, à la reproduction (mais elles ne possédaient pas leurs enfants, qui appartenaient au maître) et au service sexuel du maître. Dans ce domaine, tout était possible, du sadisme à la brutalité la plus inimaginable jusqu’à, exceptionnellement, une relation de couple presque «normale» (aboutissant, là aussi très exceptionnellement, à l’affranchissement). Ces relations de domination absolues dans les colonies esclavagistes, on les retrouve, euphémisées, dans les Empires. Les indigènes ne seront jamais des égaux.
Quel que soit la forme de la colonisation, ceux-ci sont toujours infériorisés, sur le plan des droits politiques et juridiques, mais aussi généralement sur le plan économique. Cette asymétrie objective autorise tous les franchissements. Les blancs sont comme dans un territoire vierge des normes sexuelles qui régissent la vie en métropole.
Gauguin en est un bon exemple, qui s’offrent de multiples concubines (ou prostituées) parfois très jeunes (12-13 ans), «à visage découvert», ce qui évidemment n’aurait pas été possible en métropole. La domination coloniale passe ainsi par l’accaparement des femmes, au détriment d’ailleurs des hommes indigènes, qui sont, de fait, dévirilisés, comme l’avait très bien analysé Fanon.
Golias: La diffusion d’images que l’on peut considérer «pornographiques» constitue un autre paradoxe. Nous sommes loin des «bonnes mœurs» des métropoles…Quelle analyse en faites-vous?
Nicolas Bancel: C’est assez simple en fait. Le statut des femmes indigènes est, longtemps, incertain. Prenons l’exemple des exhibitions ethniques dans lesquelles, entre le milieu du XIXe siècle et la fin de l’entre-deux-guerres, on expose des femmes et des hommes quasiment nus (les femmes ont systématiquement la poitrine dénudée).
Ces exhibitions, on les retrouve dans toute l’Europe de l’Ouest (y compris au sein de nations qui n’ont pas de colonies), aux États-Unis, au Japon, en Australie, etc. Pourquoi peut-on ainsi exhiber la nudité de ces femmes, dans des spectacles populaires auxquels tous ont accès? Parce que ces femmes sont à la lisière de l’humanité, dans l’imaginaire collectif elles portent une part animale qui les rapprochent de la Nature. En conséquence, on peut effectivement les exhiber ainsi. On constate le même phénomène avec l’extraordinaire circulation de cartes postales soit disant «ethnographiques», en fait érotiques, qui exhibent également la nudité ou quasi nudité de ces femmes indigènes, au vu de tous. Comme si l’Occident, mais aussi le Japon, déchargeaient à travers ces spectacles et ces images une libido alors bridée par des normes sociales et comportementales très restrictives.
Dans les colonies, les catégorisations sexuelles des indigènes vont bon train.
Entre la mulâtresse forcément perverse, dangereuse mais accessible; la noire considérée comme sauvage, mue par ses pulsions et insatiable sexuellement, la jeune asiatique douce et offerte, tout un univers mental phantasmatique se met en place au long des XVIIIe et XIXe siècles, qui justifie, encourage, la prédation sexuelle des dominants.
A l’inverse, comme dit plus tôt, les femmes blanches en colonies sont encore plus surveillées que dans les métropoles. Le tabou sexuel absolu est la relation sexuelle entre une femme blanche et un indigène, qui viendrait perturber l’ordre colonial racial et patriarcal.
Golias: Fantasmes, désirs, peurs sont au cœur des violences qui s’exercent autour d’une sexualité de domination. N’est-ce pas ce prisme qui a fait du viol «une arme de guerre» à grande échelle fait «peur» aujourd’hui à ceux qui disent votre ouvrage «sans ambition scientifique»?
Nicolas Bancel: La mention d’un ouvrage «sans ambition scientifique» a été formulée par une militante qui, à ma connaissance, n’a aucun titre pour le faire, sa critique étant par ailleurs dépourvue de toute scientificité. Passons. Le viol est une arme de guerre qui n’est pas propre aux systèmes impériaux en décomposition. On trouve le phénomène, massivement, par exemple, pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais durant les décolonisations, cette arme fut systématiquement utilisée, et à grande échelle, avec des raffinements de cruauté qui interrogent. Comme si il avait fallu «punir» les colonisés du désir de se déprendre de leur oppresseur.
Il n’est pas douteux aussi que le racisme généralisé, l’infériorisation et la bestialisation systématique des femmes indigènes a encouragé très fortement l’usage du viol durant les guerres de décolonisations. Là aussi, un tabou commence à être levé, même s’il reste beaucoup à faire.
Golias: Que nous dit votre «somme historique et anthropologique» sur notre société aujourd’hui et le rapport que nous entretenons avec notre passé?
Nicolas Bancel: Elle nous dit que, malgré d’incontestables avancées, nous continuons, en France en tous cas, à avoir de réelles difficultés à aborder ce passé colonial, à en faire une anamnèse complète, nécessaire selon moi pour aller enfin de l’avant, ne plus être hanté par les fantômes du passé.
Parce que si l’on y regarde de près, les conséquences de ce passé sont nombreuses, par exemple dans le racisme contemporain, dans la difficulté, encore majoritaire, à accepter les couples mixtes (ou à les désirer pour soi-même), dans la persistance d’imaginaires raciaux sexualisés encore très présent dans les discours et imaginaires collectifs; sans parler, dans les ex-colonies, des séquelles concrètes des spécialisations prostitutionnelles locales issues de la période coloniale ou de la Seconde Guerre mondiale, dans des pays comme le Maroc ou la Tunisie (prostitution masculine hétéro et homosexuelle, prostitution féminine), aux Philippines ou en Thaïlande (prostitution globale et infantile), etc. Le tourisme sexuel est devenu un véritable marché mondialisé, d’abord principalement destiné aux occidentaux, mais où de nouveaux consommateurs (chinois par exemple) apparaissent. Nous sommes clairement, dans la très grande majorité des cas, dans la poursuite postcoloniale de rapports de domination ancrés dans la période coloniale.
Golias: Les corps sont aujourd’hui comme hier «sexualisés, genrés, racialisés, politisés». Votre travail de déconstruction des images par les images peut-il nous aider collectivement à relire notre rapport aux colonisés et à leurs descendants?
Nicolas Bancel: C’est ce que nous espérons. Nous constatons que le travail de l’antiracisme – nécessaire et souvent admirable – ne suffit manifestement pas, eu égard à la recrudescence du phénomène en Europe, mais aussi un peu partout dans le monde. Nous pensons que seules des opérations de déconstruction de l’histoire peuvent nous permettre de comprendre ce qui nous arrive, de comprendre ce par quoi nous sommes construits. Car, dans le cas qui nous occupe, nous touchons à l’intime, aux zones obscures de l’inconscient. L’horizon politique de l’ouvrage est effectivement celui d’une société véritablement postraciale, qui a mis à distance ses démons.
Golias: A titre personnel, ces quatre années de travail collectif colossal ont certainement marqué la personne et l’historien que vous êtes. Quel message plus personnel pourriez-vous nous transmettre, au-delà des polémiques et des caricatures dont on vous a affublés?
Nicolas Bancel: Une seule remarque: chaque chercheur travaille pour, comme le disait Foucault, se transformer. Ce livre m’a transformé car il m’a permis de comprendre énormément de choses sur des sujets sur lesquels je travaille pourtant depuis plus de vingt ans: l’esclavage, la colonisation et leurs suites contemporaines.
Je dirais donc: lisez le livre. Prenez le risque de vous plonger dans cette longue histoire, ces univers déstabilisants qui vont l’esclavage jusqu’à nos jours. Prenez le risque d’affronter intimement ce passé, ces images, faites-en un objet de savoir qui pourra vous aider à mieux comprendre ce que nous vivons, et, peut-être, qui vous êtes.